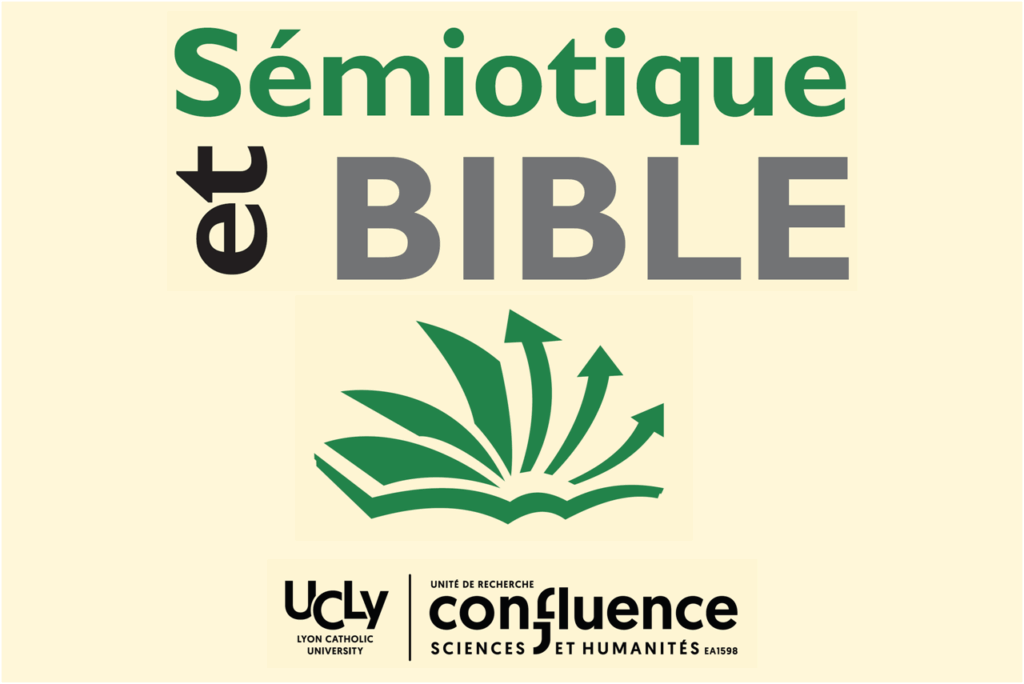Louis Panier le développe dans l'article suivant : dans la tradition de lecture que le corpus chrétien inaugure, c'est précisément la réunion des deux Testaments en un seul livre ou le rapport de l'un à l'autre Testament qui à la fois est donné à interpréter et qui livre ou énonce une sorte de théorie de la signification.
Cette théorie peut être ainsi résumée : la signification est le parcours qui conduit de la figure à son accomplissement. Le parcours n'entend pas ordonner une succession telle que l'accomplissement rendrait caduque et périmée l'étape qui le précède. Mais le parcours dispose un rapport logique qui, une fois l'état d'accomplissement venu, garde encore vif le processus signifiant tout entier. Il importe qu'entre les deux états le rapport soit maintenu : c'est pourquoi l'Ancien Testament est gardé, et sa lecture continuée.
Et ce qui est en mesure d'assurer le rapport et de le préserver en chacun des deux états, ce sont les figures elles-mêmes en tant que celles-ci apparaissent dès le commencement de tout le processus signifiant et que, dans le temps de l'accomplissement, elles sont encore conservées au titre d'éléments témoins nécessaires à la reconnaissance de l'étape ultime.
Qu'est-ce donc que cette étape ultime qui est et fait accomplissement ? Pour définir l'accomplissement le plus exactement et le plus brièvement possible, il suffit de dire que c'est la venue au monde d'un corps. C'est ce que la théologie a appelé l'incarnation. Mais, laissant de côté la question théologique, j'examinerai seulement quels types de problèmes sémiotiques sont posés derrière cette proposition théorique qui, pour être entendue, n'a pas besoin d'être référée à un horizon théologique ou confessionnel, à savoir : le processus signifiant est le parcours qui conduit de la figure à son accomplissement, c'est-à-dire de la figure au corps.
Sur cette proposition je ferai trois brèves remarques d'introduction.
La première pour resituer mon propos dans le cadre d'une réflexion sur "le devenir" : s'il Y a parcours du processus signifiant noté par ces deux termes que sont la figure et le corps, le passage de l'un à l'autre relève-t-il du devenir et nous dit-il quelque chose sur le devenir (du devenir des figures par exemple) ?
Ma deuxième remarque relèvera un paradoxe de la proposition : le processus signifiant ainsi résumé ne s'achève pas par un complément de signification. Le corps en effet n'est pas réductible à l'apport d'un contenu de sens définitif. li est même ce qu'il y a de plus autre que le sens. Ceci relativise ou risque même de contredire la première remarque : y a-t-il un réel devenir des figures au corps, puisque le passage des unes à l'autre implique une rupture dans l'ordre de la signification, sans qu'il y ait pourtant sortie du processus signifiant ?
Enfin ma troisième remarque consistera à annoncer que la réflexion autour de ces questions nous conduira à nous interroger sur un possible terrain de rencontre entre sémiotique et psychanalyse.
Les questions soulevées
Quelles sont les questions qui sont agitées ou impliquées dès lors que l'on s'interroge sur le rapport des figures au corps ? Je ne serai pas exhaustif. Je ne ferai qu'essayer d'en pointer quelques-unes. Deux principalement.
A propos de la notion de figure en sémiotique, je ne réfléchirai pas sur la définition qu'en donne d' abord Hjelmslev. La figure sert à désigner les non-signes, c'est-à-dire les unités qui constituent séparément soit le plan de l'expression soit celui du contenu. Loin de contester cette définition, je la considérerai comme un préalable acquis et je me tournerai vers le caractère figuratif des figures, vers cette possibilité des figures discursives, semblable à celle de la peinture figurative, de renvoyer "à un contenu donné, quand celui-ci a un correspondant au niveau de l'expression de la sémiotique naturelle (ou du monde naturel)" (Dictionnaire de Courtés-Greimas, article "Figuratif').
Or il me semble que cette définition de base d'une part recèle une ambiguïté et d' autre part ouvre une perspective. La perspective ouverte est celle qui établit un rapport étroit entre le processus signifiant, auquel appartiennent en propre les figures de la langue, et le phénomène de la perception que met en œuvre le contact avec le monde naturel.
L'ambiguïté que cache en revanche la définition pourrait ainsi s'énoncer: la dimension figurative a-t-elle pour effet soit de reproduire discursivement des "états de choses" expérimentés et vérifiés par la connaissance du monde naturel, soit de créer et d'imaginer des mondes possibles, parallèles au monde du sens commun ? Ou bien cette dimension figurative contribue-t-elle très spécifiquement à construire le discours auquel elle appartient en un ensemble signifiant renvoyant à un acte énonciatif ?
En fait deux options différentes sont ici mises en jeu. Dans le premier cas, on se rapporte à ce que J. Geninasca appelle une sémiotique du signe-renvoi (les figures sont traitées comme des signes et renvoient aux états de choses comme les concepts thématisent l'état des idées du monde représenté). Dans le second cas, on met en œuvre une sémiotique des ensembles signifiants : la signification n'est plus le décalque linguistique d'un état de choses réel ou imaginé, elle est l'acte de discours qui "articule paradigmatiquement et syntagmatiquement un ensemble fini de représentations" (J. Geninasca).
Ces deux options me paraissent thématiser l'ambiguïté de la définition du figuratif que je citais plus haut. En effet elles reprennent, chacune à sa manière, la question que la linguistique appelle la question de la référence. Mais la linguistique traite peut-être en termes trop étroits une telle question qui pourrait être élargie à peu près en ces termes : quel est cet autre du discours auquel le discours renvoie ? La sémiotique du signe-renvoi y répond classiquement, c'est-à-dire à la manière de la linguistique : le référent est le monde naturel tel qu'il est connu et reconnu par le savoir encyclopédique ou le savoir commun. La sémiotique des ensembles signjfïants - sans nier l'instance du monde naturel - propose une autre voie à explorer : le discours renvoie à un acte énonciatif. C'est la notion d'acte, et donc d'acte humain, qu'il faudrait ici analyser suivant la problématique que Greimas a déjà fort bien posée : de cet acte énonciatif on ne peut rien dire tant que l'énoncé n'est pas produit; et pourtant l'acte n'est pas réductible à l'énoncé, il est ce que l'énoncé présuppose.
La définition du figuratif recèle une ambiguïté et ouvre une perspective. Autour de cette ambiguïté et de cette perspective se posent en fait deux questions : celle d'abord du rapport du figuratif à la perception (c'est la perspective ouverte); celle ensuite du ce à quoi renvoie le discours (c'est l'ambiguïté). Deux questions qu'il ne faut pas confondre; bien qu'elles puissent converger vers le même point.
Le figuratif et la perception
Quand la sémiotique affirme que les éléments figuratifs du discours renvoient à un contenu qui a son correspondant au niveau de la sémiotique du monde naturel, elle établit un lien d'interdépendance entre la langue et la perception du monde. Cette interdépendance a été principalement examinée en référence à la philosophie de Husserl et de Merleau-Ponty. Et les notions d'extéroceptivité, d'intéroceptivité et de proprioceptivité ont servi à poser une continuité dans la relation sujet-monde. Continuité dont le corps assure la médiation. Ainsi la figurativité et la figurabilité ne sont elles rien ou sont-elles impossibles hors corps et sans corps, c'est-à-dire sans corps percevant. Mais la définition donnée du figuratif énonce aussi une proposition qu'il ne faut pas trop laisser dans l'ombre : le figuratif oblige à mettre en rapport deux sémiotiques. C'est dire que l'interdépendance entre la langue et la perception du monde est effective dans la mesure où le monde naturel n'est plus conçu comme un état brut des choses sans sujet qui le perçoive et le nomme mais est toujours déjà constitué ; par la présence du sujet qui l'habite, en un ensemble d'éléments naturels sémiotiquement organisés. Dès lors qu'il y a un sujet le monde est nécessairement constitué en sémiotique du monde naturel. Il est donc sans doute inexact de distinguer, au point de les opposer, d'un côté le processus signifiant qui relèverait de la langue, et de l'autre la perception qui, elle, serait au moins dans un premier temps réaction purement sensitive aux objets du monde. Cette conception des deux ordres relève d'une sorte de fantasme - fantasme d'une perception brute, et pourtant humaine, soustraite à un univers parlant.
En fait la perception est englobée depuis toujours par le processus signifiant ; elle en est une part, au point que ce qui la fait humaine c'est d'être prise, informée, structurée par un réseau signifiant ou plutôt par ce qu'il conviendrait d'appeler la signifiance, fondement de la perception comme elle l'est de la langue.
Sans doute faudrait-il ici pouvoir s'expliquer plus longuement sur ce qu'est la signifiance ou cet ordre de la signifiance. Il me semble que c'est, jusqu'à ce jour, Jacques Lacan qui a le plus nettement théorisé cet ordre comme fondateur de l'humain et qu'on peut résumer par le principe suivant : il n'est possible à aucun être humain de s'extraire de l'ordre de la parole puisqu'il y est inscrit dès avant sa naissance. Sur quoi repose cet ordre fondateur ? Sur une simple opération depuis toujours faite : retrait ou soustraction d'une partie sur la totalité indivise imaginairement posée au commencement. De sorte que la totalité brute et indifférenciée - un état où le monde perçu et le sujet ne ferait qu'un - est à jamais inaccessible. De sorte surtout que le mur du langage fait barrage contre tout retour vers la chose et qu'à la totalisation du sens il n'y a plus accès car il y aura toujours un irréductible de la chose au langage et au sens. Cet ordre de la signifiance, Lacan le résume par la prévalence, l'antécédence et le primat du signifiant. II faut compter avec du signifiant sans signifié, et avec une perception qui implique la perte de la chose. Se situer avant cet ordre, dont l'instauration correspond peut-être à ce que Freud appelle "le refoulement originaire", est absolument vain et illusoire. A l'origine il y a une coupure tranchante, une brisure irréparable.
Quand ceci est posé, il peut alors apparaître qu'entre la langue et la perception du monde il n'y a ni discontinuité radicale ni simple reproduction du monde par la langue. Mais le discours comme la perception sont tous deux le propre d'un corps humain, c'est-à-dire d'un vivant institué par et sous le régime de la signifiance.
Il ne serait pas inutile ici - et à propos de la perception notamment – den redonner toute son actualité au vieil adage aristotélicien et scolastique : res recipitur ad modum recipientis : la chose est reçue selon le mode de celui qui la reçoit. Et le mode ici est ce que j'appelle l'ordre de la signifiance.
Les objets du monde sont donc perçus dès le commencement par un corps que la signifiance a marqué et inscrit sous son ordre. Dès lors les éléments figuratifs du discours sont ainsi situés en position d'interface : ils sont le lieu de passage ou le point de contact entre ce qui appartient en propre à la langue et ce qui relève en propre de la perception, ces deux systèmes étant l'un et l'autre soumis à la signifiance. De sorte que toutes les formes du monde sont en mesure d'être ressaisies, transformées en figures discursives parce que, étant perçues, elles sont déjà parlées, c'est-à-dire prises dans la signifiance. Et en venant à la sensation, elles ne se contentent pas de rendre visible ou palpable l'état muet des choses mais elles avivent dans les corps la faculté que ceux-ci ont de parler le monde et d'être parlés au monde, c'est-à-dire leur faculté énonciative.
Pour approfondir la perspective ouverte par ces remarques, je me permettrai de faire encore appel à l'expérience et à la théorie analytiques. Le pouvoir qu'a le figuratif d'établir une continuité entre le monde et la langue ou entre la perception et le discours remonte en fait très haut. Il reconduit vers cet événement liminaire en lequel sentir et être parlé, dans la fulgurance de leur surgissement initial, n'ont fait qu'un, vers ce moment nécessairement perdu du commencement où sur un corps né d'un autre corps la langue et la caresse maternelles sont venues ensemble une première fois et y ont inscrit ce que certains psychanalystes appellent "une lettre". Par la lettre est inscrite ou ouverte une zone érogène. Serge Leclaire décrit ce moment instaurateur en ces termes, dans son livre intitulé Psychanalyser (Seuil, 1968) :
"Imaginons la douceur du doigt d'une mère venant jouer "innocemment" comme dans les temps de l'amour avec l'exquise fossette à côté du cou et le visage du bébé qui s'illumine d'un sourire. On peut dire que le doigt... vient en ce creux imprimer une marque, ouvrir un cratère de jouissance, inscrire une lettre qui semble fixer l'insaisissable immédiateté de l'illumination. Dans le creux de la fossette une zone érogène est ouverte, un écart est fixé que rien ne pourra effacer mais où se réalisera de façon élective le jeu du plaisir, pourvu qu'un objet - n'importe lequel- vienne en ce lieu raviver l'éclat du sourire que la lettre a figé." (p. 71-72 de l'édition de Poche, collection Point).
C'est la notion d'écart et de différence qui est à retenir plus particulièrement car, empruntée aux sciences du langage, à la linguistique ou à la sémiotique d'origine saussurienne, elle est ici appliquée au corps percevant ou plutôt au corps jouissant, en tant que celui-ci est soumis dès l'abord au régime du signifiant qui régit aussi la langue. Et Serge Leclaire précise plus loin :
"La lettre n'est cependant ni zone érogène ni objet, encore qu'elle ne semble, justement, pouvoir se concevoir qu'en référence à ces deux termes : elle se distingue de la zone érogène pour autant qu'elle est matériellement saisissable, alors que l'essentiel de la zone érogène git dans l'insaisissable différence d'un pareil-pas pareil d'où nait le plaisir ; elle se distingue de l'objet pour autant qu'elle n'est pas tout à fait un morceau de corps, mais plus précisément le trait qui en constitue autant qu 'il en figure la limite. Surtout elle peut être reproduite pareille à elle-même." (p. 95 de la même édition).
En dépendance d'avec ce moment instaurateur, perceptions et figures discursives ont, pourrait-on dire, un destin lié. Les perceptions des éléments du monde avec leurs formes visibles, leurs odeurs, leurs goûts, leurs consistances au toucher et leurs sonorités ont le pouvoir de faire résonner, comme en rappel ou en écho, la face interne des corps où sont gardés l'empreinte de la première voie entendue, de la première caresse ressentie, les traits du premier visage entrevu, par lesquels l'entrée sans retour dans l'espèce parlante fut au commencement signifiée. Et tout pareillement la chaîne figurative, en faisant intervenir dans le discours des représentations du monde reconduit la langue au plus près du percevoir, en tant que l'un et l'autre ordre sont tous deux conjointement et depuis toujours ordres de signifiance.
Ce point de contact que je tente d'approcher entre perception et langue touche sans doute au même domaine que Freud a exploré et essayé d'analyser, au niveau de l'inconscient, à l'aide de la distinction faite entre "représentation de chose", (Sachevorstellung) et "représentation de mot" (Wortvorstellung), la représentation de mot étant essentiellement acoustique (l'une et l'autre relevant donc de la perception). Et ces deux sortes de représentations sont les deux modes par lesquels la pulsion se fait "représenter" dans le psychisme et l'investit (tandis qu'à l'affect revient la nécessaire fonction de "représenter" dans le psychisme la décharge de la pulsion).
Je risquerai la suggestion suivante. Ce qu'on appelle figuraI est peut-être cette dimension propre au figuratif qui, dans les discours, travaille sur ce point précis où langue et perception sont l'une et l'autre instituées pour un corps par l'ordre de la signifiance. Et le figuraI aurait pour fonction d'inscrire dans la chaîne du discours une forme rémanente de l'opération instituante du sujet de l'énonciation et donc de reconduire celui-ci vers l'ombilic de sa condition parlante, vers ce point où parler et sentir, étant tous deux soumis au même ordre, surgit la question ou le fait de l'impossible jouissance. En usant de la figurativité, sans reproduire la visibilité des choses, le figuraI viserait à représenter, comme en filigrane du discours, l'espace proprement corporel où s'est éveillé au commencement la capacité énonciative du sujet.
L'autre du discours
Reste l'autre question posée plus haut à partir de la définition du figuratif donnée par le Dictionnaire. Question de la référence, mais que nous renonçons à traiter par le moyen d'une sémiotique du signe-renvoi. Y a-t-il un hors discours auquel le discours renvoie ? Ou peut-on se demander vers quoi le discours tente de faire retour ? A cette question nous n'apporterons qu'une ébauche de réponse.
En nous référant à ce que J. Geninasca appelle une sémiotique des ensembles signifiants, nous avons exclu que la signification serait réductible à la reproduction des états de choses ou des idées du monde et nous avons soutenu qu'elle était l'acte d'énonciation qui fait tenir un ensemble fini de représentations sémantiques.
Déjà la notion d'acte - en tant qu'il s'agit précisément d'un acte – situe la signification ou sa visée à l'extrême bord de l'énoncé qui, lui, n'est qu'un produit, un état déposé, qu'un acte - la lecture - devra relever. Mais notre réflexion sur les figures, dont l'enchaînement ou la mise en parcours est une des oeuvres principales de l'acte d'énonciation, suggère de plus que ces figures elles-mêmes sont dotées d'une double puissance. Puissance d'une part figurative qui, portée à son extrême, est celle de la mimé sis et de la transparence représentative. Puissance d'autre part figurale qui, arrimant la représentation et donc la perception à l'acte énonciatif, produit des effets de déplacement, de brouillage ou de rappel d'un élément représenté à l'autre, autant d'effets qui sont de défiguration. Ces deux puissances, on pourra les estimer contraires, si l'on veut retenir l'une sans l'autre ou l'une contre l'autre. On peut aussi les considérer en tant que puissances antithétiques, dont la déchirure est le propre des figures dans la mesure où précisément elles donnent forme à ce qui fut d'abord première inscription de la signifiance sur la chair du sujet de l'énonciation, et qui maintenant, détaché du corps, est dans le discours évocation, redite ou rappel de cette inscription première.
Alors le hors-discours qu'on peut pointer à l'horizon du discours n'est pas identique au référent des linguistes ou à l'état de choses postulé par une sémiotique du signe-renvoi. Il est autre puisqu 'il touche au plus près à ce qui soutient ou fait tenir l'acte d'énonciation du discours : quelque Chose qui, n'étant pas le discours, serait encore en-deçà ou au-delà de l'énonciation elle-même et que les figures seraient le plus à même de pouvoir représenter. Nous soumettrons donc la proposition suivante : par la puissance des figures le discours - et plus excellemment le discours littéraire - est la tentative toujours répétée de faire retour non pas vers ce qui serait l'infigurable et sa fascination, mais vers ce qui ne peut être que figurable. Détour par les figures pour faire retour vers ce qui serait la Chose, qui en fait jamais ne pourra être la Chose mais sera toujours l'ultime butée avant la Chose : ce noeud de chair soumis à la signifiance qu'est le corps éveillé au langage et à la perception par la présence d'un autre corps parlant. Le hors-discours que vise la signification, ce serait donc le corps du sujet de l'énonciation, ou plutôt le sujet de l'énonciation comme corps. Étant entendu que de corps il n'y en a qu'aux deux conditions minimales suivantes :
1) qu'une chair soit, dès avant sa naissance, soumise à la signifiance, de sorte que pour cette chair la perception comme la langue relève depuis toujours de l'ordre de la parole ;
2) qu'aucun corps n'est (nait) jamais seul : c'est l'entre-deux corps qui fait le corps humain. Entre-deux dont l'acte instaurateur - mais non originel – est fait de ces "contacts-et-mots-premiers" qui, provenant du corps "maternel" marquent de la lettre le corps nouveau-né et lui signifient son entrée dans l'espèce humaine.
Les figures auraient ainsi la capacité ou la fonction de garder et de raviver la trace mnésique d'une expérience fondatrice où se noue l'impossible articulation du jouir et du parler et où prennent naissance la passion et donc toute la dimension pathémique.
De telle sorte que les figures tiennent en réserve dans le discours un effet de signification à venir, comme la promesse d'un retour possible de ce moment où sentir et parler n'ont fait qu'un. Quelque chose qui n'est pas le discours, qui tient pourtant à la capacité et à l'intensité énonciatives et qui pourra se laisser raviver par la présence et par la voix, non plus par des figures énoncées mais par l'énonciation située à la rencontre et dans l'écart entre deux corps. C'est évidemment la littérature amoureuse qui le plus explicitement noue son écriture autour de cette mémoire et de cette promesse des figures. Ce que Homère a si exemplairement signifié par le récit de Pénélope : aux yeux des prétendants n'apparait qu'un tissage ou une texture ordinaire. Mais dans le canevas sans cesse repris et défait, Pénélope cache la mémoire d'une présence, l'attente d'une nouvelle venue. Et au retour d'Ulysse, elle quitte sa tapisserie, comme l'amant interrompt sa lettre quand l'aimée survient.
Conclusion
En conclusion, deux remarques resitueront ces propos dans le cadre d'une réflexion sur le devenir.
1) La théorie greimassienne a posé à la base de son modèle la structure élémentaire qui, elle-même, repose sur le principe de la différence et de la relation entre aux moins deux termes-valeurs (voir article "Structure" du Dictionnaire de Greimas et Courtés). Ce sont donc des formes discrètes et le discontinu que la théorie a disposés au fondement du processus de la signification. Mais aussi en construisant son modèle sous la forme du parcours génératif, elle y a introduit le dynamisme d'un déploiement qui, partant de la structure élémentaire, se développe et s'enrichit par paliers successifs jusqu'à la manifestation textuelle.
Le déploiement du parcours relève-t-il de réelles transformations successives ou relève-t-il d'un continuum en extension dont le noyau est déjà posé en germe dans la structure élémentaire ?
S'il s'agit de transformations, ces transformations s'opèrent d'un niveau à l'autre (de l'élémentaire au narratif. et du. narratif au discursif). Mais la transformation étant définie comme le passage d'un état à un autre contraire, peut-on soutenir que dans le modèle génératif l'élémentaire est l'état contraire du narratif et le narratif l'état contraire du discursif ?
S'il s'agit en revanche d'un continuum, pourquoi a-t-il fallu faire intervenir l'instance d'énonciation entre le narratif et le discursif, de telle sorte que le continuum s'est trouvé brisé ? La supposition d'un espace tensif sous la structure élémentaire a tenté de régler le problème mais sous un mode "vitaliste" selon lequel le sujet serait une extension ou un prolongement peu à peu individué de la Nature.
2) Le problème soulevé par le figuratif et le figuraI suggère que d'autres voies sont possibles et qu'il serait sans doute préférable de poser l'énonciation comme le plus fondamental, le plus antérieur logiquement et s'exerçant en tout temps sur tous les composants du discours. L'énonciation, en tant qu'elle est toujours remise en acte d'un acte fondateur, englobe à la fois la perception et le langage. II y a bien distinction entre les phénomènes perceptifs et les phénomènes de la langue, mais sans doute ne faut-il pas les opposer. Ils sont tous deux soumis à ce que j'ai appelé l'ordre de la signifiance. C'est pourquoi il est sans doute impossible et vain de tenter de remonter à un état hors langue et hors signifiance où le devenir humain serait en puissance sous forme de forces vitales et sensitives pures. Il faut poser au fondement de l'énonciation une coupure initiale et originaire. C'est la psychanalyse qui a, plus abondamment que la sémiotique, exploré et formalisé la nature de cette coupure fondatrice, peut-être autour du concept de refoulement originaire, certainement autour du concept de castration symbolique.
Sans rien renier de sa spécificité propre, la sémiotique ne trouverait-elle pas quelque profit à dialoguer avec cette autre "science humaine" qui, comme elle, reconnaît au fait du langage une place première ?
François MARTIN