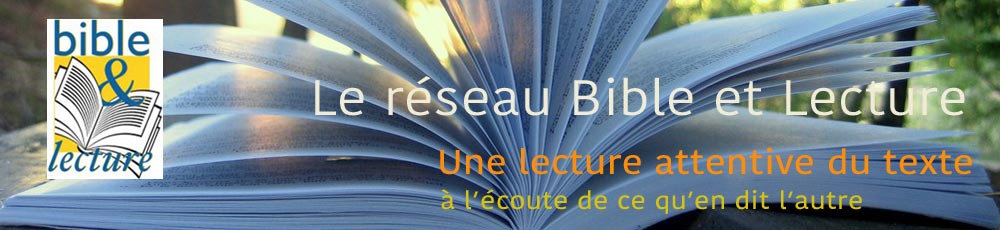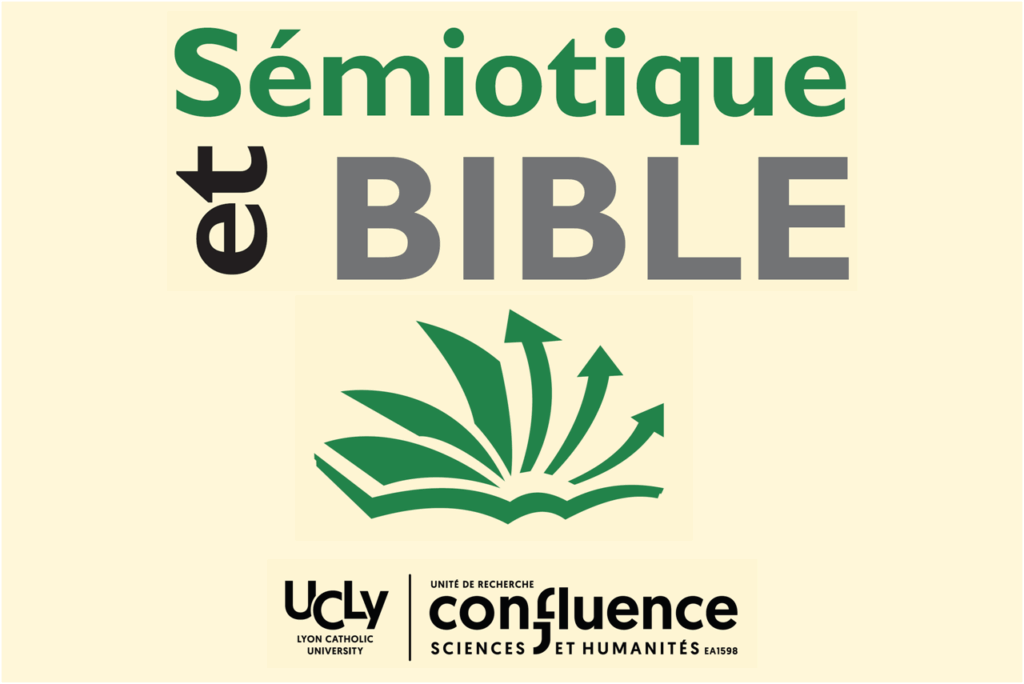Depuis quelques années, le CADIR-Lyon propose un séminaire de formation à l’animation de groupes de lecture sémiotique. Il y accueille des personnes qui ont déjà une expérience d’une telle animation ou qui désirent s’y préparer. En règle générale, les groupes animés par les participants au séminaire abordent des textes bibliques lus avec le projet d’aider ces groupes à effectuer un chemin de foi. La formation proposée tient compte de ce paramètre et s’appuie elle-même sur ces textes, qui lui donnent en retour une couleur particulière. Nous souhaitons, avec le présent article, inaugurer une rubrique dans laquelle nous ex- poserons de façon régulière le fruit de cette expérience.
Nous démarrerons cette série d’articles en évoquant le…démarrage de la lecture, événement récurrent des groupes de lecture sémiotique de la Bible. Cette évocation se fera en cinq moments. Dans un premier moment, nous exposerons le dispositif de notre séminaire dans son fonctionnement actuel : il constituera la toile de fond de l’ensemble du texte. Nous détaillerons ensuite le centre de ce dispositif : la « relecture » de nos lectures. Un troisième moment présentera in extenso le déroulement de la séance retenue pour fournir la matière du présent article, et un quatrième moment en proposera une analyse. Un cinquième et dernier moment tentera une élaboration théorique de l’expérience vécue là. Ce travail de généralisation cherchera à éclairer quelques enjeux liés au moment crucial que représente le démarrage d’une lecture, à la fois pour les lecteurs des groupes et pour leurs animateurs. La conclusion de ce texte nous permettra alors d’interroger la position des animateurs du séminaire lui-même : il s’agit d’un juste retour des choses, et d’une façon de nous souvenir constamment de l’exercice d’humilité que représente toute activité d’animation, à quelque niveau que ce soit, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de formation.
Précisons, avant d’aller plus avant, que la matière première de cet article a été fournie par le groupe, non seulement parce que nous relatons ici les fruits de son expérience de lecture mais aussi parce qu’il a lui-même proposé, lors de sa relecture, des éléments d’élaboration dont nous nous sommes fortement inspirés1.
Le dispositif du séminaire
Le séminaire de formation à l’animation se propose d’aider les participants à élaborer une réflexion sur la position d’animateur de groupe de lecture sémiotique de la Bible, à partir de leur propre pratique de lecture. Cette proposition prend essentiellement trois modalités différentes qui sont tour à tour exploitées au cours des huit rencontres qui balisent une année universitaire2. C’est l’une d’entre elles qui va servir de support au présent article.
Selon la modalité dont nous parlerons dans ces pages, il s’agit de lire en groupe un texte biblique, en respectant une consigne précise : tenter de rendre compte sémiotiquement de chaque observation effectuée sur le texte et partagée au groupe. Autrement dit, les lecteurs sont invités à être à la fois dans la lecture et dans une position « méta » par rapport à cette lecture. L’objectif de cette difficile gymnastique3 est, en particulier, d’habituer les animateurs à discerner les positions de lecture des membres des groupes qu’ils animent ou animeront. Etre constamment le plus « embrayé4 » possible dans l’entendement de la lecture du groupe permet à un animateur d’y ajuster son dire5 autant que faire se peut6. Le séminaire fonctionne, dans ces conditions, selon un dispositif de formation par la relecture.
Au début de cette première rencontre de l’année 2008-2009, il avait été proposé de recourir à Lc 10, 25-377 comme support de nos investigations. Il s’agit de la rencontre de Jésus avec un légiste, rencontre incluant la parabole du Samaritain qui pratique la miséricorde envers un homme blessé. La consigne indiquée ci-dessus une fois donnée par les animateurs du séminaire, le groupe s’est lancé dans la lecture. Les propos échangés ont été pris en note aussi précisément que possible. Ces notes sont restituées ci-dessous, les noms des personnes ayant été masqués.
A l’issue de cette lecture, qui a duré environ 1 heure 30, un échange « à chaud » s’est instauré à son propos entre les participants, dont nous n’avons pas gardé de traces, mais qui avait le mérite de provoquer une première mise à distance. Lors de la séance suivante un texte de cette lecture a été distribué au groupe. La séance a consisté dans une lecture collective de ces notes, qui a fait elle-même l’objet d’une nouvelle prise de notes. Pour cette nouvelle lecture, des consignes précises ont été données aux participants. Ces consignes ont un caractère assez général et s’appliquent globalement à l’ensemble des relectures que nous animons, moyennant quelques ajustements de circonstances. Nous les explicitons donc ici de façon détaillée, et nous y renverrons les lecteurs de nos prochains articles.
Le dispositif de la relecture
1. Nous rappelons aux participants qu’il s’agit avant tout d’une formation à l’animation : dans ce cadre, si nous sommes amenés à lire des textes bibliques, il est d’une importance relative que la lecture soit ou non conduite à son terme. Le rappeler est régulièrement nécessaire, tellement la lecture est un plaisir et devient facilement une fin en soi. Or le fondement de notre projet tient à ce que nous ne lisons pas pour nous-mêmes et pour notre plaisir, mais de sorte que la « parole »8 puisse circuler au dehors de notre séminaire et être entendue par d’autres que nous. De la même façon, nous redisons que s’il est indispensable de lire dans un cadre méthodologique, cette méthodologie n’est pas une fin en soi. Il est également utile de le rappeler de temps à autre, tant la méthodologie stimule — pour autant qu’elle soit en place !9 — la propension des sujets humains au savoir et à la maîtrise. Or non seulement ce n’est pas le but premier, mais l’animation conduit souvent à mettre en œuvre un « lâcher-prise »10 de la part de l’animateur et à accompagner chez les lecteurs un semblable « lâcher-prise ». S’exposer à la parole nous semble ne pouvoir se faire dans la maîtrise, sauf à en annuler totalement la puissance de transformation. Méthodologie et lecture sont ainsi subordonnées à notre projet, et non l’inverse. Nous rappelons également aux participants que l’animateur est plutôt en position de lecture du groupe en train de lire11.
Nous commençons à voir que l’enjeu est de permettre aux animateurs un embrayage et un débrayage suffisants pour que la lecture soit possible, et fructueuse. En effet, parler sur une expérience de lecture précédente engage tellement d’affects, et des affects à ce point profonds que ceux-ci viennent parasiter12 le processus d’analyse, tant qu’ils ne sont pas tenus à distance par une position de débrayage. Nous allons l’apercevoir en regardant le dispositif technique et concret de notre relecture.
2. Le travail qui sera mené demande la mise en place d’un dispositif précis, qui tient en quatre points.
a) Nous lisons un texte écrit. Il s’agit de la prise de notes effectuée par les animateurs du séminaire durant le travail du groupe en formation. Aussi détaillé que possible, il n’est évidemment pas exempt d’omissions ou d’approximations, mais qui restent peu importantes lorsque la prise de notes est performante. Ce texte constitue une référence commune. On évite de la sorte la surinterprétation qui accompagne l’exercice de la mémoire, ainsi que les discussions sans fin sur le fait de savoir si l’on a dit telle chose ou telle autre. Mais le plus important réside dans le caractère textuel du support, qui témoigne d’un débrayage énonciatif effectué une fois pour toutes par le groupe, et sur lequel il n’est pas possible de revenir : ce qui a été dit est désormais hors d’accès13, et le groupe, dorénavant, se pose dans la distance d’une lecture.
b) Ce texte est lu par le chemin qui nous est commun : la sémiotique. Nous pourrions le lire sans méthodologie particulière, mais la sémiotique vient provoquer un autre débrayage14 qui soutient les lecteurs dans leur effort de mise à distance par rapport à ce qui s’est passé. C’est un bon moyen de limiter les projections imaginaires que tout lecteur inscrit volontiers dans le texte, et ce d’autant que sa parole vive a participé à l’élaboration de ce texte. En effet, un retour sur expérience par les acteurs mêmes de cette expérience ne peut que mobiliser l’imaginaire de ces acteurs de façon particulièrement intense. Le regard sémiotique joue ainsi, vis-à-vis de ces projections imaginaires, le rôle d’une instance critique15.
c) Pour faciliter ce débrayage nous rappelons que les acteurs du texte de la lecture — ce texte au second degré issu de la première prise de notes —, malgré la similitude de leur désignation, n’ont plus rien à voir avec les acteurs qui lisent désormais ce texte — c’est-à-dire les participants du séminaire qui se risquent à une relecture. D’une part, ils ont changé, du temps s’est écoulé depuis la lecture initiale (le plus souvent environ un mois) : il n’est pas possible d’identifier un acteur/relecteur, appelons-le A., avec l’acteur « A. » qui se présente désormais comme une figure du texte. D’autre part, la parole d’un lecteur (lors de la lecture du texte de premier rang, le texte biblique) est engagée dans celle d’un groupe, à un moment donné de la vie de ce groupe. Elle participe donc d’un dire commun et ne saurait refléter la personne elle-même à la manière d’une carte d’identité : lorsqu’un membre d’un groupe prend la parole il ne peut faire autrement que de la situer par rapport à celle des autres membres du groupe. S’il ou elle apporte tel ou tel propos, c’est parce qu’il ou elle estime qu’il est bienvenu à ce moment de la parole en élaboration. Ainsi la parole d’un acteur du groupe de lecture fait-elle écho au moins autant au groupe qu’à l’acteur lui-même. Pour ces deux raisons il est demandé aux lecteurs de ne pas dire « je » pour désigner un acteur (tel l’acteur A. mentionné ci- dessus) qui pourrait avoir été celui dont ils ont occupé la position la fois précédente. Ils devront, de la même façon, s’interdire de désigner les autres acteurs du texte par les véritables prénoms. Il est autorisé en revanche à apporter en complément du texte pris en notes des figures d’énonciation dont ce texte apporterait le souvenir et qui n’y auraient pas été consignées. Simplement, ce recours à la mémoire ne fera non jamais sur le mode du « je ».
d) Il s’agit de lire à partir de la fin16. Concrètement et pour notre lecture, cela signifie que nous partons de la fin provisoire à laquelle nous sommes parvenus. Le texte de la lecture atteste qu’il y a eu lecture et que cette lecture est déjà une forme d’accomplissement17. On recherchera ce qui porte le mouvement de cette lecture, mouvement qui l’entraînait mais sans être encore discernable, la lecture n’étant pas achevée18. Dès lors notre lecture ne s’intéressera pas à ce qui pourrait avoir échoué mais à repérer le chemin de cet accomplissement. C’est sur ce constat positif de réussite qu’il sera possible de repérer les détours et les errances éventuels du chemin, de façon à en tirer un enseignement fécond pour nos futures lectures et animations.
L’importance donnée à une méthodologie sémiotique dans cette proposition répond à deux objectifs :
- Le premier objectif est de dégager de notre lecture des enseignements sur le geste très particulier qui consiste à animer un groupe. Ce projet va de pair avec la visée de distance — de débrayage — soulignée ci-dessus. Dans l’animation d’un groupe, en effet, énormément d’enjeux (en particulier affectifs) sont en cause, le plus souvent hors du champ de la conscience et de la maîtrise de l’animateur. L’objectif n’est pas de tout contrôler — on ne contrôle pas la parole — mais de tenter de prendre la mesure de ces enjeux. En effet les figures qu’ils suscitent portent l’émergence du chemin de lecture dont nous parlions à l’instant, ce chemin inchoatif en train de se chercher et de se tracer. L’embrayage énonciatif de la lecture est ainsi mis au service d’un débrayage vis-à-vis de l’affectif, nécessaire pour permettre une formalisation destinée à soutenir l’animateur dans son travail.
- Le second objectif est de faire acquérir aux animateurs un habitus, qui consiste à se positionner d’emblée comme sémioticiens dans leur façon d’accompagner un groupe. Si nous voulons former des animateurs de groupe de lecture sémiotique il est important de leur faire acquérir une telle position, qui permettra de se situer comme lecteurs de la lecture du groupe. De la sorte, les participants sont entraînés à reconnaître les résonances qui peuvent naître entre trois niveaux : 1. le texte biblique que lit le groupe ; 2. les structures énoncées que le groupe met au jour et construit au fil de sa lecture à partir du texte biblique lu ; 3. les structures énonciatives19 qui peuvent être reconnues dans la circulation de la parole au sein du groupe lui-même. La sémiotique énonciative que nous pratiquons20 est particulièrement armée pour aborder ce troisième niveau. Les concepts et les gestes d’analyse qu’elle propose apportent une aide précieuse aux animateurs dans l’entendement du chemin effectué par le groupe et la conduite de l’animation.
Une expérience de lecture
Il est temps maintenant de découvrir une expérience de lecture, ainsi que la relecture qui en a été faite dans le cadre qui vient d’être indiqué. Avant de proposer ce texte à la lecture, il n’est pas inutile d’en rappeler la composition. Il comporte deux parties.
- La première partie, qui correspond à la première rencontre du groupe, retrace la lecture d’un texte biblique. La consigne de cette lecture était de lire le texte comme on le ferait dans un groupe, mais en qualifiant de façon systématique le statut sémiotique de chaque observation ou de chaque hypothèse de lecture ; l’animation fait ensuite l’objet d’une relecture par le groupe.
- La seconde partie, qui correspond à la seconde rencontre du groupe, propose les minutes de la relecture dont le dispositif vient d’être décrit. La règle de cette relecture était, comme on vient de le voir, de pratiquer une lecture sémiotique du « texte » de la lecture précédente.
Entre les deux rencontres, les animateurs du séminaire avaient eux-mêmes opéré une lecture sémiotique de ce texte, de façon à faire émerger quelques hypothèses susceptibles de rendre compte du chemin qu’il parcourait. La deuxième séance de travail a été initiée par des propositions issues de ces hypothèses. L’une d’elles s’appuyait sur le constat selon lequel la lecture proprement dite n’avait pas commencé immédiatement. Un temps relativement long s’est avéré nécessaire pour établir les conditions de la lecture du groupe. Ce constat nous a paru riche de potentialités d’enseignement pour la question du démarrage d’un groupe en général. C’est pourquoi nous avons suggéré aux participants de réfléchir, à partir du texte, sur ce que peut signifier « démarrer une lecture », dans n’importe quel groupe, et particulièrement lorsqu’il s’agit de la première séance d’une année.
Dans cette perspective, alors que le texte de l’ensemble de la lecture effectuée lors de la séance précédente avait été distribué aux participants, seule la partie de ce texte concernant la phase de démarrage de la lecture a été véritablement lue par le groupe. C’est donc cette partie que nous reproduisons ci-après, suivie des minutes de la lecture qu’en a fait le groupe. Les noms ont été effacés ou transformés dans le texte distribué, de façon à augmenter encore l’effet de débrayage évoqué ci-dessus21. Les différentes interventions ont été numérotées pour pouvoir y faire référence ultérieurement dans l’article, la lettre « R » ayant été ajoutée pour identifier les propos tenus au moment de la relecture proprement dite. Un dernier point : le texte qui a servi de support pour la lecture du groupe, nous l’avons dit, était Lc 10, 25-37. Il a lui-même fait l’objet d’un travail approfondi préparatoire de la part des animateurs du séminaire.
LECTURE DE LA PARABOLE DU SAMARITAIN – LUC 10, 25-37
1° séance
Lecture à voix haute par F., puis le groupe entame sa lecture sémiotique.
(1) … : Est-ce qu’on se lance dans un découpage ? Ben oui. On découpe. Allez, les ciseaux. Allez. En 3 D.
(2) E. propose une expérience. « Ça vaut ce que ça vaut. On pourrait relire le texte à 3. Une personne lit le niveau somatique, une autre le niveau verbal, et une autre lit la partie énonciation22. Tous les autres sont responsables pour que les autres restent sur le bon chemin.
(3) G. : Si on est dans une situation d’animation, est-ce que ce n’est pas un peu tôt ?
(4) F. (?) : Moi, je crois que ce serait une bonne expérience. Trois couleurs de voix. Au pire, on se trompe.
(5) … : J’écoute, allez-y Expliquez à H. : J’écoute les animateurs, le 3 D ça m’intéresse. Trois niveaux : somatique, tout ce qui décrit les acteurs dans leur faire et dans leur état ; le niveau verbal, c’est quand les acteurs prennent la parole (discours direct ou non). ET L’énonciation se trouve au milieu. C’est le comment ça parole. Et le verbal, c’est le quoi ça dit. Le somatique, c’est l’inscription dans la chair. I. aime bien les couleurs : le niveau somatique est noir, le niveau verbal rouge et l’énonciation vert. Est-ce que quelqu’un est partant ? 25 à 28, pour commencer. Est-ce que quelqu’un veut faire le niveau somatique : moi je vais le faire, ça c’est facile.
(6) F. : je veux bien faire l’énonciation.
(7) E. : moi, je prends le verbal.
(8) Lecture à trois voix (noire /somatique, vert / énonciatif, rouge /verbal).
(9) Un problème émerge : des finesses à revoir (les phrases ne correspondent pas directement et uniquement à un niveau). En particulier, lecture de la parabole prise comme un énoncé (voix rouge de E.). Découverte explicite que cet énoncé n’est pas, en lui-même, homogène, mais peut comme tout énoncé supporter l’ouverture des trois lignes du somatique, de l’énonciation et de l’énoncé. On découvre là l’empilement des niveaux : le « verbal » au carré.
(10) J. : J’ai une hésitation sur « voulant se justifier » : pour moi, c’est de l’énonciation. Cela parle plus de sa façon de parler que…
(11) E. : c’est les deux.
(12) G. : « voulant se justifier lui-même », c’est une qualification mais on ne sait pas par qui elle est donnée. C’est le texte qui dit quelque chose sur le légiste (L.). Donc, il y a le texte qui parle. « Voulant se faire juste », ce qui motive ses paroles. C’est de l’énonciation.
(13) H. : c’est l’intention, c’est quelque chose qui est projeté, qu’il n’a pas atteint encore. « Voulant ».
(14) I. : ça touche plutôt son état que sa parole.
(15) X : s’il veut se justifier c’est qu’il ne l’est pas.
(16)
(17)
(18) M. : moi, je le relie à « pour le mettre à l’épreuve» au début du texte. C’est le dynamisme qui le met en route pour parler.
(19) Il veut se faire juste par rapport à qui ?
(20) G. On est en plein dans l’entendre et le dire. « voulant se justifier arrive là ».
(21) E. : c’est bien un nœud, mais j’aimerais bien revenir au début. Je pars du principe que je ne comprends pas, et les choses s’éclaircissent les unes par rapport aux autres. Je me demande si ce ne serait pas plus juste de repartir du texte et de construire les choses par scènes discursives.
(22) F. : D’autant que tout à l’heure on s’est fait piéger par la lecture, avec la parabole. Le texte nous a montré quelque chose
(23) Consensus pour faire une hypothèse de découpage.
(24) H. : avant le 3D j’aurais découpé, 27-28.
(25) … : Pas d’accord…
(26) – E. : Peux-tu nous dire pourquoi tu découpes ainsi ?
(27) – X : parce que Jésus répond à la question, puis on passe à une autre histoire.
(28) – … : Oui, mais si on regarde les acteurs, on a deux acteurs, et en 30 on a un changement d’acteurs.
(29) – … : Oui, mais en 30 les autres acteurs interviennent à un autre niveau.
(30) H. : L’enjeu du découpage, c’est quoi ? On se concentre sur la première partie, puis sur la deuxième ?
(31) E. : Anne nous disait, c’est mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Les bleus du ciel ensemble, les verts de la prairie ensemble.
(32) H. : propose de se concentrer sur la première partie.
(33) F. : mais comment définir les parties ?
(34) Rappel du principe.
(35) F. : Au niveau somatique, des acteurs (légiste / Jésus). Un échange de paroles entre ces deux acteurs. On n’a pas beaucoup d’éléments pour faire un découpage en scènes au niveau somatique.
(36) … : On n’a pas beaucoup d’éléments. Le somatique est-il juste en 25 ? Ou en 25 et 29 (voulant se justifier) ?
(37) I. : regarder ce qu’il y avait avant, et qui est la question du voir et de l’entendre. S’il se lève…c’est qu’avant il était dans l’entendre.
(38) Intervention d’Anne pour donner le cadre technique du découpage.
(Suivent les notes de la lecture proprement dite par le groupe, qui ne sont pas reproduites ici).
2° séance : Relecture de la lecture, un mois plus tard.
Temps de relecture silencieuse du « texte de la lecture ». Première question : découper ce texte, de façon à délimiter le moment du « démarrage » et celui de la « lecture » proprement dite. Sachant que seul le moment du démarrage a fait l’objet d’une analyse lors de cette séance.
(R1) E. La lecture commence à partir de la proposition de découpage. Des hésitations, puis une intervention d’Anne pour donner des précisions. Est-ce que la lecture a commencé après que Anne nous ait éclaircis sur la question d’énonciation et comment se justifier ?
(R2) N. Je verrais le découpage au moment où Anne donne le cadre.
(R3) Q. Les questions que le groupe pose sont déjà là dans ses hésitations.
(R4) N. Il a été difficile de faire un découpage sans entrer dans la lecture.
(R5) P. D’accord : c’est après une lecture de ce qui se passait que l’on a pu faire le découpage.
(R6) AP. On cherche ici les marqueurs énonciatifs. Il y a un temps de lecture et un temps de démarrage. On a bien commencé à lire dans le découpage, mais énonciativement, ce n’est pas pareil. Donc où se situe la distinction ? Regarder pour répondre entre consensus pour faire un découpage et intervention d’Anne.
(R7) F. : Au démarrage, une partie somatique en quelque sorte, on regardait le texte, en regardant les trois niveaux. Mais la figure qui m’apparaît, c’est une figure d’hésitation, c’était la pagaille, on ne savait pas où aller. Et la charnière pourrait alors être l’intervention de Anne.
(R8) J. Je suis assez d’accord. Beaucoup d’interrogations, les acteurs se renvoient les uns des autres, avec une recherche : interrogation, hésitation, sur le découpage. Après, il y a plus proprement une recherche de sens, il n’y a plus d’interrogation.
(R9) AP. Comment peut-on repérer dans le texte qu’il y a basculement ?
(R10) Q. Quand on commence à parler de versets ? On commence à coller au texte. Donc tout de suite après l’intervention de Anne.
(R11) H. Il n’y a pas vraiment de groupe, au début, certains parlent de la méthode, etc. Et après l’intervention de Anne, une alternance plus forte des lecteurs, des références plus précises au texte.
(R12) J. ? « J’ai une hésitation », « Est-ce dans l’énonciation » « Tout à l’heure on s’est fait piéger », « Oui, mais ». Ce pourraient être des marqueurs énonciatifs.
(R13) K. On ne retrouve plus le mot découpage. Anne nous en a débarrassés.
(R14) AP. On a proposé une hypothèse et qui se valide. A partir du moment où on entre dans la lecture, on parle du texte, alors qu’avant, on parle du découpage. Il s’est donc passé quelque chose. Du point de vue de l’énonciation, on voit clairement les différences notamment dans les prises de parole (hésitation, pagaille,…). On peut suivre soit la figure du découpage, soit les figures d’énonciation qui le portent.
(R15) E. Le découpage est quelque chose qu’on aimerait éviter de faire, on le fait parce qu’il faut passer par là. C’est difficile parce qu’il y a des hésitations. Il faut le traverser, mais c’est essentiel pour la lecture.
(R16) AP. Des marqueurs ?
(R17) E. Des hésitations autour du découpage. Puis invitation à revenir au début du texte…
(R18) AP. On invite à partir de la figure du découpage et on parle de l’hésitation.
(R19) J. C’est forcément les deux à la fois. Le découpage est très liée à l’hésitation et réciproquement.
(R20) N. Et peut-être que le découpage est marqué aussi par les phrases en italique.
(R21) H. Dans la première partie, c’est comme si nous devions nous justifier, en écho à la manière dont le texte invite le légiste à se justifier.
(R22) F. Découpage : il y a des questions : pourquoi découpes-tu ainsi ? Interpellation et essai d’explication. Il y a une figure de non maîtrise du découpage.
(R23) AP. On peut interroger une autre figure : regarder le début. « Allez on découpe, en 3D ». Qu’est- ce que ça construit en lien avec la figure de la non-maîtrise ?
(R24) N. Ça rappelle ce que disait H…On cherche à se justifier. « Est-ce qu’on se lance ? » C’est pour justifier ce qu’on a posé au départ.
(R25) G. La question « Qui anime ? »
(R26) AP. Celui qui prend l’initiative du faire… On commence par dire « on va le faire ». Il y a clairement une position d’animation, c’est une position d’énonciation. Et il n’y a pas d’animateur.
(R27) On découpe ». Et qui a autorité pour lancer ça ?
(R28) Q. C’est pour ça qu’il y a eu beaucoup d’hésitation pendant tout ce temps.
(R29) AP. C’est très intéressant de noter que l’acteur qui prend la place d’animation est anonyme, et s’appelle « consensus ». Et beaucoup de monde prend la parole. Il y a nécessité de ce cadre, mais personne ne prend la place. Et la question épistémologique : comment on pose un cadre ?
(R30) F. Le fait est qu’on ne commence à lire qu’à partir du moment où on a une réponse technique sur le découpage.
(R31) Q. Est-ce une réponse technique ? N’est-ce pas aussi une autorisation de démarrer vraiment la lecture ?
(R32) AP. La question est-elle au niveau du savoir-faire technique ? question d’énonciation, la place n’a pas été occupée, mais dès qu’elle est occupée, ça démarre.
(R33) H. « 3D ». Celui qui prend la parole au départ comme animateur, le fait au nom d’une compétence, ça n’a pas forcément aidé, car H. demande : « C’est quoi l’enjeu du découpage ».
(R34) AP. Il y a en effet la question d’une compétence. La performance, il fallait un meneur et il n’y en avait pas. On a donc fait venir les compétences. La compétence s’est cherchée du côté du savoir. Il n’y a pas de destinateur, d’où des hésitations et repli sur le savoir.
(R35) N. Pour aller dans le même sens. Au départ, il n’y a pas d’acteur, consensus, on le voit à plusieurs reprises. A partir de l’intervention d’Anne…
(R36) J. Je ne suis pas sûre de l’appui sur le savoir. Il y a eu proposition, il y en a qui se lancent. Il y a des initiatives.
(R37) G. « Je veux faire… » « Je veux bien faire »… Qu’est-ce que ça veut dire ?
(R38) AP. Il y a une panique au départ, comme pour le légiste : il faut pouvoir faire bien pour avoir la bonne réponse.
(R39) K. La peur venait aussi du fait qu’on nous avait demandé de nous justifier sémiotiquement.
(R40) AP. D’où la figure du savoir : il fallait être juste par rapport à la méthodologie.
(R41) G. On ne peut pas « prendre » le verbal. Je veux bien « faire » l’énoncé… C’est pour ça que ça nous a bloqué. On ne peut pas prendre le verbal, on peut prendre une place d’un acteur.
(R42) AP. Ça pose la question de notre débrayage dans l’acte même où nous étions. C’est comme dans l’histoire de la tempête : où est donc votre foi ? Quand la peur prend la place, c’est qu’il y a un manque de débrayage. La question de justifier sémiotiquement, le groupe l’a entendu quasiment comme une question de cours. Justifier sémiotiquement n’est pas une question de cours, c’est interroger en termes d’énonciation ce qu’on fait et tant pis si on ne sait pas. Cette question aurait pu être celle du légiste : comment poser la parole ? Ou comment avoir la parole sémiotique éternelle. La question était une ouverture sur le méta. Il y a eu une question méta : le méta c’est de se demander sur quel fondement on s’appuie. Or la première position était de dire : on y va. La figure du découpage est importante dans l’animation : comment découper ? Mais la peur nous fait nous précipiter là où on a peur. Si on est dans le faire, tout l’écart entre le somatique et le verbal disparaît.
Démarrer la lecture
Abordons donc le texte de notre lecture et tentons quelques repérages. Dans la reprise avec le groupe, nous avons proposé de commencer par un « découpage » du texte de la lecture sur la base de scènes figuratives23. Ayant affaire à un discours et non pas un récit, nous effectuons le découpage des scènes à partir des figures d’énonciation et non, comme dans un discours, à partir des figures somatiques24.
Le premier travail a été de repérer avec précision le lieu charnière entre le temps du « contrat », c’est-à-dire de la mise en place des conditions de la lecture, et la lecture proprement dite. Un certain nombre de figures ont ainsi été repérées. La figure du « découpage » apparaît de façon récurrente dans les énoncés du groupe (soit par l’emploi du terme ou de verbe apparenté : 1 ; 23 ; 24 ; 26 ; 30 ; 36 ; soit par la mention du repérage des trois niveaux de parole), jusqu’à une intervention de l’animatrice qui « donne le cadre technique du découpage » (38). A partir de ce moment-là, la figure disparaît des énoncés, car le groupe est entré dans l’analyse des figures du texte proprement dit. La figure du « découpage 3D » formait donc un énoncé « méta », le groupe s’interrogeant sur la structure du texte et sur l’opportunité même d’effectuer un découpage. Une énonciation la portait, que le groupe a repérée facilement dans sa relecture : l’hésitation. Une intervention en fait directement mention (10). Cette seconde figure se manifeste de deux façons. D’une part quand le groupe cherche comment découper le texte (9-11 ; 21-34). D’autre part quand il hésite entre deux types de parole : découper, ou s’interroger sur l’opportunité de découper (1-4 ; 30) ? L’irruption, à plusieurs reprises, d’énonciations faisant écart par rapport à celle du groupe, confirmera cette hésitation (3 ; 24 ; 30). Inversement, l’intervention de l’animatrice coupe court à la récurrence de la figure du découpage et transforme l’énonciation du groupe, qui quitte sa position d’hésitation. Nous avons proposé de fixer à cette intervention-là, précisément, la charnière entre la mise en chantier de la lecture et la lecture proprement dite.
D’autres éléments viennent confirmer le repérage de cette charnière. A partir du moment où on entre dans la lecture, les références au texte (Lc 10, 25-37) sont plus nombreuses et plus précises. C’est comme si on était entré véritablement au contact de la « matière figurative » du texte, dans son « soma »25. Ou encore comme si les lecteurs étaient enfin entrés dans le rapport au texte, en s’y investissant : entrer « dans » la lecture dit-on souvent. Un espace est posé, que nous pourrions nommer « espace de la lecture », comparable par métaphore à une cour de récréation. La délimitation de cet espace manquait jusque là, empêchant la lecture de s’engager. Nous pouvons reformuler ainsi notre question concernant le démarrage : sous quel- les conditions l’espace de la lecture est-il créé, et comment les lecteurs y entrent-ils ou l’investissent-ils ? La proposition d’une participante peut nous éclairer : selon elle, tout lecteur éviterait volontiers cette phase de découpage, justement parce que c’est un moment d’hésitation (R15). Autrement dit, l’hésitation provoquerait une sorte de peur, peut-être celle de se perdre dans de l’indécidable, dans une recherche sans réponse ni savoir certain à la clé26 ; ou encore, peur de se noyer dans le texte, voire d’y faire naufrage. Inversement, délimiter un espace de lecture permet d’autoriser à l’intérieur de cet espace un déplacement ludique voire erratique, mais sans crainte de se perdre puisqu’il sera toujours possible de se repérer par rapport aux limites qui auront été déterminées.
Il devient intéressant de constater, si la proposition est juste, que par peur de l’hésitation dans la recherche sur le texte, une autre hésitation se met en place au niveau de l’énonciation de la lecture. Tout se passe comme s’il fallait que le groupe affronte nécessairement cette question au départ : la peur de l’inconnu, de l’égarement, de se retrouver totalement perdu. Dès que cette peur est dépassée, la lecture peut commencer. Bref, un acte de confiance nécessaire, toujours à construire à neuf au début de chaque lecture, de sorte que l’hésitation apparaît finalement comme la figure même de la peur. L’animateur d’un groupe de lecture occupe dans ces conditions une place très significative. Il lui faut parvenir à créer la confiance pour que le groupe puisse commencer à lire. Mais la confiance ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire : « Allez, on lit », ni de trop vite obturer cette peur en donnant immédiatement le cadre de la lecture. On le voit d’ailleurs fort bien dans le texte lui-même de Lc 10, 25-37. Jésus aide le légiste à oser un acte de lecture, mais sans lui donner de façon tranchée les conditions de cette lecture. Il lui retourne son interrogation, effectuant simultanément deux opérations : il ouvre un espace de risque au légiste, et ce faisant il authentifie que celui-ci est bien apte à le faire. Jésus le renvoie au risque nécessaire à prendre pour tout acte de lecture. Et le légiste s’y risque, en effet, et de fort belle manière. L’animateur doit pouvoir repérer ces figures de la peur qui affectent immanquablement le groupe au départ, ne pas s’y laisser emporter lui-même, et aider le groupe, délicatement, à les dépasser par ses propres moyens. Bref, accompagner le groupe dans la gestion de sa propre peur, sans que celle-ci devienne une panique qui paralyse la lecture, mais sans obturer non plus l’espace nécessaire pour gérer cette peur ; ou encore, faire de cette peur un stimulant pour lancer la lecteur, plutôt qu’un frein. C’est donc non par un énoncé mais par son énonciation que l’animateur fondera le croire partagé à partir duquel il sera possible de lire. Nous y reviendrons plus loin dans cet article pour en tenter une première théorisation.
Nous comprenons, à ce point de notre réflexion, qu’un débrayage aurait dû s’amorcer27, mais a été temporairement empêché par l’oubli des consignes énoncées au départ. En se lançant dans le découpage du texte, le groupe aurait pu s’interroger, en assemblée de sémioticiens, sur la signification de ce choix et de ce geste. Cela ne s’est pas fait, d’où un moindre embrayage sur le contrat de départ, qui engageait lui-même un processus de débrayage. Dans ce contexte, la proposition de découpage d’une personne du groupe a provoqué un déplacement. Cette personne, par quelques initiatives, a cherché à lancer la lecture, témoignant par là d’une grande justesse de perception : d’une certaine manière, le groupe avait besoin d’être stimulé ou orienté. La consigne formulée invitait à ce que cette initiative, qui pouvait légitimement être choisie parmi d’autres positions possibles, soit justifiée sémiotiquement. En disant : « ça vaut ce que ça vaut », cette personne manifestait la capacité d’une mise à distance, mais sans toutefois parvenir tout de suite jusqu’à une formulation sémiotique de cette distance (cela viendra dans la relecture, ce qui montrera après coup la capacité du groupe et de chacun de ses membres à débrayer : tout n’est qu’une question d’habitude à prendre). Le groupe est donc, dans ce premier temps, resté au plan de la lecture et n’est pas parvenu à se hisser à un plan méta. Cette position de débrayage intermédiaire a donné au groupe une possibilité d’entrer dans la lecture en oubliant la consigne d’interrogation sémiotique : dès lors, le contrat de départ (justifier sémiotiquement toute affirmation) a disparu derrière un nouveau contrat : lire sémiotiquement le texte.
Au point où nous en sommes, une autre figure d’énonciation prend alors consistance : la figure du consensus. Il s’agit d’un consensus largement partagé, à part quelques interrogations, notamment de H…et de G….Ce consensus semble difficile à interroger par le groupe : serait-ce pour ne pas affronter la peur dont nous parlions plus haut ? H…formule, dans la relecture, une proposition intéressante en indiquant qu’il n’y avait pas vraiment de groupe au départ (R11) : cela suggèrerait qu’un consensus tel que celui que nous avons repéré n’existe que lorsque le groupe qui l’exprime n’est pas encore vraiment constitué. Nous verrons qu’une autre forme du consensus apparaîtra plus tard, ce que l’on peut qualifier sémiotiquement en disant que la figure du consensus, pour le groupe, va subir des déplacements importants et effectuer un véritable parcours figuratif pour aboutir à une reconfiguration.
Mais comment pourrait-on rendre compte de cette évolution ? A titre d’hypothèse, suggérons que cette figure du consensus est en général très étroitement liée à celle de l’entendre développé au sein du groupe28. On peut avancer qu’il n’y avait pas encore de véritable « entente » entre les participants, celle-ci se construisant normalement avec toute lecture. Dans notre expérience, on voit que chacun avance au départ des observations qui signalent des préoccupations propres, comme en témoignent les premières énonciations (R8)29, qui reflètent simplement l’état initial des lecteurs au moment du démarrage. Le consensus peut alors être considéré comme un accord de surface, une identification spontanée des lecteurs entre eux, qui est comme une première manière d’établir un lien dans la lecture. Chaque acteur du groupe n’a pas encore accompli le parcours qui le conduit à s’ajuster aux autres, déplacement qui va de pair avec une reconnaissance de la position unique et originale qu’il ou elle choisit d’occuper dans le groupe pour favoriser la lecture commune. Or ce processus s’affine au cours de la lecture elle-même. Inversement, à mesure que la lecture se déroule, l’attention dans l’entendre que chacun met en œuvre progressivement se manifeste dans la prise en compte par chacun de la parole des autres ; alors apparaissent à la fois des individualités affirmées, plus assurées dans leur positionnement, et une cohérence du groupe par un ajustement réciproque. On pourrait suggérer que le démarrage est l’instauration de cette cohérence de groupe, fruit d’une individuation plus affirmée et d’un accord simultané sur la parole de l’autre. De la sorte, l’entendre et l’accord qu’il autorise engendrent une promesse : chaque lecteur reconnaît dans l’autre la chance d’une ouverture du sens. Le groupe peut alors entamer un chemin, tracer un parcours, un défilé de figures où les signifiants se répondent et s’enchaînent progressivement pour emmener la lecture toujours plus loin30.
Inversement, tant qu’il n’a pas pris le risque d’accueillir les figures comme de purs signifiants désarticulés de leurs signifiés, le groupe n’est pas entré dans la lecture. Immédiatement obturées par du sens dès que distinguées, les figures ne permettent pas aux lecteurs d’établir des parcours de signifiants, et la lecture ne peut pas devenir un chemin. La peur du risque inhérent à la lecture rabat les signifiants figuratifs sur des signes clos. Le service éminent que rend la technique apparaît ainsi en creux : elle initie le débrayage, c’est-à-dire la désarticulation des signes, qui inaugure à son tour la lecture. Elle aide les lecteurs à relativiser leurs univers de signification respectifs, elle leur permet d’oser le risque d’une ouverture du sens, elle les dispose à en envisager des directions nouvelles, et totalement différentes des lieux de sens où ils s’étaient fixés. Les lecteurs peuvent alors lâcher ce qu’ils croyaient fermement posséder et s’ouvrir à la parole mutuelle, dans sa différence. Le groupe n’est plus agrippé de façon fusionnelle à un consensus confortable et chaque lecteur contribue à ouvrir des chemins à la lecture au groupe en trouvant peu à peu une juste place, singulière, unique.
La façon dont la voix du consensus s’est imposée par l’entremise de l’un des participants peut être vue, à titre d’hypothèse, comme la mise en parole de ce qui était latent dans le groupe31. Le consensus n’était certes pas thématisé comme tel, mais il n’en était pas moins repérable dans l’énonciation des participants. Un tel repérage est la condition sine qua non pour que le phénomène puisse être entendu et compris par le groupe, et donc dépassé. Prendre la parole au nom d’un consensus peut oblitérer le risque d’avoir à se lancer dans la lecture et, partant, de se risquer dans la lecture. Mais lorsque, de façon seconde, les paroles de certains participants viennent contester ce consensus non interrogé, un vrai risque est pris dans une audace et une innovation.
Il apparaît alors que les interventions décalées, attribuées à H…et à G…ne pouvaient pas, au départ, être entendues parce qu’elles étaient des interrogations sur les fondements. Elles avaient la fonction de glisser un coin dans le consensus global, car elles étaient elles-mêmes des paroles déjà plus individuées. Une telle interrogation ne pouvait pas ne pas réveiller immédiatement les peurs que doit affronter tout lecteur qui se lance dans le débrayage de la lecture. Ces prises de parole ont donc été inconsciemment32 écartées par le groupe, provoquant par là même sa propre paralysie et freinant l’entrée dans la lecture. L’intervention de l’animatrice, par son énonciation, vient comme poser la conviction qu’il y a bien un fondement quelque part qui autorise le risque de la lecture, même si l’on ne sait pas au premier abord où se trouve ce fondement. En posant ainsi cet acte d’énonciation, elle contribue à faire émerger ce fondement lui-même, qu’il sera possible de reconnaître à la fin du parcours, au moment où les lecteurs s’apercevront qu’ils ont bien abouti quelque part (comme les disciples qui touchent terre aussitôt après que Jésus ait fait taire les vents et les ait interrogé sur le lieu de leur foi).
Ainsi est posée la question du débrayage du groupe dans l’acte même de lecture où les lecteurs étaient situés. En Lc 8, 24, la tempête interroge sur le lieu de la foi : « Où est donc votre foi ? » Quand la peur prend la place, c’est qu’il y a un manque de débrayage. Une consigne avait été donnée au départ, consistant, nous l’avons dit, à justifier sémiotiquement les observations effectuées. Cette consigne destinée à assurer la lecture en la fondant dans la théorie, avait été entendue par le groupe quasiment comme une « question de cours » : une interrogation sur un savoir censé acquis et qu’il fallait vérifier, en termes de « juste » ou « faux ». Mais justifier sémiotiquement d’une observation de lecture n’a rien d’une question de cours. C’est bien plutôt interroger en termes d’énonciation ce qu’un lecteur effectue en lisant, en en faisant une recherche : peu importe que l’on sache ou non, du moment que l’on cherche. La question était une ouverture sur un plan « méta », qui consiste justement à se demander sur quel fondement établir un acte de lecture. Au lieu de cette ouverture sur la dimension « méta » de notre lecture, une exhortation à agir est venue l’obturer : « On y va ! ».
Toute la question du démarrage peut donc être vue du côté d’un nécessaire débrayage, et la tâche de l’animateur consiste à l’amorcer dans les meilleures conditions. Le débrayage autorise l’irruption de ce qui ne pourra jamais être cantonné dans des figures : une énonciation qui les met en discours. Tant qu’il se préoccupe de fournir une « bonne réponse » à la consigne donnée, un sujet n’ouvre aucun espace possible à cette altérité, il se cache derrière une illusoire « bonne réponse », au lieu de se risquer dans une parole (la sienne) qui est mise dans un discours (le sien). C’est une position énonciative. On ne peut prendre la parole de façon juste que si on a été suffisamment débrayé. C’est-à-dire si on a suffisamment, auparavant, opéré un embrayage sur le texte. C’est au fond la peur de se déployer comme sujet qui apparaît là. Elle se manifeste dans un effet de consensus (difficile de faire différence), dans le repliement sur le savoir (difficile de sortir des sentiers battus), dans l’hésitation (difficile de risquer une hypothèse ou d’ouvrir une direction, quelle qu’elle soit), dans le non entendre de la parole qui fait saillie, etc.
La place de l'animateur
Essayons maintenant d’organiser l’ensemble de ces hypothèses, formulées à partir quelques observations et quelques réflexions du groupe, en un parcours cohérent qui tente de rendre compte de la place et du travail de l’animateur33. Ce parcours est organisé autour de quatre moments, articulés logiquement plutôt que chronologiquement.
- 1. Pour lire il faut un débrayage. A l’animateur de trouver le bon dispositif à proposer — il y en a de multiples possibles — et de doser le degré de débrayage que peut supporter le groupe.
- 2. Le débrayage équivaut toujours à une mise en question des fondements, mise en question poussée jusqu’au moment où l’on ne sait plus où trouver un fondement. A ce moment-là seulement quelque chose peut être reçu.
- 3. Ce travail de déconstruction ravive chez les lecteurs une crainte originelle difficile à nommer et à gérer, qui se manifeste cependant toujours d’une manière ou d’une autre. A l’animateur revient de créer les conditions de confiance suffisantes pour que les lecteurs osent ce débrayage et affrontent la peur qu’il peut susciter. Il s’agit donc, parallèlement, de poser un fondement de confiance, ou plutôt de rappeler que cette confiance est déjà posée, déjà donnée, à condition d’apprendre à regarder au bon endroit : le lieu de la foi34.
- 4. Cette confiance vient de ce que les participants sentent que l’animateur leur offre le cadre convenable, qui est bien ajusté à ce que le groupe peut supporter. Chacun de ces moments logiques va être maintenant explicité.
Nécessité du débrayage
Toute lecture nécessite donc d’être menée dans un débrayage, sans lequel aucune avancée ne sera possible. Le prérequis en est un embrayage consistant à ouvrir un espace de disponibilité, de réceptivité, c’est-à-dire à créer un vide pour un accueil35. Ce qui pourrait empêcher la lecture est l’attachement excessif à un savoir, qui se manifeste par une saturation de tous les signifiants proposés par un texte donné sous forme de figures : si l’on sait à l’avance ce que telle ou telle figure doit recouvrir, autrement dit, si l’on dispose déjà d’un signifié pour chaque signifiant, il ne sera plus possible d’envisager en mettre d’autres à la place. Ainsi tout chemin de lecture est inauguré par une désarticulation de cet accrochage.
Il apparaît alors que la méthodologie sémiotique n’est pas avare de moyens pour amorcer ce débrayage. Cela passe, dans la sémiotique énonciative, par la mise en œuvre d’une procédure de découpage tridimensionnel du texte36, comme notre groupe en avait eu l’initiative. Cependant une approche en termes d’analyse figurative (acteurs, espaces et temps), ou d’analyse narrative, ou encore d’analyse énonciative peuvent opérer le même effet. Si l’on se place au plan de la dynamique du séminaire proprement dite, les trois dispositifs que nous avons évoqués au début de notre article37 constituent également chacun des moyens pour amorcer un débrayage. Dans le cas de l’expérience précise que nous relatons ici, c’était le rôle dévolu à la consigne de justifier sémiotiquement les observations effectuées. C’est bien à cela que « sert » le caractère régulé de la pratique sémiotique : offrir des moyens pour amorcer un débrayage.
Tout est ensuite question de choix et de dosage. Question de dosage : étant donnée la puissance d’investigation de la sémiotique, et même de chacune de ses portes d’entrée, il est la plupart du temps impossible de mettre en œuvre l’intégralité de l’arsenal méthodologique. La lecture serait quasiment infinie38, et tel n’est pas non plus l’objectif des groupes. Un premier dosage s’effectuera donc dans le choix des portes d’entrée envisagées. Un second dosage consistera alors à considérer jusqu’où il s’avèrerait opportun de mener l’investigation, une fois telle ou telle porte choisie. On peut en effet pousser plus ou moins loin l’analyse, et selon une durée plus ou moins longue. Par exemple, le découpage par lequel on commence la lecture des textes peut n’être opéré que selon les grandes divisions du texte ou au contraire dans le détail ; il peut prendre quelques minutes au début de la lecture, voire avoir été préparé par l’animateur et donner lieu à la distribution d’un document de travail, ou au contraire être mené intégralement par le groupe et prendre la moitié de la séance, etc. Question de choix ensuite : savoir déterminer quelle sera la bonne porte d’entrée pour tel groupe, en fonction de ses membres, de son histoire, de son expérience de la lecture sémiotique, etc39
Ce premier aspect suppose, du côté du groupe et de ses lecteurs, une liberté et une confiance premières au moment de la prise de parole : oser parler, sans toujours savoir ce que l’on dit, est une façon de permettre à l’animateur de disposer des éléments suffisants pour établir le « diagnostic » du groupe et s’ajuster à lui. Du côté de l’animateur, cela suppose qu’il soit capable d’un ajustement au groupe, c’est-à-dire qu’il sache identifier, discerner une porte d’entrée opératoire, une bonne durée pour l’investigation, etc. Cette figure de l’ajustement reviendra un peu plus loin dans notre réflexion lorsque nous parlerons de la confiance. Dans le cas de notre groupe, dans sa lecture proprement dite, la proposition de découpage « 3D » faisait écho à un autre séminaire, méthodologique celui-là, et manifestait le besoin de mettre en œuvre un savoir faire acquis peu avant et qui restait de ce fait à tester. Le risque était alors de réaliser l’opération inverse à celle recherchée : s’intéresser à un savoir plutôt que s’en délester. En ce cas, la conséquence peut être un moindre ajustement à ce qui est réellement nécessaire au groupe pour correctement amorcer le travail du débrayage.
Une remise en question des fondements
Évoquons maintenant le travail du débrayage que doit effectuer tout lecteur, quel que soit le niveau où se situe sa lecture. Pour lire sémiotiquement, il lui revient de s’ajuster autant qu’il lui est possible au texte et, pour ce faire, d’abandonner au moins temporairement ses propres savoirs, auxquels il est attaché sans toujours s’en apercevoir : du côté du lecteur, il s’agit du savoir sur le texte et ses figures ; du côté de l’animateur, il s’agit du savoir méthodologique mais aussi, parfois, des conclusions issues d’une préparation de la lecture. Cet abandon est toujours une opération délicate et souvent douloureuse40, et c’est pourquoi elle mérite une attention particulière. Mais au fait, pourquoi ce débrayage est-il si difficile à réaliser ? Ce qui s’est passé dans notre groupe nous permet de nous en faire une certaine idée.
Rappelons que la consigne consistait à interroger systématiquement les raisons d’avancer telle ou telle observation sémiotique dans le texte. Cette interrogation portait à la fois sur le savoir mis en œuvre (est-ce bien telle ou telle figure ? est-ce bien telle ou telle étape d’un PN ? est-ce bien un énoncé somatique ?), sur le déroulement ou le processus de l’analyse (est-ce bien le bon moment pour avancer telle ou telle observation ?) et sur le sujet lui-même (suis-je suffisamment compétent pour pouvoir avancer ce que j’avance ?). Cette consigne produit ainsi un questionnement tous azimuts, qui sape peu à peu la confiance excessive que le lecteur aurait pu avoir dans ses assurances préalables41. La consigne donnée, lorsqu’elle est appliquée, conduit les participants du groupe à s’apercevoir que le fondement sur lequel appuyer l’assurance d’une lecture ne se situe pas au niveau où ils le pensent : en un savoir dans lequel l’on peut sans cesse et toujours plus profondément puiser. Mais alors, sur quel fondement faire reposer la lecture ?
Telle quelle, la consigne donnée n’implique pas le surgissement de cette question et ne conduit pas par elle-même à douter du fondement. Mais il se trouve qu’en chaque lecteur existe la potentialité de l’accueillir du côté du doute : ceci ressemble aux disciples chez qui la peur jaillit lorsqu’ils voient la tempête (Lc 8, 24). Elle constitue donc une possibilité sans être une nécessité, et c’est à chaque lecteur de voir s’il y adhère ou non. S’il se laisse saisir par cette peur, s’il fixe son regard sur le doute qu’il voit surgir, alors il s’aperçoit que, en effet, au-delà des pseudo-fondements du savoir42 qui ont été soigneusement retirés, s’ouvre une béance, un vide apparent de fondement, en l’absence de toute forme de savoir. A regarder ainsi cette béance ne peut manquer de surgir une profonde panique, à l’image de celle des disciples. Ainsi, ce qui semble inévitablement suscité par l’exercice du débrayage est la mise en question des fondements, ce qui situe la difficulté à un autre niveau de profondeur qu’une simple mise en œuvre méthodologique.
Une telle remise en question des fondements est nécessaire et même vitale, comme déjà signalé plus haut. Du côté du lecteur, elle conduit à un embrayage qui le rend apte à recevoir autre chose qu’il ne prévoyait pas. Le lecteur ne cherche plus à se fournir à lui-même le socle dont il a besoin, mais reçoit à la manière d’un don le fondement sur lequel il pourra ériger sa parole. Or ce don s’effectue au sein d’une relation, à l’initiative d’un Autre qui donne à qui il veut, où et quand il le veut bien. La réceptivité du lecteur va de pair avec une départie de sa propre maîtrise sur les choses, aventure d’une remise à l’Autre dans la confiance incertaine que le don sera en effet attribué. Pour y parvenir, il lui faut débrayer d’un savoir non sémiotique (un savoir référentiel), pour embrayer, justement, sur un savoir sémiotique. Du côté de l’animateur, il y a également un débrayage à vivre en tant qu’il est lecteur, puisqu’il est lecteur du groupe, mais il faut inversement débrayer d’un savoir sémiotique pour ne pas gêner les lecteurs. Sa position est donc très exigeante, car il risque sa parole en temps réel.
Ainsi, dans les deux cas, interroger les fondements, ce n’est pas rechercher le point ultime sur lequel on va pouvoir (se) construire en toute sécurité, comme si ce fondement était extérieur et qu’il suffisait de l’identifier. Le fondement se donne, il n’est jamais assuré. Il s’agit plutôt d’effectuer l’opération toujours à renouveler qui consiste à interroger les présupposés qui, en nous, forment perpétuellement une résistance dont il faut se délester. Interroger par une question située en position méta, c’est refuser les fausses évidences, creuser jusqu’où il n’y a plus moyen de trouver une assurance par soi-même. C’est aller jusqu’au lieu où seul un « croire sans objet »43 nous fait avancer en confiance, et noue le contrat de lecture : « Il y a une parole à entendre»44. La sémiotique place tout lecteur dans le continuel travail d’embrayage / débrayage, et de renoncement à toute possession, toute maîtrise sur le sens : il n’existe aucun moyen d’y accéder à coup sûr. Pour pouvoir commencer à lire, il est nécessaire d’accepter par avance ce lâcher-prise, mais aussi et surtout qu’il soit accepté de concert par les membres du groupe. Il n’y a donc pas de fondement massif, il n’y a que la fragilité d’une parole qui appelle et qui cherche à se faire entendre. Le travail du commencement consiste à faire en sorte qu’un consensus se dégage sur la confiance que les lecteurs se font les uns aux autres : « Nous parviendrons sans aucun doute sur l’autre rive45 ». C’est un consensus inverse de celui qui s’accorde sur des évidences non critiquées et renonce à s’interroger : dans ce consensus-là chacun trouve une place avec sa spécificité, et peut faire le point sur sa propre peur d’avancer. Un tel consensus s’appelle « communion ».
Ainsi, la communion consiste, d’une part, à reconnaître un fondement ultime et permanent, toujours donné, au-delà de tous les pseudo-fondements que l’on se donne toujours à soi-même pour se rassurer ; d’autre part, à établir un accord sur une reconnaissance commune de ce fondement, base préalable au contrat de la lecture. Vu sous cet angle, le travail du débrayage est un déblayage de tous les fondements que l’on se donne et qui empêchent de voir le véritable fondement, toujours présent, qui fonde depuis toujours la parole qui s’échange entre des sujets.
De la peur à la confiance fondamentale
L’on s’aperçoit alors que cet abandon d’une quelconque prise sur les fondements va de pair avec la peur profonde que provoque le sentiment de ne reposer sur rien. Elle ne se manifeste pas en surface, les comportements des lecteurs et leurs paroles restent policés. Mais elle cherche les chemins de son expression, et elle les trouve en se glissant dans l’énonciation des participants, c’est-à-dire dans la manière dont ils arrangent, organisent les figures de leur discours, généralement puisées dans le réservoir de figures que constitue le texte biblique lui-même. Cette peur s’exprime d’une manière ou d’une autre, et le travail de la relecture consiste précisément à en effectuer le repérage. Du côté des lecteurs, la peur pourra s’exprimer par du silence46, ou inversement par un excès dans la manifestation du savoir. Du côté des animateurs, elle pourra se manifester par une trop grande réserve dans les interventions qui lui reviennent, ou inversement par la tentation d’une prise de pouvoir sur le groupe. Plus généralement, pour un animateur, la peur peut s’indique dans la manière dont il prend les rênes de la lecture. Ainsi le savoir sur le texte (aspect encyclopédique, utile et bénéfique en soi) autant que le savoir faire dans la lecture (aspect méthodologique, tout aussi utile et bénéfique), peuvent-ils se subordonner l’animation d’un groupe plutôt que se mettre à son service : un animateur devra donc toujours se demander l’usage qu’il fait de son savoir et de son savoir faire, en soi légitimes. Serait-ce que la lecture doit être lancée sur la foi d’un évidement, d’une dépression inaugurale (au sens météorologique du terme), d’un déséquilibre initial qui seul permet de lancer un mouvement ? Le savoir et la méthodologie, posés à leur juste place, viennent alors provoquer et alimenter ce mouvement. C’est cette alternative qui est révélée par le commencement du groupe, et qui se présente à tout commencement.
Mais si cette peur cherche les chemins d’une expression, cela signifie qu’il est important de lui permettre de le faire. Il convient de faire ce qui est nécessaire pour que des mots puissent être posés. Tant qu’elle reste insue, elle garde son pouvoir nocif en travaillant les lecteurs de façon souterraine, leur donnant à regarder en priorité le vide et donc leur propre doute. Mais si elle est parlée, il n’y a plus rien à en craindre. Pour les lecteurs en général, cela se manifeste par la capacité à affronter sereinement le nécessaire passage par une suspension du sens : l’absence de sens ne signifie pas sa perte définitive, mais la promesse de son renouvellement. Quant aux animateurs, considérés comme des lecteurs du groupe, cette suspension provisoire du sens touche plus directement le chemin qu’ils voient faire au groupe. L’affronter signifie ne pas craindre les errances éventuelles du groupe, et tenir dans l’assurance que, à un moment ou à un autre, le groupe parviendra à construire une signification réjouissante. Les animateurs doivent donc disposer de leurs propres fondements, ne pas s’effrayer devant ce qui, pour eux, pourrait prendre l’apparence du vide : la difficulté pour le groupe de construire un chemin de signification. Aussi partent-ils du pari selon lequel tout peut advenir au sens et que donc rien de ce qui peut être dit, ni rien de la manière dont cela est dit n’est susceptible de les dérouter. Cette confiance fondamentale de l’animateur en la vie du sens, en sa donation généreuse même incontrôlable, peut contribuer à faire émerger la confiance au sein du groupe.
Tel est donc le pari qui préside à la lecture : une confiance fondamentale, native même, a déjà été accordée et précède et le groupe et l’animateur. La confiance ne saurait se trouver en quelque objet que ce soit, que chaque membre d’un groupe identifie souvent à un savoir préalable sur le texte, et que l’animateur cherchera plutôt dans une méthode en tant que technique garantissant un résultat. Pour tous, elle ne repose sur rien de tout cela, et c’est précisément la raison d’être du débrayage : un abandon de tous ces objets qui encombrent l’espace nécessaire à une vraie confiance. Car la seule confiance ne tient que sur une parole entendue : « Crois seulement »47. Cette parole peut s’entendre diversement. Du côté du lecteur, celui-ci peut l’entendre à partir du texte lu par le groupe, mais aussi dans la parole de l’animateur qui, ayant parcouru le chemin, sait que de la vie surgit toujours de l’aventure de la lecture. Du côté de l’animateur, cette parole ne repose pas elle-même sur une confiance en soi et en sa compétence, nouvel objet qui sature l’espace de la parole. La parole qui fonde la confiance s’entend également au travers du texte mais, à la différence des lecteurs qu’il accompagne, l’animateur ne se saisit plus des figures du texte, mais s’appuie sur le fait même qu’il y a un texte et que ce texte ne provient pas de n’importe où. Issu d’une tradition précise, il cristallise une expérience de foi vécue par d’autres avant lui, et dont son écriture témoigne. Par ailleurs, la confiance de l’animateur s’appuie sur l’appareillage de la sémiotique, non plus en tant que technique infaillible, mais en tant qu’opérateur assuré de débrayage, elle-même inspirée dans son mouvement par la Parole à laquelle elle s’accorde. Enfin, l’animateur fait reposer sa confiance sur le groupe48, en tant qu’espace de circulation de la parole au sein duquel, par la régulation réciproque et la reconnaissance communément partagée de l’irruption de l’Autre, du fruit vient à surgir immanquablement et à être partagé (distribué) pour que chacun ait sa part. Fort de tous ces appuis, l’animateur a pour rôle essentiel de rappeler aux participants que la foi49 est première et qu’ils peuvent donc sans crainte prendre la mer.
Il nous est maintenant possible de déplacer la question : comment, en tant qu’animateur, parvenir à être suffisamment débrayé pour ne pas être effrayé par les manifestations du débrayage non encore totalement abouti du groupe ? On pourrait répondre : en ne se situant pas au centre. Comme Jésus, l’animateur sème50, et il n’a pas à se préoccuper de la façon dont peut être perçue son animation, sauf à opérer un retour narcissique sur lui-même. Il s’agit plutôt de faire, des lecteurs qu’il accompagne, le centre de son attention. Il lui revient d’être attentif à la manière dont chacun dans le groupe, lecteur comme animateur, entend chacun des autres dans le groupe (« Prenez garde à la manière dont vous entendez », dit Jésus à ses disciples, Lc 8, 18). L’objectif n’est pas de changer l’autre, ni de le juger. Jésus ne fait qu’entendre comment ses interlocuteurs entendent, figures d’énonciation non thématisées que Jésus porte à la manifestation dans ses énoncés, à l’intention de ses auditeurs. Il revient uniquement à l’animateur d’être au service de la parole, en se rappelant que la force de la parole ne tient pas à lui.
La confiance fondamentale est donc issue d’un jeu de renvois qui s’articulent tous sur une Parole et non pas sur quelque objet que ce soit. La tâche de l’animateur est de faire en sorte que soit toujours respectée cette circularité ternaire, pour le groupe et pour lui-même. Il lui revient de référer à une Parole déjà délivrée, à une confiance déjà assurée et non pas à reconstruire de toutes pièces. Le choix qui est le nôtre de commencer le plus souvent notre lecture par un « découpage 3D » du texte, et donc de repérer les différents niveaux de parole qui structurent le texte, correspond à cette primauté accordée à la parole et a pour fonction de le signifier aux lecteurs, de façon plus ou moins thématisée51.
Le cadre qui signifie cette confiance
Il reste que cette confiance fondamentale doit être manifestée concrètement par des dispositifs précis, qui ne portent pas à eux seuls cette confiance, mais en sont les signifiants dans et pour le groupe. Ce cadre comporte au moins deux éléments, qui jouent chacun une fonction en vue de l’établissement de cette confiance.
Les consignes
Elles servent à délimiter l’espace de lecture, la « cour de récréation » dans laquelle va se déployer l’activité exploratoire du groupe. Elles lui sont énoncées clairement dès le départ. Une fois énoncées, elles constituent un repère vers lequel se tourner en cas de tourmente. Elles reviennent à énoncer : « Allons à l’autre rive ». Une fois cela énoncé, est signifié le fait qu’on parviendra bien sur une autre rive, quelles que soient les tempêtes qui surviennent. En suite de quoi, il est et il sera toujours de la liberté du groupe de suivre ou non ces consignes, de les transgresser à sa guise. Cela n’enlèvera jamais le fait qu’elles ont été énoncées.
Leur transgression peut être une façon de fuir l’étape nécessaire du débrayage, par peur d’affronter la mise en question des fondements. Ce faisant, le groupe se coupe précisément de ce qui fait son fondement essentiel, à savoir la parole énoncée dans les consignes, et son énonciation qui pose la confiance. Et croyant échapper à l’épreuve, il s’y trouve affronté de plus belle, et se voit contraint de la traverser dans des conditions moins confortables : au lieu que l’épreuve, nécessaire, soit vécue dans la confiance du terme, elle l’est dans la panique de la perte des repères. Mais même cela peut être repris et rendu signifiant. Quand l’animateur l’estime bon, c’est-à-dire quand le groupe en panique le « réveille52 », son intervention qui rappelle le cadre vient faire taire la tempête. Il est alors possible d’interroger cet acte de fuite initial, ce qui ouvre un chemin de signification : si le groupe a choisi de transgresser à ce moment-là et de cette façon-là, c’est que quelque chose d’important devait être vécu par lui. L’animateur aide ainsi le groupe à se ressaisir de ce qui s’est passé, comme Jésus interroge ses disciples : « Où est votre foi ? ». Ce n’est pas un reproche, mais une interpellation salutaire qui réoriente le regard vers l’espace préalablement délimité, à savoir le repère fondamental donnée par et dans une parole. Comme Jésus (Lc 8, 23), l’animateur peut sereinement « dormir » et laisser le groupe aller où bon lui semble en lui laissant totalement les rênes. Ce n’est qu’en cas de nécessité ou d’urgence, et parce que sollicité, « réveillé » par le groupe, qu’il peut intervenir pour remettre paisiblement les choses à leur place. L’animateur parie sur la capacité des lecteurs de s’apercevoir eux-mêmes, à partir d’une simple parole qui remet en ordre, la signification de leur transgression. Dans le meilleur des cas, qui n’est pas le moins fréquent, le groupe parvient à donner sens lui-même à ce qui s’est passé pour lui. Le texte de la relecture présenté ci-dessus montre que le groupe a réussi à amorcer une élaboration de qualité, sans même que les animateurs lui livrent leurs propres hypothèses de travail. A l’animateur il suffit alors d’être simplement présent, témoin d’une Parole qui circule au-delà de toute maîtrise de sa part, et néanmoins pas sans lui53.
L’énonciation de l’animateur, ou l’animateur comme cadre.
Nous en venons à constater qu’au fond, le cadre est constitué par l’animateur lui-même, dans son énonciation, en tant qu’il se pose comme sujet. Et cette énonciation peut permettre des choses ou les empêcher : soit l’animateur se réfugie dans toutes sortes de savoir, soit il se fie à sa capacité à être embrayé / débrayé. Et en cela, on peut regarder la position de Jésus vis-à-vis du légiste : sa propre personne n’a strictement rien à voir dans le problème. Il ne cesse d’être présent au parcours du légiste pour lui faire faire un chemin. Dans cette attention de l’autre, dans la profonde conviction que la parole elle-même — et non une compétence — garantit la qualité d’une lecture, l’animateur trouvera l’appui d’une énonciation juste54. Ainsi Jésus lui-même, face au légiste qui le met à l’épreuve, le renvoie à la parole et n’énonce aucun savoir en tant que maître : il ne se pose pas comme tel mais se met à son service.
Conclusion : retour sur le dispositif du séminaire et sur la position de ses animateurs
Suggérons, pour achever notre parcours, que le dispositif du séminaire, avec la particularité qui est la sienne, ne fait rien d’autre que mettre en œuvre pour les participants ce qui est requis de ceux-ci lorsqu’ils sont animateurs. Plus encore, l’on peut envisager que tout ce que nous avons dit pour les lecteurs et animateurs au long de cet article vaut également, et à plus forte raison, pour les animateurs du séminaire eux-mêmes. Ainsi leur position n’est-elle pas de « donner des leçons » à ceux qu’ils tâchent de former, mais d’accepter de traverser pour eux-mêmes les défis que les animateurs, en général, doivent affronter, afin d’apprendre à les nommer : condition sine qua non pour accompagner d’autres sur le même chemin de la découverte des joies de l’animation. La différence tiendrait peut-être que les animateurs du séminaire travaillent sans filet, et cette situation conduit à envisager un dispositif particulièrement fécond pour aborder ce type de défi : le travail en co-animation. On peut alors en revenir aux deux premiers éléments mentionnés par la partie précédente de ce parcours : nécessité du débrayage et remise en question des fondements.
La nécessité du débrayage
Notre procédure de formation suppose un triple débrayage spatial, actoriel et temporel. Spatial : ce n’est pas le texte de l’évangile qui définit l’espace de lecture, mais un texte second, celui de la relecture ; actoriel : ce ne sont plus les mêmes acteurs qui prennent la parole ; ceux qui étaient lecteurs un moment donné ne sont plus désormais que des « acteurs en papier », bien éloignés des lecteurs « seconds » qui, désormais, les appréhendent ; temporel : un délai important est posé entre la première lecture et la relecture. Ce triple débrayage est posé par le cadre du séminaire, parce qu’il ne serait pas facile à effectuer spontanément sinon. Il est en effet à ce point difficile d’effectuer un tel débrayage, notre parole semble tellement accrochée à nous-même, que tout dispositif qui semblerait la toucher de trop près nous met immédiatement en danger. Inversement une pratique régulière agit, à la manière d’un exercice55, comme un lieu d’entraînement à l’embrayage et au débrayage. Les animateurs du séminaire ne sont pas dispensés de la pratique régulière de cet exercice : ils sont logés, bien sûr, logés à la même enseigne que quiconque. Ils ne peuvent même pas revendiquer s’y mouvoir plus à l’aise que ceux qu’ils forment. Pour avoir à tenter d’y guider autrui, ils ont simplement davantage conscience de la difficulté de l’entreprise…
Si toute lecture sémiotique suppose l’exercice permanent du débrayage, les animateurs du séminaire s’y livrent d’une manière particulière. Il leur revient en effet de jongler en permanence entre les différents niveaux de lecture et les différentes formes de débrayage qui les caractérise56 : au plan de la lecture, au méta-plan de la méthode, et au méta-méta-plan des conditions dans lesquelles nous allons questionner la pratique réglée de la lecture sémiotique elle-même. Interrogation toujours plus profonde, elle demande de cibler le niveau acceptable d’interrogation pour les participants : c’est aux animateurs du séminaire de proposer un dispositif tel, de façon suffisamment rigoureuse et adaptée aux participants du séminaire pour que ceux-ci puissent envisager un débrayage. Ces derniers peuvent le faire à la mesure du chemin parcouru autour de la question des fondements. Quant aux animateurs du séminaire, ils ont eux-mêmes à faire, et à refaire sans cesse l’exercice d’une interrogation de leurs propres fondements et accepté d’entendre une parole les assurer : « Crois seulement ».
Provoquer ainsi un tel débrayage suppose d’envisager, en deçà de la scène de la lecture et la fondant, la position logique d’une instance d’énonciation qui préside au débrayage du dire. C’est à cette instance d’énonciation que l’on peut référer une sorte de contrat de base en forme de « crois seulement ». Cela pose les animateurs, de groupes de lecture comme de séminaires de formation, comme destinateurs délégués (ils sont donc destinateurs…mais pas plus que délégués). Ils ont la charge de poser et d’assumer le cadre au nom d’un Autre, et non pas en leur nom propre. C’est ce qui est exprimé au groupe lorsque nous lui rappelons que nous travaillons pour que la Parole circule jusqu’à ceux qui se trouveront dans les groupes que chacun anime ou animera. Ce ne sont donc pas les personnes des animateurs en tant que telles qui sont en jeu, mais la Parole d’un Autre pour des autres. Pour ce projet, il faut apprendre à se déprendre de soi-même.
Nous proposons de ne pas regarder le débrayage à partir de ce qu’on lâche mais à partir de ce qui est visé par lui. Il s’agit de viser un moindre inajustement sur cette instance d’énonciation. Le débrayage est fondamental parce qu’il nous permet d’accéder à notre désir, qui est d’être posé avec d’autres sur la trajectoire de la parole : telle est la position ajustée pour traverser. Énoncer qu’il s’agit de « croire seulement », c’est envisager les choses depuis la fin, au double sens du mot. L’assurance est donnée qu’un destinateur, un Autre, envisage le projet du point de vue de son accomplissement assuré, sans pour autant que cette perspective ne retire quoi que ce soit à la liberté des sujets ni aux aléas du chemin qu’ils vont emprunter. L’on pourra alors regarder devant avec l’assurance de parvenir sur l’autre rive, quelles que soient les tempêtes traversées : il est possible de compter sur la réussite a priori du parcours de lecture. Un « Réel » nous précède, nous attend, et nous fait confiance pour y parvenir. Cela suffit pour nous convaincre d’oser la traversée.
Une remise en question des fondements
Pour l’animateur du séminaire, une question similaire se pose et l’oblige également à faire face à la même épreuve, même si c’est à un niveau méta. Pour lui, cela pourrait s’énoncer ainsi : la proposition formulée aux participants d’effectuer, avec les risques que cela comporte, le parcours du séminaire, va-t-elle fonctionner ? Ne va-t-elle pas provoquer de la « casse », des réactions de la part des participants telles que tout le travail va s’arrêter ? Est-il légitime de jouer ainsi avec les couches profondes des sujets qui viennent avec confiance ? Et si quelque chose dérapait ? L’animateur n’aurait-il pas une responsabilité écrasante dans l’échec prévisible de la séance ? L’animateur de séminaire sent souvent qu’il « joue avec le feu », et s’interroge légitimement sur son droit à le faire.
Si l’essentiel est le débrayage proposé par les animateurs, l’on voit alors qu’il n’est pas nécessaire de se crisper sur une proposition de chemin définitive et absolue. Ainsi notre propre dispositif a considérablement évolué à mesure de sa mise en œuvre et continuera à le faire. De la même façon, plusieurs dispositifs distincts ont été envisagés, tour à tour mis en œuvre, qui provoquent différentes formes de débrayage pour les participants au séminaire. L’on s’aperçoit à l’usage que tous les participants n’y entrent pas tous de la même manière, ce qui est fort logique et normal, mais qu’ils se complètent assez heureusement.
Dans la séance étudiée ici, il y a eu l’intervention de l’animatrice : « pour qu’ils puissent lire ». Les participants éprouvaient un peu de peine à entrer dans la lecture, risquaient de s’égarer dans la technique : l’intervention débrayée de l’animatrice a permis de reprendre le chemin. Un tel débrayage n’a été possible qu’au prix de la reconnaissance d’une peur spécifique à dépasser : « la peur d’être un sujet », un sujet à mains nues, un sujet sans cuirasse, exposé à tous les coups. D’où la question dans la consigne : « Où fondez-vous votre position de sujet ? ». Inversement, l’animateur du séminaire sait que son propre débrayage est réussi lorsque le groupe lui-même peut prendre les rênes et se lancer pour son propre compte dans la recherche du sens. La relecture a été pour le groupe ce moment où, s’appropriant son histoire et cherchant à lui donner sens, il s’est risqué à une lecture neuve et originale. Il ne reste aux animateurs du séminaire qu’à en recueillir les fruits avec reconnaissance et admiration.
Anne PENICAUD et Olivier ROBIN
- Ceci nous donne l’occasion de remercier le groupe qui s’est prêté à l’expérience et dont la perspicacité, dans la lecture et la relecture, nous a permis de progresser dans la mise au jour des enjeux dont nous allons parler.
- Les deux autres formes proposent aux participants soit d’animer un temps de lecture « en direct » au sein même du groupe soit de relater une expérience de lecture vécue lors d’une animation de groupe. Dans ces deux derniers cas, une relecture et une analyse sont effectuées selon des modalités proches de celles exposées ici. Nous aurons l’occasion d’y faire allusion dans de prochains articles de Sémiotique & Bible.
- Au sens fort et ancien du mot « gymnastique ». Cette capacité à se situer ainsi simultanément sur deux plans fait fond sur la capacité du sujet humain à accepter un certain clivage, dont le prix à payer est un réel inconfort : il faut sans arrêt se demander où l’on se situe, et parfois l’on peut s’y perdre. Mais l’habileté venant, c’est une aide précieuse pour l’animation de groupes de lecture.
- Nous parlons ici d’embrayage par analogie avec l’emploi de ce terme par Greimas. L’embrayage consiste pour un lecteur à se poser dans une position énonciative d’entendement sémiotique qui lui permet d’accueillir les parcours figuratifs (d’un texte ou de ses lecteurs) et de se laisser guider par eux.
- L’embrayage a en effet pour réciproque un débrayage qui qualifie cette fois une position de dire. Nous y reviendrons.
- Ce discernement est en rapport direct avec le projet que nous associons à l’animation d’un groupe : il ne s’agit pas, à notre sens, de « faire » lire un texte au groupe, mais d’accompagner le groupe lisant, ce qui requiert de l’animateur la capacité à lire la lecture du groupe. Ce projet est clairement énoncé aux membres du séminaire, et a pour conséquence que le séminaire ne se préoccupe pas prioritairement de lire des textes, mais de s’appuyer sur cette lecture pour apprendre à animer.
- Les textes ne sont pas pour autant des faire-valoir de notre travail d’élaboration. Ils présentent la vertu de nous fournir eux-mêmes des modèles pertinents pour penser ce qui se passe dans l’animation. C’est pourquoi, dans ces pages, nous évoquerons fréquemment tel ou tel passage scripturaire, en contrepoint (et non pas seulement en illustration) de nos propos. Nous évoquerons bien sûr Lc 10, 25-37, travaillé pour l’occasion, mais aussi d’autres textes géographiquement proches dans l’évangile selon Luc, notamment au chapitre 8, qui entrent en écho avec notre réflexion. Le recours à plusieurs textes alourdira un peu notre discours, mais il nous a semblé que l’enjeu en valait la peine.
- Cette parole, à nos yeux, se réfère explicitement à la Parole de Dieu. Dans les groupes que nous animons, il ne s’agit pas de privilégier une lecture savante, mais une lecture en vue de l’avancée des lecteurs sur un chemin de foi (ainsi que nous l’avons signalé dès les premières lignes de l’article), ce terme de « foi » recevant sens en fonction de la situation propre de chaque lecteur.
- La méthodologie sémiotique intervient ici comme un prérequis. En effet une animation de lecture sémiotique semble difficile à concevoir en dehors d’une compétence technique préalable. Cependant il ne s’agit pas non plus de transformer cette compétence en un carcan pour la lecture : elle se met à son service en la soutenant.
- Ce terme n’a rien de technique, mais il exprime justement une forme de renoncement dans la maîtrise de tous les paramètres qui conditionnent la lecture, autant du côté des lecteurs que des animateurs.
- Voir ci-dessus, note 6.
- Il pourrait, dans certains cas, s’avérer dangereux de mettre en lumière de façon trop brutale ces affects : nous ne savons jamais à l’avance comment les lecteurs — ni leurs animateurs — pourraient en recevoir la mise au jour ou la manifestation.
- C’est une manière de reconnaître l’impossibilité de retourner à un « référentiel », à la chose même à l’origine de ce texte. Ainsi, argumenter indéfiniment sur ce qui a pu réellement être dit est une façon de tomber dans le piège de l’illusion du référentiel et d’éviter le débrayage.
- Le terme de débrayage est employé ici avec deux acceptions. La première acception, purement technique, désigne simplement la production d’énoncés (c’est le sens greimassien du terme). La seconde acception caractérise la position des sujets dans le dire : en l’occurrence elle caractérise le dire qu’ils déploient pour commenter le « texte » lu. Dans cette acception le terme de « débrayage » désigne la distance intervenue dans le dire des sujets vis-à-vis du texte qu’ils lisent. En l’occurrence ce débrayage, fondé sur l’embrayage porté par la lecture, est d’autant plus nécessaire et plus difficile à mettre en place que le texte lu est un dire antérieur desdits lecteurs…
- Les productions imaginaires dont nous venons de parler ne sont pas par elles-mêmes négatives ni foncièrement mauvaises. L’imaginaire peut aussi être vu comme la source d’intuitions qui pourront conduire à l’élaboration d’hypothèses fécondes. Il s’agit simplement de le réguler.
- Bien entendu, la figure de la fin est une figure toujours inaccessible, et dire que nous lisons à partir de la fin peut paraître une gageure. Cependant n’est pas question de dire que nous connaissons déjà la fin, mais que celle- ci se manifeste dans le mouvement même qui nous entraîne ailleurs. Il s’agit donc d’apprendre à lire ce mouvement dans nos figures du présent. Nous évoquerons de nouveau cette figure au terme de notre article.
- Tout texte est l’aboutissement d’une énonciation et lire consiste donc à se situer à ce point-là. Cette approche, exprimée ici en termes strictement épistémologiques, présente l’avantage d’être cohérente avec la perspective biblique qui est thématisée dans les Ecritures par le recours au terme de « salut ». Il s’agit d’une structure de signification commune : une histoire (qu’elle soit sainte ou non) ne prend tout son sens qu’à partir de son aboutissement, lequel avait fait auparavant l’objet d’une promesse ; de la même façon, des signifiants ne prennent sens qu’à partir du signifié attendu lorsqu’on en observe l’enchaînement.
- On reconnaîtra dans ces lignes une libre adaptation de la problématique de la mise en discours, élaborée par les sémioticiens du CADIR, en tant qu’inscrivant les figures dans une chaîne signifiante renvoyant à un signifié toujours absent et toujours reporté ailleurs dès que semblant avoir été touché. Voir à ce propos les différents textes de Jean Calloud, Jean Delorme, François Martin, Louis Panier et Jean-Claude Giroud.
- Les structures énoncées sont portées par l’examen des énoncés du texte lu. Les structures énonciatives sont construites par la parole du groupe qui lit ce texte. L’un des enjeux de l’exercice auquel nous nous livrons est de faire apparaître l’écho qui intervient entre les deux types de structures.
- En effet la pratique et la théorie de la lecture que nous mettons en œuvre se réclament d’un cadre énonciatif positionné autrement que celui de la sémiotique figurative. Cette différence tient à une intégration de l’énonciation dans le champ de l’analyse sémiotique. Voir à ce propos les articles respectifs de Louis Panier et Anne Pénicaud dans le numéro précédent, 132, de la revue Sémiotique et Bible.
- Les initiales qui désignent les participants sont donc des initiales fictives. Seuls les noms des animateurs du groupe (OR, AP) ont été désignés de façon clairement identifiable, en raison de leur fonction d’animateurs. En l’occurrence seule AP est intervenue dans la discussion : OR, absent de France et connecté par Internet y participait, mais en position d’écoute.
- La pratique énonciative de la sémiotique se fonde, par différence avec une pratique figurative, dans un « découpage vertical » qui distingue dans un texte différentes lignes énonciatives. La justification sémiotique de ce découpage en « 3 D » (ainsi qualifié car il resitue dans l’espace un découpage des textes situé à plat par la sémiotique greimassienne) tient dans la différence des systèmes d’acteurs, d’espaces et de temps portés par chacune de ces lignes (cf n° 132 de la revue Sémiotique et Bible).
- On ne parle plus maintenant de scènes discursives mais de scènes figuratives, et ce pour deux raisons. D’une part, pour honorer le lien entre les figures et l’énonciation : l’analyse discursive est en effet une « analyse figurative » qui analyse des figures liées à l’énonciation. D’autre part, pour éviter tout effet de redondance avec la différence, essentielle pour la sémiotique énonciative entre les deux formalités du texte que sont récit et discours.
- La différence mentionnée ci-dessus entre récit et discours engage en sémiotique énonciative une différence de pratique. Les récits sont découpés sur la base de critères somatiques (acteurs, espace, temps) tandis que les discours sont découpés sur la base des figures d’énonciation.
- Cette métaphore n’est pas à prendre en un sens ontologique, mais sémiotique. Le « soma » est ici référé à la dimension somatique qui porte l’énonciation.
- Et, de fait, effectuer le découpage d’un texte n’est jamais une opération définitivement accomplie, mais peut faire l’objet de constants réajustements à mesure de l’avancée de la lecture.
- Rappelons que c’était la fonction des consignes données par les animateurs du séminaire.
- Nous préférons ce terme d’ « entendre » à celui, plus usuel, d’ « écoute », en raison de son rapport avec le modèle de l’entendre développé par la sémiotique énonciative.
- L’on constatera inversement, à la fin de la lecture et durant la relecture qui en sera faite, un véritable « entendre » des participants entre eux. Cela manifeste que l’entendre d’un groupe n’est jamais donné d’emblée mais se construit progressivement avec la lecture elle-même. Le fait que l’entendre ne soit pas encore posé au départ n’est donc pas un problème en soi : c’est le fait de tout groupe, et il est très beau de voir comment l’entente s’établit peu à peu.
- Pour valider cette hypothèse, il faudrait aussi visiter la fin de la lecture et y repérer les figures d’entendre qui auront émergé. Faute de place, nous n’irons pas jusque là dans cet article, renvoyant à plus tard la possibilité de compléter cette première étude par une seconde, qui concernerait la fin de la lecture.
- Ceci ne revient pas à dire que la personne en question a eu tort de s’en faire l’expression. Ce qui nous intéresse ici est de constater que, d’une manière ou d’une autre, ce consensus est venu à la parole, permettant qu’il soit ainsi interrogé.
- Nous ne voulons pas en employant ce mot faire expressément référence à l’inconscient freudien, mais nous soulignons au moins que les phénomènes que nous décrivons sont inévitables et donc involontaires.
- Nous cherchons ici à généraliser notre réflexion à toute situation d’animation. Nous ne devons cependant pas oublier que deux niveaux se mêlent intimement dans l’expérience que nous relatons. D’une part, les participants à notre séminaire sont des animateurs actifs ou potentiels, déjà engagés ou susceptibles de l’être auprès de divers groupes de lecture. Les éléments de modèles que nous allons dégager les concernent à ce titre. D’autre part, ces mêmes participants sont eux-mêmes membres du groupe constitué par le séminaire de formation à l’animation ; de ce fait, lors des séances de lecture, ils vivent comme de l’ « intérieur » une expérience de lecture dont ils peuvent être, par dessus le marché et temporairement, les animateurs. Ces deux niveaux se répondent, à la fois mêlés et distingués : le second offre les conditions d’une manifestation de ce qui se passe dans le premier. Nous rendrons, à mesure de notre réflexion, à chaque niveau ce qui lui revient. En conclusion, nous évoquerons un troisième niveau, qui considère cette fois les animateurs du séminaire lui-même. Animateurs comme les autres, tout ce que nous dirons dans les pages qui suivent les concerne également d’une certaine façon que nous préciserons.
- En Lc 8, 25, Jésus pose la question aux disciples : « Où est votre foi ? ». La foi est donc dans un lieu, et si la foi déserte ce lieu le sujet encourt le risque de s’enfoncer dans la panique à l’instar de ce qui se passe pour les disciples.
- Ce terme d’ « accueil » renvoie ici à ce qu’en sémiotique on nomme « embrayage » (cf ci-dessus, note 4). Greimas le définissait comme une tentative (impossible) de retour sur l’instance d’énonciation (voir DTRL, article « embrayage »). En prolongeant, nous envisagerons l’embrayage du lecteur sur le texte comme un tentative (jamais achevée) d’ajustement sur les structures du texte, nécessitant un débrayage préalable d’avec les siennes.
- Notre pratique semble confirmer l’intérêt d’un démarrage systématique par ce découpage en trois dimensions : il permet avec beaucoup d’efficacité un premier débrayage des lecteurs.
- Rappelons-les succinctement : 1. L’animation par un participant du séminaire d’une lecture du groupe, conduisant à son analyse après coup ; 2. le récit d’une animation faite en dehors du groupe par un participant ; 3. une lecture du groupe sans animateur mais soumise à la consigne qui consiste à rendre compte sémiotiquement des observations effectuées.
- Elle l’est de fait, mais il ne s’agit pas de rester indéfiniment sur le même texte sous prétexte que l’on n’en a pas encore faire le tour : lire l’Evangile nécessite d’y être nomade et non pas sédentaire.
- L’on comprend ici pourquoi il est important que l’animateur dispose d’une réelle compétence technique. Elle lui est, en particulier, indispensable pour effectuer le discernement nécessaire au choix de la bonne porte pour entrer dans la lecture.
- Même si le lecteur peut ne pas avoir une perception immédiate de cette sensation de douleur.
- Ces questions peuvent en effet être entendues comme des questions portant sur le sujet en train de lire, et non comme destinées à enrichir l’encyclopédie personnelle de chaque lecteur.
- Nous entendons par « savoir » ce que nous en avons dit au début du paragraphe 5.1.
- Voir Lc 8, 50 : « Ne crains pas. Crois seulement ».
- Nous faisons écho ici aux travaux de Michel de Certeau, notamment dans La fable mystique, I. XVIe-XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1982, par exemple p. 216 et suivantes.
- La figure de « l’autre rive » nous semble aisément homologable à l’aboutissement d’un acte de lecture : un objectif est assigné à la lecture, et chaque lecteur, et plus encore l’animateur, a une idée de l’endroit où l’on doit aboutir. L’expérience montre que l’on n’aboutit jamais où l’on pensait, mais que la rive atteinte ne déçoit pourtant jamais l’attente.
- En étant bien conscient que le silence n’est pas, loin s’en faut, uniquement un signifiant de peur.
- Confère Lc 8, 50.
- Nous nous inspirons ici librement de ce qui a été dit avant nous : la confiance de l’animateur ne tient pas à lui- même, mais à une triple confiance dans le texte, la méthode et le groupe. La première formulation de cette « règle des trois confiances » provient d’Anne Fortin.
- Nous entendons le mot foi, ici, dans le sens de cette confiance fondamentale dont nous parlons, qui se situe au plan de l’énonciation dans la parole de l’animateur, et non pas au plan d’un énoncé comme ce peut être le cas dans une caricature de discours catéchétique. Nous employons cette figure parce qu’elle fait écho à son emploi dans l’évangile de Luc, dans des passages proches du nôtre : en Lc 8, 25 (la traversée de la mer), 8, 48 (la femme ayant des pertes de sang) et 8, 50 (la rencontre avec Jaïre).
- Lc 8, 4-5.
- Il s’agit en effet, à travers ce découpage, de mettre en évidence l’espace énonciatif d’un texte, c’est-à-dire la forme qu’il donne à l’énonciation. Dès lors l’énonciation apparaît, en rapport avec l’énoncé, comme ce qui en soutient et organise formellement la proposition.
- Cf Lc 8, 23-24.
- C’est une situation proche de celle-ci que sont amenés à vivre les disciples que Jésus envoie au début du chapitre 9 de Luc. Dans les maisons ils n’ont qu’à être présents, sans faire obstacle à une parole qui circule au-delà d’eux.
- Il n’en reste pas moins que, pour être ainsi « quittée », la compétence technique est un préalable incontournable.
- Ou encore à la manière d’une gymnastique, comme nous le suggérions au début.
- Nous disions au début de cet article que les animateurs nous semblaient devoir se préparer à une gymnastique exigeante consistant à circuler constamment entre deux niveaux de lecture et de thématisation. Les animateurs du séminaire ne sauraient se soustraire à une telle exigence.