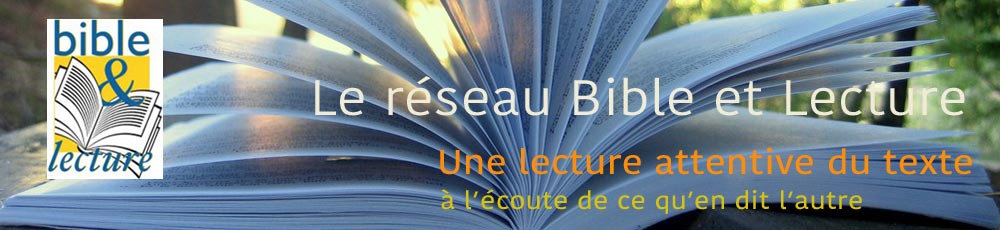3. LES DIFFERENTS PALIERS DE LA SEMIOTIQUE LITTERAIRE
Puisqu'une étude des formes signifiantes peut s'appliquer à plusieurs domaines de l'univers des signes, on appellera sémiotique « littéraire » celle qui a comme domaine de validité l'écriture. En s'appliquant à un texte, elle a comme premier souci de déterminer le « système modélisant » qui l'organise, en repérant les récurrences formelles qui s'avèrent pertinentes pour la constitution d'un sens. Ces récurrences pertinentes établissent des chaînes d'organisation en même temps que des grilles de lecture, et un texte peut en avoir plusieurs selon une hiérarchie qui lui est propre. C'est dans le croisement dans un même signe de deux ou plusieurs de ces chaînes d'organisation (ou d'une parmi elles avec l'organisation taxinomique de la langue) que se joue la sémantique en tant qu'« effet de sens ». Un texte sera donc plus ou moins polysémique, plus ou moins univoque, selon le nombre de « systèmes » ou chaînes structurelles qui configurent son sens. Par exemple, dans un texte scientifique, il est difficile qu'un jeu de rimes soit autre chose qu'un simple accident non pertinent pour son organisation signifiante. Mais sera pertinente du point de vue sémiotique la récurrence des formes d'argumentation. Dans un poème, par contre, caractérisé par la densité signifiante de son langage, tout genre de récurrence est pertinent (rime, rythme, distribution spatiale, etc...). Pour tout poème un nombre indéfini de chaînes structurelles convergent en chaque signe, ce qui lui donne une polysémie théoriquement inépuisable du point de vue de l'analyse.
Les considérations qui suivent prendront comme base le phénomène des textes qui sont particulièrement structurés selon un système de transformations racontées constituant la grammaire « narrative ». C'est donc suivant cette grammaire que s'ordonne formellement leur sens.
3.1. STRUCTURES DU RECIT ET STRUCTURATION TEXTUELLE
Une « grammaire » sémiotique telle que la grammaire narrative, est par essence formelle et récursive. L'analyse commence donc par un geste en quelque mesure réducteur : elle ramène les contenus - déjà chargés par la langue - à un ensemble de relations. Cette réduction formalisante n'est que partielle ; d'abord parce que ce sont les contenus eux-mêmes qui l'orientent et ensuite parce que la charge sémantique n'est pas absolument absente du métalangage qui analyse, autrement le sens serait irrécupérablement perdu alors qu'il s'agit précisément de le décrire.
Voici l'enchaînement des principales procédures d'analyse, qui partant de cette première re-description des éléments variables du récit en termes de structure (ou grammaire) narrative, débouchera dans la saisie du principe de structuration du texte dans son individualité.
3.1.7. Structures narratives
L'analyse du transcodage de la langue naturelle opéré par la grammaire narrative commence par une opération de formalisation consistant à réduire : a) les différentes actions du récit apparent à de simples prédicats de relation, qui plus tard deviendront des fonctions ; b) le nombre multiple des « personnages », à des points élémentaires à contenu indéterminé, dont on ne retient que la valeur positionnelle à l'un ou l'autre bout des relations dégagées ; c'est ce qu'on appelle des actants.
Une relation élémentaire peut être binaire ou ternaire. Une relation binaire est soutenue par deux actants Sujet et Objet. Il s'agit d'une relation orientée S → 0 (une anthropomorphisation du métalangage fait appeler cette relation : axe du désir ou de la quête). Une relation ternaire (elle aussi orientée, propre à la forme d'un faire communicatif) détermine le schéma actantiel suivant :
- Destinateur (De) → Objet (0) → Destinataire → (Da)
La combinaison des deux relations donne lieu à un schéma orienté ainsi :
De → O → Da
↑
S
Or dans un récit il peut y avoir une coexistence entre deux ou plusieurs « programmes narratifs » (11) différents ou même opposés. Le nombre d'actants se voit alors multiplié : un Objet peut se présenter à deux Sujets opposés, dont l'un deviendra, par rapport au programme narratif de l'autre, Anti-sujet ou Opposant. De même, la quête d'un Objet peut demander des instances de médiation dans lesquelles apparaît éventuellement un Sujet subsidiaire qui prolonge les virtualités du Sujet principal. Il se définira par rapport à lui en tant qu'Adjuvant. Cela n'empêche que, chacun à son niveau, Opposant et Adjuvant ne soient en fait rien d'autre que des actants Sujets.
La nature événementielle, transformatrice, temporelle de tout récit commande le passage à un autre type d'organisation qui change les relations en fonctions et le schéma statique en algorithme. Les actants suivent, alors, alternativement des parcours de réalisation (ou « amélioration » : Sujet conjoint à son Objet) ou de virtualisation (ou « dégradation » : Sujet disjoint de son Objet) vis-à-vis de leurs états de départ. Le premier parcours recevra également le nom de parcours euphorique, et le deuxième, celui de parcours dysphorique. Pour cela les actants opèrent différentes performances (ou « épreuves », selon la terminologie première de Greimas), dont une est « principale » et les autres se placent au niveau soit des modalités (acquisition de la « compétence » nécessaire pour la performance principale) Soit de la reconnaissance du nouvel état de choses. Ces performances secondaires s'orientent vers la principale comme des « simulacres » joués à d'autres niveaux sur la même structure de base, noyaux récursifs appartenant à l'essence transformatrice de la narrativité.
L'organisation paradigmatique qui découle de la coexistence évoquée plus haut d'éventuels programmes narratifs différents au sein d'un même récit, produit des points de transition où, surtout au moment des performances secondaires, certains actants subissent des changements dans leur position relationnelle. C'est ce qu'on appelle les rôles actantiels que peut jouer un même personnage au long du parcours narratif.
Dans le cas des paraboles des évangiles, par exemple, il s'agit généralement de la coexistence de deux programmes narratifs ayant un actant en commun. L'action transformatrice consiste alors à faire suivre à l'un des programmes un processus euphorique et à l'autre, un processus dysphorique. Très souvent ce sont deux Sujets en relation à un seul Objet (soit S 1 → 0 ← S 2), comme, par exemple, l'histoire du Pharisien et du Publicain, tous deux Sujets devant l'Objet « justification ». Parfois l'un des deux Sujets est présenté comme constituant une classe, comme dans l'histoire du Bon Samaritain, où devant un même Objet (le corps du blessé) il y a un Sujet qui devient conjoint et un autre Sujet (multiple) qui devient disjoint. Une autre distribution actantielle possible des deux processus narratifs coïncidents peut se présenter comme ceci : 0 1 ← S → 0 2, comme dans l'histoire du Trésor (Matthieu 13, 44) et dans celle de la Perle (Matthieu 13, 45-46). Il s'agit là d'un seul Sujet devant deux Objets, et le récit opère la disjonction d'avec l'un et la conjonction avec l'autre.
La relation peut aussi s'organiser en parcours plus compliqués. C'est le cas de l'histoire du Débiteur Impitoyable (Matthieu 18, 23-35), qui imite narrativement la figure logique du polysyllogisme :
De (Roi) → 0 (annulation de la dette) → Da (Débiteur 1)
De (Débiteur 1) → 0 (annulation de la dette) → Da (Débiteur 2)
La situation peut encore être plus complexe, mais en général il s'agit toujours d'une expansion récursive de la même structure de base.
Aussi séduisante que puisse paraître cette opération « re-descriptive » pour qui s'initie à la sémiotique narrative, elle ne peut constituer qu'un point de départ. Si aujourd'hui tant d'analyses abondent en précisions grammaticales, ce n'est que dans le but de faire saisir cette grammaire narrative dont la reconnaissance, loin d'être évidente pour tous, est cependant appelée à devenir finalement un simple réflexe de lecture, comme celui de la grammaire propositionnelle dans la lecture et dans le parler de chaque jour.
Au fait, s'il y a du sens, c'est qu'il existe une instance individuante qui ordonne ces structures formelles selon un parcours inédit, actualisé dans l'espace concret du texte. La démarche « re-descriptive » doit donc être complétée par une autre, qui dégage le principe de structuration, le « dessin immanent » (P. Ricœur) qui convertit une structure en forme, c'est-à-dire en facteur actuel de sens. Cette autre démarche sera appelée plus bas explicative.
3.1.2. Structures discursives
Le passage des structures narratives à l'instance de structuration est assuré par un palier intermédiaire : le niveau appelé « discursif ». En effet, quand les structures narratives prennent en charge un discours ou un texte (et non pas un film ou un tableau peint), elles rejoignent les contraintes du langage, c'est-à-dire un autre système d'organisation signifiante. Là s'illustre le principe signalé plus haut : c'est au croisement dans l'espace d'un même signe de deux ou plusieurs chaines d'organisation que se joue le sémantique en tant qu'effet de sens.
Nous venons de voir comment la grammaire narrative, en tant que système modélisant secondaire, organise ses contenus. Pour sa part, la langue - en tant que système primaire -s'organise sur la base de certaines unités de signification, à nombre hypothétiquement fini, que Hjelmslev appelle « figures du contenu » (12), et qui correspondent à ce que Pottier et Greimas appellent sèmes. Voici l'explication de leur fonctionnement : la langue n'a jamais existé en elle-même comme système primaire ; elle a toujours été relayée par différents systèmes modélisants articulés en discours. C'est à l'intérieur des discours que la topologie différentielle de chaque élément a produit le sens ; le passage d'un discours à l'autre, d'une topologie à l'autre, accumule des résidus de sens que « la Langue » emmagasine en un système, jamais actuel, de différences. Chaque unité linguistique se comporte comme une « figure » dans la mesure où elle annonce toutes les potentialités que son passage par un nombre inconnu d'organisations signifiantes lui a laissées. En tant qu'unités de discours et non plus de la langue, ces figures se développent pour constituer ce que Greimas appelle les configurations discursives. Elles apportent au discours narratif individuel l'empreinte de leur passage par de multiples topologies, voire même par d'innombrables idéologies. Toutes ces virtualités représentent autant de parcours figuratifs. Parmi eux le discours individuel en choisit un (en retenant la potentialité des autres) (13) et, en lui accordant une place dans une nouvelle organisation, le dépasse. Cette nouvelle organisation vient précisément du niveau actantiel. Pour pouvoir être pris en charge par la grammaire actantielle, le parcours figuratif choisi doit, à son niveau, être subsumé par un « agent compétent ». On parlera alors de rôle thématique.
Nous arrivons ainsi au point d'intersection des deux chaînes structurelles. Un rôle thématique a son parcours préétabli par la figure qu'il subsume. Un rôle actantiel a, à son niveau, un chemin autrement contraignant. Ils se croisent en ce qu'on appelle un acteur (lieu sémantique). Aucun des deux n'abandonnera son chemin pour se plier entièrement à celui de l'autre. C'est donnant-donnant, et de plus sans rien perdre, qu'ils tisseront un récit unique, qu'ils donneront naissance, par transgression réciproque, à un sens. Or, le principe régulateur de cette économie individuelle n'appartient plus à la structure.
Les paraboles des évangiles présentent en général des configurations propres au dictionnaire culturel de l'époque. L'histoire du Pharisien et du Publicain (Luc 18, 9, 14) pourrait encore une fois nous servir d'exemple. Le publicain est un acteur qui se présente en tant qu' « agent compétent » d'un faire : « collecter les impôts ». Or, d'une très large « configuration discursive » que le faire : « collecter les impôts » étend à différents domaines culturels (politique, économique, social, psychologique, moral, religieux, etc ...) le récit choisit un seul « parcours figuratif », et ceci par opposition à la figure du pharisien : c'est le parcours religieux. En ce sens, le publicain joue un rôle thématique d'ordre religieux en tant que « pécheur » ; tout le reste est « suspendu ». Ce choix figuratif rencontre dans un même acteur, sur une autre chaine organisatrice, un rôle actantiel de Sujet qui, au bout du processus transformatif, sera conjoint à son Objet, Objet que nous pouvons appeler « justification ». Le pharisien présentait, lui aussi, un rôle thématique (« observant de la loi juive ») parmi toutes les possibilités de parcours auxquelles sa configuration le disposait. Au niveau des transformations actantielles, il sera un Sujet privé de son Objet-valeur : la justification. Au point d'intersection des deux chaînes d'organisation, l'effet de sens provient d'une réciproque subversion sans qu'aucune des deux chaînes ne soit perdante : le pécheur sera justifié sans cesser d'être un pécheur, le fidèle à la loi, sans perdre son rôle d'attaché à la loi, ne sera pas, pour autant, justifié.
L'histoire du Semeur opère, elle aussi, la réduction des configurations discursives à des parcours figuratifs uniques : les oiseaux au bord du chemin, les pierres, le soleil, les épines, sont à un seul rôle : celui de destructeurs du grain. Les autres rôles possibles sont « suspendus ». Or, en ce cas-ci, les contraintes thématiques coïncideront avec celles qui proviennent du niveau actantiel. C'est cette linéarité déroutante que présente l'histoire du Semeur (une histoire où rien ne se passe qui ne soit prévu par le langage lui-même), c'est cette linéarité, précisément, qui a besoin de l'établissement, sur le plan du récit primaire, d'un nouveau transcodage (le discours interprétatif de Jésus : « Vous donc, écoutez la parabole du Semeur ... »). Et c'est aussi seulement sur cette deuxième reprise que les « parcours figuratifs » choisis seront subsumés par des « agents compétents » : « Satan », «la détresse et la persécution», « les soucis du monde », etc... Dans cette histoire, comme il est possible de le constater, le principal effet de sens se joue non plus dans l'intersection paradigmatique de deux chaînes entretissées, mais dans un système d'équivalences de deux chaînes liées syntagmatiquement l'une à l'autre par l'œuvre d'un récit primaire qui les englobe.
Voilà pour ce qui est des structures discursives d'un récit.
3.1.3. Structuration textuelle
Mais les structures discursives ne suffisent pas non plus à rendre compte du parcours particulier du sens réalisé grâce à elles dans ce texte. La dimension textuelle apparaît comme le dernier des niveaux sémiotiques qu'une organisation signifiante à base linguistique peut atteindre. Elle a donc un statut spécial par rapport aux structures que l'analyse reconnaît dans tout récit oral ou écrit. Elle opère un transcodage non seulement des catégories linguistiques mais aussi de celles qui appartiennent à d'autres systèmes sémiotiques, par exemple au système de la narrativité. Elle verse les mécanismes des systèmes structurels qu'elle se subordonne dans le courant d'un autre type d'organisation, d'ordre idéologique, qui constitue la culture, l'art, la religion, etc…
Les deux paragraphes suivants seront intégralement consacrés à l'énonciation des principes et des normes stratégiques d'analyse de cette autre dimension sémiotique qu'est la dimension textuelle.
3.2 PRINCIPES DE L'ANALYSE TEXTUELLE
Les principes qui régissent l'organisation textuelle sont de l'ordre de l'individuel. Il est donc impossible de les constituer en « grammaire », au sens où l'on parle de grammaire narrative (un système de relations formel et récursif). Et la procédure d'analyse textuelle devient une question de stratégie plutôt que de déduction.
Cette stratégie devant l'individuel peut être mieux envisagée si l'on examine les principales caractéristiques de l'instance textuelle par rapport aux autres niveaux sémiotiques qu'elle subsume.
Le premier principe est celui de la clôture.
Le système narratif est un système essentiellement « récursif » : ses noyaux performantiels peuvent théoriquement être répétés dans un engendrement infini, produisant un récit qui compliquerait de plus en plus la même structure de base. Ce n'est que de l'extérieur que cette chaine peut être clôturée. L'action du texte, qui assigne un espace limité à la structure narrative, lui donne des limites déjà par elles-mêmes significatives. C. Metz exprime clairement ce principe en disant : « un récit (...) n'est pas une séquence d'événements clos, c'est une séquence close d'événements » (14). Cette clôture essentielle que le texte applique à toutes les organisations sémiotiques qu'il subsume, permet alors de le considérer à partir des limites » c'est-à-dire dans son mouvement externe d'intégration.
Le deuxième principe est celui de l'individuation.
En faisant de la combinaison d'une grammaire narrative et des contraintes discursives « un récit déterminé », l'instance textuelle se définit comme choix et comme parcours à l'intérieur des organisations qu'il couronne.
Le troisième principe est celui de la spatialité.
Parallèlement à la diachronie des transformations temporelles dont parle le discours, le texte est lui-même un processus de transformation. Une transformation qui se lit dans le temps mais qui est cependant d'ordre spatial : le début et la fin du texte coïncident respectivement avec le haut et le bas, la gauche et la droite de l'écriture (tout au moins en Occident ...). Cette spatialisation des rapports sémantiques produits par le texte signifie très concrètement que tout texte narratif subordonne les transformations du narré aux transformations faites (« performée ») par la successivité qu'impose le discours à l'ordre de la lecture. Par son pouvoir de rassembler et d'écarter des signifiants dans son espace, le texte peut produire également des effets d'assimilation sémantique de ce qui « par nature » est disjoint, et des effets de disjonction sémantique de ce qui « par nature » est identique ou équivalent.
Le quatrième principe - dérivé des trois premiers - est celui qui fait d'un texte un « relais de la langue ».
Par le fait de sa clôture, le texte devient lui-même un univers sémantique cohérent ; cela permet de lire dans son espace, étalés de façon « ordinale » dans la syntagmatique des signifiants, les rapports différentiels qui définissent les paradigmes du signifié. Tout texte, aussi bref soit-il, établit un nouveau système de différences (donc de significations) qui ne recoupe pas celui de la langue mais le « suspend » (le conserve en le transgressant) et qui constitue, finalement, le seul espace réel où la langue « se réserve ».
En tant que facteur de structuration et d'individuation, l'instance textuelle peut être considérée, avec J. Kristeva (15), comme une « productivité ». Analyser un texte comme « productivité », c'est le saisir en tant qu'opération restructurante d'énoncés qui lui viennent d'ailleurs : de son moment historique, de la société qui le produit et qui produit sur le même modèle (l' « idéologème » de J. Kristeva), d'autres pratiques signifiantes. L'individualité d'un texte n'est jamais un point de départ absolu. Autrement dit, le texte analysé n'est pas seulement un « interprétable », il est toujours en quelque sorte déjà un « interprétant » (dans le sens de C.S. Peirce) dans une chaine infinie d'interprétants. « Un texte - écrit Ph. Sollers - se situe à la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois la relecture, l'accentuation, la condensation, le déplacement et la profondeur. D'une certaine manière, un texte vaut ce que vaut son action intégratrice et destructrice d'autres textes ». (16).
On appellera ce cinquième principe, principe d'intertextualité.
Le fait qu'un texte se présente comme instance d'un processus productif ne lui enlève pas sa dangereuse nature d'objet et de produit. En tant que tel, le texte entre, lui aussi, dans une économie qui n'est pas exemple du phénomène de la « plus-value ».
Le dernier principe est donc celui de la valeur textuelle, qui tient compte de ce que fait du texte l'acte de transmission et de lecture.