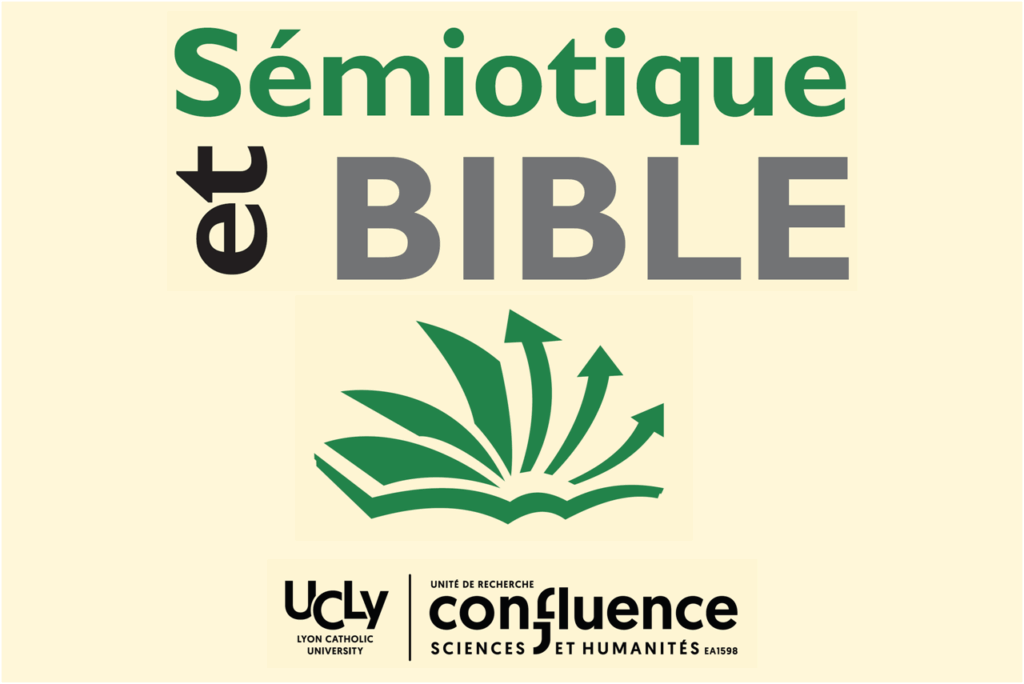Job 1-2
Le texte s'ouvre sur une figure d'espace : "Il y avait au pays de Ouç". Le lieu est ainsi nommé. Nommé aussi Job, figure d'acteur : "un homme du nom de Job". C'est de lui que le texte va parler.
Puis le texte énumère "les fils et les filles (qui) lui étaient nés", ainsi que ce qu'il "possédait" (1, 3 et 11, tob). En 1, 2, le texte distingue les enfants des richesses "possédées", animaux et domesticité ; tandis qu'en 1, 11, les enfants semblent appartenir à l'ensemble de "tout ce qu'il possède". En 1, 2-3, enfants et animaux sont comptés et chiffrés, mais non la "domesticité", simplement nombreuse.
Toujours est-il qu'une distinction se construit, quant aux acteurs, entre les figures du 'nombreux' et celle de l'unique, et même du 1er : "le plus grand de tous les fils de l'Orient".
En 1, 4 et 5, quelque chose revient comme un "cycle" ou une "boucle" : c'est inscrit à la fois par les acteurs ("tour de rôle") et comme répétition du temps ("chaque fois"). "Ses fils allaient festoyer les uns chez les autres à tour de rôle". Le 'tour', le 'cycle' ou le 'bouclage' au gré des traductions, font venir à l'idée le 'rituel', qui est explicite dans l'holocauste. Quelque chose 'revient'. L'attention aux figures du temps fait lire "dès l'aube" : ce temps 'premier' fait écho à l'acteur qui est "le plus grand". Par le temps comme par les acteurs, la marque du singulier fait suite à du multiple. Le singulier est pourtant présenté comme la source des multiples. Ainsi prend valeur l'expression "fils et filles lui étaient nés". De plus, le singulier engendre l'individuation "un holocauste pour chacun d'eux … Job faisait chaque fois" (individuation des acteurs et du temps).
En 1, 6, s'ouvre une nouvelle scène : le temps ("C'est le jour où"), les acteurs ("Fils de Dieu", "Seigneur"), l'espace ("se rendaient à l'audience", ou bien "viennent se poster devant") sont nouveaux. Le rythme du singulier et du multiple se retrouve du fait des acteurs que sont le "Seigneur" (yhvh) et l'ensemble ou le multiple "Fils de Dieu (elohim)", "le satan" apparaissant comme élément de cet ensemble ("parmi eux").
Singularité d'acteur également, que de pointer ("remarquer") au cours du parcours et de la promenade sur la terre du satan, "mon serviteur Job" (1, 8). Le plus grand (3), devient pour le Seigneur "mon serviteur", tout en continuant de ne pas avoir "son pareil".
La question retenue par le satan porte sur un point précis de tout ce qui est dit de Job, à savoir "Job craint Dieu" : est-ce vraiment désintéressé ? N'est-ce pas pour être "protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il possède". L'expérience est donc décidée : destruction de ce que Job possède. Expérience cependant où, de manière bizarre, le Seigneur et le satan se renvoient la charge de l'exécution. Le satan dit "veuille étendre la main". Le Seigneur dit "tous ses biens sont en ton pouvoir". Mais le Seigneur impose une limite à l'action du satan : "évite seulement de porter la main sur lui". Il y a une sorte d'hésitation quant à l'acteur qui réalisera l'expérience (le sujet opérateur), mais une sorte de détermination du 'Seigneur' par sa compétence à dire la limite : pas "lui".
En 1, 13-19, l'expérience se réalise. A noter que fils et filles encadrent le récit (est-ce pour orienter vers la question : où est la limite de ce qu'on possède ? Si les enfants, "qui lui étaient nés", disparaissent, c'est déjà "lui" qui est atteint.)
A noter que le festin se tient chez le fils aîné : la figure du 1er s'enrichit. C'est la singularité qui continue à se construire. D'autant plus que vient le refrain de chacun des 4 messagers : "moi seulement, tout seul" : au moment de la séparation entre Job et chacun des quatre ensembles des biens qu'il possède, c'est le singulier qui le rejoint (singulier d'acteur et aussi de temps : "il parlait encore quand")
Les causes de la destruction sont acteurs humains pour 1 et 3, et causes 'naturelles' pour 2 et 4 ("feu de Dieu (Elohim)", "grand vent venu d'au-delà du désert"). Le satan n'intervient pas directement./span>
En 20, Job "déchira son manteau et se rasa la tête". Par le vêtement, un 'bien' certes, mais qui touche le corps, et par les cheveux, le texte se rapproche du corps de Job. C'est donc Job lui-même qui oriente l'aventure sur "lui"-même, et pas seulement sur ce qu'il possède.
En 20-22, s'inscrivent des figures à deux faces opposées : "il se leva … se jeta à terre", "sortir … retourner" (non pas au "ventre de ma mère", mais "là", à terre), "donné … ôté". Couples d'opposés qui semblent naître d'une seule source : "il, je, le Seigneur".
Il semble qu'il y ait une limite aux couples d'opposés qui naissent du Seigneur : il ne peut être que "béni", jamais 'maudit', même lorsque c'est un "péché" de le "bénir" (1, 5 et 11 ; 2, 5 et 9).
En 2, 1-6, la scène de l'audience est reprise. Mais s'agit-il seulement de mettre à l'épreuve le désintéressement de Job dans sa crainte du Seigneur, alors que le Seigneur dit au satan : "tu m'as incité à l'engloutir" (3) ? Une nouvelle limite est posée : "respecte seulement sa vie" (6).
En 7-10, cette fois, le corps de Job est atteint, non plus par lui-même (qui "se rasa la tête", 1, 20), mais par un acteur extérieur à lui, le satan (qui pour ce faire "a quitté la présence du Seigneur"). La femme de Job apparaît discrètement, aussitôt rabrouée par son Job de mari, car son intervention se situe en dehors de la limite. Elle dit à Job : "meurs !". Cette fois, c'est elle qui suggère déjà l'au-delà de la limite fixée par le Seigneur.
Vient un nouveau couple d'opposés : le bonheur et le malheur. Les opposés sont tenus ensemble par la figure "accepter". Cependant les "choses bonnes" sont acceptées "comme un don de Dieu (elohim)" mais il n'est pas dit que les choses mauvaises soient à accepter comme un don de Dieu. Peut-être est-ce la dissymétrie de Dieu notée au sujet de "bénir". Il suffirait qu'on puisse accepter le bonheur, en l'interprétant comme don de Dieu, pour qu'on puisse aussi accepter le malheur.
Enfin entrent en scène trois acteurs nouveaux : acteurs qui sont des amis de Job, venant à lui au temps de son malheur, arrivant des lieux nommés qui sont leurs pays respectifs.
Job 3
Le texte passe d'un récit à un discours, à un 'dire' de Job, à une énonciation énoncée : "Job prit la parole et dit" (2).
Une première difficulté de lecture vient au v.3 : "Périsse le jour où j'allais être enfanté !" Job est né, c'est lui qui parle : comment peut-il souhaiter que la veille de sa naissance "périsse", que ce soit comme si cela n'était pas ? Annuler ce jour serait ne pas pouvoir lancer l'imprécation de son annulation.
La notion sémiotique de débrayage pourrait rendre compte de ce phénomène textuel, rendre compte de cette virtualité particulière qui est celle que fabrique le texte. Ce débrayage, c'est 'non-je, non-ici, non-maintenant'. Le texte fabrique une virtualité d'acteur Job débrayée du Job qui parle, un temps (enfantement, conception) et un lieu ("le sein") débrayés d'ici et maintenant où Job parle. C'est une énonciation qui, cette fois, n'est plus énoncée, mais qui 'parle' comme en filigrane dans le texte. L'instance de cette énonciation (c'est-à-dire la source énonciative de cette énonciation cachée) produit l'énoncé négatif : "périsse le jour où j'allais être enfanté". Le texte ne peut se lire que comme une machine sémiotique, une machine à faire du sens. S'il ne faisait sens qu'en référence aux 'choses du monde', il serait inintelligible, comme fou.
Un 2ème arrêt sur le texte, dans ce même v.3, vient de ce que, à la différence du "jour", "la nuit" parle : elle est l'acteur d'un 'dire'. Pourquoi cette différence entre "le jour" et "la nuit" ? Il semble que "ce jour-là" est traité comme un objet ("Que Dieu ne le recherche pas"), et comme un objet soumis de manière répétée aux ténèbres, à la ténèbre, à l''ombremort' (Chouraqui), à la nuée, aux éclipses. "Cette nuit-là" ne peut, elle, que faire surenchère d'obscurité, s'amplifier dans l'obscurité ; c'est ainsi qu'elle tranche sur "la ronde des jours" et "le compte des mois". "Cette nuit-là" est un acteur (sujet d'actions telles que "dire", "se joindre", "entrer"), qui domine figurativement l'objet "ce jour-là", à la fois en étant en dehors du compte (6) et en cachant à la vue (9).
La prédominance de la nuit se vérifie avec le découpage du texte :
- 3 : le jour – la nuit
- 4-5 : ce jour-là
- 6 : cette nuit-là
- 7-10 : développement sur : cette nuit-là.
La priorité de "cette nuit-là" sur "ce jour-là" était déjà dans l'antériorité de la conception sur l'enfantement en 3 (Le jour où j'allais être enfanté et la nui qui a dit : un homme a été conçu).
La raison du souhait que "cette nuit-là" s'amplifie dans sa négation (infécondée, nulle joie, exécrée, enténébrée, désespérance, 7-9), c'est qu'elle "n'a pas clos les portes du ventre où j'étais" (10) : elle n'a pas tenu bon le débrayage du non-je, non-ici, non-maintenant, Elle "n'a pas dérobé", elle a laissé passer, le "je" qui "dit" ici et maintenant.
Et "pourquoi" donc ? "Pourquoi ne suis-je pas mort dans la matrice", pourquoi n'avoir pas expiré "à peine sorti du ventre", "pourquoi deux genoux…", "pourquoi avoir été allaité" ? Donc pourquoi être entré dans une histoire où commence à tourner "la ronde des jours". Pourquoi la série, qui fait écho au tour de rôle des fêtes des fils de Job, que Job interrompait par "un holocauste pour chacun d'eux", "à l'aube" (1, 4-5) ?
Si l'histoire et ses séries n'avaient pas commencé, "je serais au calme, au repos". Dans l'imaginaire (si je n'avais pas été, je serais …), Job aurait le statut de premier ("prince") et la richesse ("or et argent") qu'il avait auparavant. Mais il les aurait dans le calme et le repos.
Chouraqui joint le v.16 ("avorton enfoui, je n'existerais pas") au v.17-19, et non pas à 14-15 (avec les rois, les conseillers et les princes)
En 16-19, les descriptions de ce "calme" et de ce "repos" sont comme délivrance des "tourments" (ou agitation), de la prison et du garde-chiourme, de la mainmise du maître sur l'esclave. Est-ce le rajout du "repos" au débrayage (non-je, non-ici, non-maintenant) et au virtuel du non enfantement, qui donne à penser à une décréation ? L'intertextualité avec Gen.1 n'est sans doute pas saugrenue. Ce texte ne se tourne pas vers le néant. Job n'y est nullement manifesté comme suicidaire. Ce n'est pas le néant, mais c'est le vide que l'énonciation induit par débrayage : sans doute le 'jour vide' qu'est le 7ème jour de Gen.1, est-il de même structure. La décréation, comme déconstruction, serait l'ensemble vide nécessaire pour donner juste place aux 'grandeurs' de pouvoir politique (rois, conseillers, princes) et de richesse (or, argent), de telle sorte qu'elles ne soient pas la monstruosité du "Léviathan" (8) et qu'elles ne soient pas "tourments".
Alors, la puissance de l'énonciation se manifeste dans l'énoncé du "il" (de quel acteur s'agit-il ?) : "Pourquoi donne-t-il" (20). Elle se manifeste aussi par l'énoncé du "ils" qui prennent sans crier gare la place du "je" ("les ulcérés" 20, "ils" 21-22).
La figure du vide se manifeste comme "l'attente de la mort qui ne vient pas" (21) : tension vers un objet absent. Cet objet est "recherché", "plus que les trésors" qui sans ce vide ne sont que tourments. C'est pourquoi la figure du "tombeau" est liée au "transport de joie et à la liesse". Sans ce vide, "la vie de l'homme" n'est que "route (qui) se dérobe". "L'enclos" (23, cf.1, 10) ne fait qu'entourer le statut et les richesses : il les protège, mais il ne fait qu'enkyster leur poison. Alors qu'il faudrait ouvrir un vide, qui soit vide intérieur.
Peut-être commence à se glisser l'idée d'une pédagogie dans l'aventure de Job. Alors le satan ne serait pas le pervers, mais le pédagogue adjoint !
Le chapitre se termine sur un embrayage : 'je – ici – maintenant'. En langage lacanien, peut-être est-ce le 'symbolique' du 'réel' enrichi du parcours 'imaginaire'. En langage sémiotique, sans doute cet ultime embrayage marque-t-il ses distances vis à vis des imprécations du début, une fois passé par le débrayage d'une énonciation aussi obscure que la nuit qui surenchérit d'obscurité pour cacher et voiler ?
L'indicible …
Job 4 et 5 (I)
Deux acteurs sont en scène : "Elifaz de Teman" qui "prit la parole et dit" (4, 1) et celui à qui il s'adresse à la 2ème personne : à la suite du ch.3, on peut penser que ce "tu" désigne Job, mais ce nom n'est pas dit tout au long des deux chapitres. On aurait pu se demander au ch.3 ("Job prit la parole et dit", 3, 1), à qui la parole de Job est adressée. Ce "tu" et ce "je" font des chapitres 4 et 5 une unité de texte, qui va jusqu'en 6, 1 ("alors Job prit la parole et dit").
Le verset 2 connaît différentes traductions. Elles ont en commun une certaine autonomie de "la parole" ou des "mots". "Tes paroles redressaient ceux qui perdent pied" (4). Dans la mesure où elles n'ont plus d'effet sur "toi", "maintenant" que "c'est toi qui fléchis" (5), "tes paroles" quittent leur attache à "toi" pour jouir d'une sorte d'autonomie, se tenant en elles-mêmes.
La transformation de "toi" s'inscrit dans un parcours du temps. Auparavant, "tu savais", "tes paroles redressaient", "tu affermissais". "Maintenant", "te voici atteint". Un travail sur l'énonciation pourrait être de se demander comment le texte construit le point de vue de l'énonciateur, point de vue à partir duquel embrasser le passé et le présent attribué à l'énonciataire, ainsi que la transformation : qu'est-ce qui fonde textuellement la validité de ce point de vue, et qu'est-ce que ce point de vue fonde ?
Les deux acteurs sont distribués en 7 et en 8 de la manière suivante :
- "toi" devrait se livrer au temps et à l'espace : "jamais ?", "où ?", ce qui suppose qu'Elifaz adopte, lui, un point de vue qui soit hors du temps et hors de l'espace. "Quel innocent a jamais péri ?" : la réponse attendue est : aucun, jamais ! "Où vit-on les hommes droits disparaître ?", … nulle part !
- "je" a en effet une vue d'ensemble. "Je l'ai bien vu". C'est la "vision" d'acteurs définis par leur fonction opérante ("laboureurs, semeurs, moissonneurs"), inscrits dans le parcours temporel d'un travail d'agriculteurs. Donc à ce "je" d'embrasser là encore un parcours temporel. Les figures sont somatiques : Dieu (Eloha) est doté d'une "haleine", d'un "souffle", d'une "narine".
"Ne pas périr" ou "périr", telle est la thématique qui glisse de l'un à l'autre, et qui déborde sur le monde animal, qui s'élargit donc du monde humain agriculteur au monde animal chasseur. Mais ce qui distingue ce qui est dit pour "toi" et pour "je", ce sont deux manière d'être temps.
"Toi" est invité à se plonger dans le temps ("rappelle-toi"), par un "je" qui est, lui, en position hors temps et hors lieu ("jamais, où ?"). Et "toi" est invité à faire mémoire d'acteurs déterminés par des qualifications 'morales' ("innocent, droits") sans qu'il soit question de leur travail.
En revanche, "Je" témoigne de son point de vue ("je l'ai bien vu") (un 'voir' immédiat, sans médiation, sans distance de temps ni d'espace) selon lequel les acteurs déterminés par leur rôle de travailleurs, sont inscrits dans un parcours temporel au bout duquel ils moissonnent ce qu'ils ont semé : la misère.
Le traitement de "Toi" consiste à aller du temps (rappelle-toi) au hors temps (jamais), pour des acteurs qui ne sont déterminés que moralement, destinés à "ne pas périr". Le traitement de "Je" consiste à aller du non-temps (je l'ai bien vu) au temps (labourer, semer, moissonner) pour des acteurs définis par leur travail, destinés à "'périr".
Les versets 12 à 16 sont encadrés par "une parole" et "une voix". Entre les deux, c'est une vision. L'audition de "la voix" se fait par la médiation d'un "silence". De nombreuses indications somatiques (frisson, faire cliqueter les os, souffle, face, hérisser le poil, la chair, se tenir debout, devant les yeux) font que "l'image" ou le "spectre" (16b) est lu comme une forme d'être humain, à qui attribuer "la voix que j'entendis".
Bien des questions viennent, après une première lecture qui semble évoquer simplement un rêve. Quelle différence entre parole et voix ? Les paroles qui suivent (17-21) sont-elles celles émises par la voix ? Plus encore, comment se construit le rapport entre la parole et la vision, entre voir et entendre ? Au plus précis, qu'est-ce que cette indication du silence ?
Textuellement, le silence est entre voir et entendre, entre "le spectre (ou l'image) devant mes yeux" et "j'entendis une voix". Mais ce silence, fait-il le lien entre voir et entendre ou bien au contraire fait-il rupture ? Est-il suspens, renforcement de la tension d'une attente ou bien au contraire détente, dédramatisation de "l'épouvante" devant cette image spectrale non reconnue ?
Ce qui a été lu de "rappelle-toi" et "j'ai bien vu" (7-8) est peut-être ici à l'œuvre pour recevoir l'ambiguïté de ce "silence". Le "Je", qui "vois", tel qu'il vient d'être lu en 8, se situerait plutôt du côté de l'immédiat qui embrasse temps et espace.
"Une parole, furtivement, m'est venue", "saisie en murmure", est suivie de "visions de la nuit" qui collent à la peau ("frisson, poil hérissé") et aux yeux ("le spectre restait devant mes yeux"). Puisque, à la fin, c'est ce même "Je" qui "entendis une voix", si ce qui suit, c'est ce que "Je" a entendu que cette voix disait, alors le silence sert plutôt à prolonger l'immédiateté de cette vision qui 'colle', à transporter l'absence d'écart et l'inexistence de toute médiation dans les paroles de la voix entendue.
En tout cas, les paroles qui suivent (17-21), qu'elles soient simplement la suite du discours d'Elifaz ou qu'elles soient ce qu'il a entendu dire à la "voix", que cette "voix" soit ou non celle du spectre-image, ces paroles sont annonce de "périr" et de "mourir".
Lorsque "le mortel" est mis en comparaison avec "Dieu (Eloha)" à la mesure de la "justice", lorsque "l'homme" est mis en comparaison avec "son auteur" à la mesure du "pur", c'est "défiance aux serviteurs", "folie aux anges", "des maisons d'argile tombant en poussière", "écrasés, broyés, tentes effondrées". Se retrouve la version du "périr" lue en 8 et 9.
Selon ces paroles, il y a une position "du mortel, des hommes, des serviteurs (de Dieu), des anges même (de Dieu)" où "d'un matin au soir … ils périront à jamais" (20). En un laps de temps élémentaire, en un jour, leur temps ne sera plus : "à jamais".
La question alors serait de pouvoir dire comment le texte fait passer pour vraie cette position ? On sait déjà que cette position concerne des qualifications (juste, pur) du même type que "innocent" et "droits" (7), c'est-à-dire que cette position s'appuie sur des déterminations 'morales'.
Job 4 et 5 (II)
Après le passage 4, 12-21, dans lequel "je" ne s'adresse à personne, l'échange reprend en 5, 1 : "Fais donc appel !". Un nouvel acteur apparaît, potentiel d'ailleurs, "existe-t-il quelqu'un pour te répondre, un des saints ?". "Appel", dans la traduction de la TOB ("crie donc !", Chouraqui), peut orienter vers le registre, l'isotopie, de la justice. Cette interprétation, sans doute est-elle suggérée par 4, 17 : "Le mortel serait-il plus juste que Dieu", et elle est soutenue par la figure du "tribunal" (5, 4), puis de la "cause" (5, 8).
L'idée d'un appel en justice comporte un jugement préalable. Du jugement en appel, on espère qu'il viendra 'casser' le premier et dénoncer l'erreur du premier juge. L'acteur qui apparaît ici ("quelqu'un, un des saints") vient prendre la place du tiers entre "toi" et le premier juge. Le point de vue de Elifaz, comporte donc deux éléments :
- le malheur (de "toi") correspond à un premier jugement
- "tu" considères ce jugement comme injuste.
Le point de vue d'Elifaz fixe celui à qui il s'adresse ("tu") dans un poste qu'il ne cesse de dévaluer : cette manière de faire appel à un tiers est le fait de "l'imbécile" (Chq : dément), du "naïf" (niais). Manquant d'esprit et d'intelligence, le 'plaignant' qui ferait appel n'est rien d'autre que psychologiquement atteint par "la rogne" et par "la jalousie" : c'est traiter de malade mental celui qui défie le pouvoir établi.
Il n'est pas forcément pertinent de rapporter les figures des "fils" (4) et de la "moisson" (5) aux enfants de Job morts en 1, 13-19, ni à la moisson de 4, 8. Ici, c'est une configuration différente.
Elifaz continue d'épingler Job dans la dévalorisation, et même dans la culpabilité : le "gâchis" et la "misère" ne naissent pas spontanément de la "terre" ou du "sol". La misère n'est rien d'autre que le destin de l'homme dès lors qu'il travaille ("moissonne") et possède ("patrimoine", 5), comme nous l'avons lu dans 4, 7-8, dès lors que, travaillant, il s'inscrit dans la temporalité. Dès lors qu'il travaille, il n'y a plus qu'à souhaiter qu'il soit dépouillé au terme de la saison de son travail, que le fruit de son travail, ce qu'il a "moissonné", les affamés s'en nourrissent, les assoiffés l'engouffrent. Le destin normal, ce qui est de règle, c'est que "c'est pour la misère que l'homme est né" (7).
A partir de 5, 8, Elifaz prend position en son nom propre, et non plus en se projetant dans le rôle de "toi" ou de "l'imbécile" : "Quant à moi, je m'adresserais à Dieu". Cette sorte d'opposition entre 5, 1 ("Fais donc appel !") et 5, 8 ("Quant à moi je m'adresserais à Dieu") souligne dans ce nouveau paragraphe l'absence d'intermédiaire entre celui qui a une cause à défendre et Dieu à qui exposer cette cause. L'opposition souligne que l'invite à faire appel est une fausse piste, parce qu'elle introduit un tiers, un médiateur qui s'interpose entre "toi" qui se considère victime et le supposé juge injuste que ta détresse accuse. Ce faire appel n'est que "démence" (Chouraqui)
Se retrouve désormais le penchant à l'immédiat noté dans le chapitre 4. C'est l'immédiateté d'un point de "vue" hors du temps et hors de l'espace afin de pouvoir embrasser le passé et le présent de "toi", ainsi que "ta" transformation (4, 2-6), et c'est l'immédiateté d'une "vision" (4, 12-16) qui 'colle' à la peau et aux yeux.
Dieu est décrit comme "l'ouvrier", acteur agissant, auteur "des grandeurs insondables". "Epuiser les nombres", c'est aller jusqu'au bout d'une suite indéfinie, et donc embrasser les multiples innombrables par une position qui peut dénombrer l'innombrable, qui ne peut donc qu'être infinie, capable de totaliser sans limite. Cet "ouvrier", par opposition au travailleur humain livré au temps et par conséquent ne fabriquant que misère, cet "ouvrier"-là ne fait, lui, que des actions dont le résultat est heureux. La pluie se répand sur la terre pour des champs ruisselants. Ceux d'en bas sont élevés et les assombris sont sauvés. "C'est lui qui déjoue" les actions de ceux qui agissent indépendamment de lui. Il sauve le pauvre et donne l'espérance au faible. On croirait entendre une 'maman catéchiste' qui sait tout de Dieu, sans avoir jamais eu à ouvrir son discours à l'altérité de celui dont elle prétend maîtriser la connaissance !. Cela se termine par une béatitude : "Heureux l'homme" : ce qui lui arrive, qui n'est jamais autre chose que malheur, est en réalité réprimande pour qu'il apprenne une leçon, une semonce, une "discipline" (Chq, cf. disciple) du Shadaï.
La démarche enseignée par Elifaz, c'est : tu t'adresses directement à Dieu, tu subis et tu te tais.
L'important de cette lecture, c'est qu'Elifaz se prend pour Dieu. Il y a une sorte d'identification totale à Dieu, dans la maîtrise qu'il a de ce Dieu par voie de connaissance, pour le décrire. Déjà Elifaz, en 5, 1-7, s'était mis pour ainsi dire à la place de celui à qui il parle ("tu"), en lui montrant où allait sa démence. De 8 à 27, il se met à la place de Dieu, sans même avoir à se poser comme "Je" face à un "Tu" divin, parce que les deux places n'en sont qu'une : Elifaz-Dieu. Il dit : "Quant à moi, je m'adresserais à Dieu". Mais cet énoncé n'est suivi d'aucune adresse à Dieu : sans coup férir, c'est Elifaz qui 'dit Dieu', à la différence des prophètes qui annoncent toujours : "ainsi parle le Seigneur".
Cette lecture est confirmée par le dernier verset du chapitre : "Vois, cela, … il en est ainsi". Cet énoncé, par manière de sanction, boucle sur lui-même : celui qui a parlé assure de sa propre autorité la vérité de ce qui a été dit.
Le système d'Elifaz, en éliminant pour lui-même la médiation entre les deux acteurs "Je" et "Dieu", interdit tout tiers, tout acteur médiateur entre "toi" et celui contre qui il défie "toi" de faire appel. Le système d'Elifaz est le système de l'immédiat, de l'absence d'espace de médiation. Le Dieu qu'il décrit, dont, pour s'être identifié à lui, il maîtrise l'identité, est donc un Dieu du tout, tout pouvoir, toute bonté.
"Souffrir", c'est pour "réparer" (18), pour "racheter" (20). Dieu "brise"-t-il, c'est pour "guérir". Tous les malheurs sont pour le bien de celui qui n'est rien, --- non pas ce rien (l'ensemble vide) qui n'est pas néant parce qu'il n'est pas mort (c'est le cas de Job) --- mais qui n'est rien devant Dieu qui est tout. Au sommet de "la pétulance", "tu viens au sépulcre" (26, Chq).
Cet Elifaz-Dieu, où Elifaz se perd en Dieu, est aussi la position actorielle où Dieu se perd dans un discours sans énonciation. En effet, "l'alliance" promise est avec les "pierres des champs" (23). Ce doit être la seule "alliance" de ce genre dans tout le corpus biblique, où l'alliance est toujours entre Dieu et les hommes ou son peuple. Curieuse réussite promise par cette alliance, que cette simple richesse terrienne et mortelle, à un homme qui déjà a eu tout cela et qui, de plus, craignait Dieu !
Job 6 et 7 (I)
En 6, 1, Job parle. Il parle de sa "hargne" et de sa "détresse", à peser sur une "balance". Il parle pour dire qu'il ne peut pas parler. Il fait un grand discours pour dire que ses "paroles s'étranglent" (ou divaguent).
De 1 à 7, les figures jaillissent sur des registres divers : des sentiments à peser, le sable des mers, des paroles qui s'étranglent ou divaguent, des flèches pénétrantes, du venin qui se respire, des effrois ou terreurs alignés, ensuite de la nourriture manquante puis insipide à vomir.
Ces figures qui partent dans tous les sens ne donnent pourtant pas au lecteur l'impression de l'incohérence. Qu'est-ce donc qui les fait tenir ensemble ? Peut-être est-ce du fait qu'elles sont émises du point de vue de Job : quelque chose se passe en lui, ce qui se passe est ce qui fait mal, et cela fait mal en lui, dans son intérieur. Les sentiments (du fait notamment qu'ils sont des poids lourds) vont du côté du corps, ce corps en est à rejeter ("vomit"). Même les "paroles" qui "s'étranglent ou divaguent" sont des sortes de paroles qui vont du côté de l'effet qu'elles produisent, des paroles qui s'incarnent, pour ainsi dire (LXX : ta remata, comme en 16, 25, 26).
Job affirme son conflit avec les acteurs divins que sont le Shadai et Eloha (4). La position de ces acteurs est d'être "contre", non pas côte à côte, mais face à face, pour une confrontation, un affrontement, un heurt violent : "Les flèches du Shadai sont en moi", "Les effrois d'Eloha s'alignent contre moi" (4). Ce dispositif d'acteurs, qui est mis en place à partir du point de vue de Job, est le contraire de celui mis en place par le discours d'Elifaz, qui, lui était tout fusionnel, toute confusion avec Dieu. Peut-être même le discours d'Elifaz (du type : subis et tais-toi !) a-t-il fait évoluer par effet inverse celui de Job : en 3, 25-26, Job en était au simple constat : "la terreur … m'atteint … le tourment qui vient". Désormais, c'est Shadai, c'est Eloha qui est contre lui, dit-il, comme un ennemi.
On pourrait se demander dans quelle mesure hargne et détresse, qui sont des passages de fait, sont les passages obligés pour que l'acteur qui ressent ce 'mal en lui' se positionne de telle sorte que l'acteur divin vienne à lui en lui faisant face. Les sentiments qui donnent accès à cette prise de position insistent sur le fait qu'ils se disent du point de vue de l'acteur qui les éprouve et ce point de vue fait valoir le texte comme énonciation.
En 5, 8, Elifaz dit : "Quant à moi je m'adresserais à Dieu". Mais, à la suite de cet énoncé, il s'adresse d'autant moins à Dieu, qu'il est en confusion avec Dieu, qu'il 'se prend pour Dieu', sous la forme de son 'tout savoir' de Dieu. Ce qu'Elifaz proposait ("je m'adresserais à Dieu"), il est incapable de le réaliser parce que sa parole n'est pas du genre remata, c'est-à-dire qu'elle est sans effet possible, qu'elle n'est pas en capacité de 'parler' vraiment. Job, lui, vise à le réaliser : "Qui fera que ma requête s'accomplisse ?" (8).
A la différence de la proposition provocante d'Elifaz en 5,1, "Fais donc appel !", ce n'est pas un juge d'appel qui viendrait doubler un premier juge dont les malheurs de Job sont la sentence, mais c'est un avocat que Job demande. Une idée vient au passage : est-ce qu'une lecture chrétienne retient la question de cet acteur potentiel à fonction d'avocat, en se demandant "Qui ?" ? La demande d'avocat est une demande engagée en face de Dieu, une demande qui parle, parce que face à Dieu elle campe un dispositif d'interlocution : "Je n'aurai mis en oubli aucune des 'remata' (paroles, dits, sentences) du Saint" (10) (dans la LXX : remata agia theou mou, les paroles saintes de mon Dieu).
Cette disposition actorielle d'interlocution, d'affrontement de parole, confère au texte sa valeur d'énonciation : cela parle dans le texte, d'autant plus fort qu'il y aura "sursaut de joie dans la torture implacable"(10) : cet énoncé est surprenant, il ne peut faire effet de sens que s'il est entendu à partir du point de vue de Job : l'accès à l'acte même de parler est ce qui compte par-dessus tout, quel que soit le contenu de la parole. C'est l'accès à l'acte même de parler, c'est-à-dire à l'énonciation, quel que soit ce qui est énoncé, et même si ce que cet énoncé c'est "me broyer, me rompre, la torture".
L'énonciation, comme effet du texte lorsqu'il est lu, est ici d'autant plus repérable que le point de vue où ce que dit Job oblige le lecteur à se placer est plus provocant : "sursaut de joie dans la torture implacable".
Avec les figures d'espérer (8 et 11), d'attendre (13, des souhaits et du futur, le temps rejoint le corps ("ma chair est-elle de bronze" 12) pour l'énonciation. Le corps est l'indice de ce qu'on peut appeler le réel.
Le livre de Job devient peu à peu un livre sur les conditions réelles d'une parole qui parle, bien plus qu'un livre sur la souffrance. Le malheur ainsi que la souffrance qu'il entraîne sont plutôt le dispositif mis en place pour que s'y trace les procédures de l'énonciation.
Le texte se poursuit en 14-21 en une sorte de parabole, qui touche justement au cours du discours comme à un cours d'eau. "Mes frères ont trahi comme un torrent" (15). Cette trahison est à la mesure de la déception de ceux qui comptaient sur les eaux de ce torrent : ils "se perdent" (18b) à les chercher sans les trouver parce que "à la saison sèche (les torrents) tarissent, à l'ardeur de l'été ils s'éteignent sur place" (17). Mise en forme de parabole, la paraphrase du texte pourrait être : il en va du discours comme des eaux du torrent ; on croyait les trouver abondantes, mais à la saison sèche, leur cours tarit et s'éteint sur place.
On peut bien mettre tous ses espoirs dans la parole, mais il arrive qu'on soit déçu, qu'on éprouve le sentiment d'avoir été trahi. Car il arrive que la parole ne tienne pas ses promesses. Elle peut être discours sans cours, sans eau vive, tari, à sec. C'est alors que le discours parle pour ne rien dire. Sans temps (pour espérer et attendre), sans corps (sans faire droit aux affects de hargne et de détresse), le discours devient idéologique. Sans énonciation, il se réduit aux énoncés d'un savoir sans âme, parlant pour ne rien dire ; il ne parle plus. Telle est la réfutation véhémente d'Elifaz par Job : "Mes frères ont trahi" (15), "Vous n'existez pas" (21)
A partir du verset 21, apparaît un "vous". L'interlocution jusque là cachée dans l'énonciation, devient énonciation énoncée, adresse explicite. Il y a comme un paradoxe : Elifaz, en 4 et 5, ne cessait de s'adresser à Job, mais en réalité il ne parlait à personne dans sa parole pour ne rien dire, dans ses énoncés sans énonciation, dans son discours aux eaux sèches. En 6, 1-20, on ne sait pas à qui parle Job et pourtant sa parole est si parlante qu'un vous fait surface en 21, un vous adressé à une catégorie d'acteurs disponible sans doute à bien d'autres qu'Elifaz et les deux autres.
Job 6 – 7 (II)
Au chapitre 7, des versets 1 à 6, Job, qui a "pris la parole" en 6, 1, ne s'adresse explicitement à personne. Puis, de 7, 7 à la fin, 7, 21, il s'adresse à "tu". De même, au chapitre 6 : de 1 à 20, Job parle sans s'adresser explicitement à quiconque ; pourtant sa parole est 'parlante', et en 6, 21 affleure un "vous". De même que ce "vous" est disponible, n'étant pas réservé à Elifaz et aux deux autres, de même le "tu" est disponible, puisqu'il n'est pas dit que Job s'adresse à "Dieu" (ni Shadaï ni Eloha, pourtant cités en 6, 4 et 6, 8-9). Ce "tu" n'a pas d'autre détermination que d'être celui à qui Job s'adresse, celui qui est là pour instaurer une disposition d'interlocution.
A partir de 7,1, les figures du temps sont nombreuses. C'est le "temps que le mortel vit sur la terre (1), temps de "corvée". Ce temps est tendu vers un terme : "soupire après l'ombre … attend sa paye … le soir n'en finit pas … jusqu'à l'aube … et surtout mes jours ont cessé, à bout de fil" (6). Il y a un effet d'amplification, depuis l'angoisse d'un soir et les cauchemars d'une nuit, jusqu'à l'ensemble des jours d'une vie. Amplification et intensité croissante, la tension devenant d'autant plus forte que Job est "à bout", qu'il touche à une limite.
De 6 à 8, se lisent du passé ("mes jours ont couru") et du futur (les différents "yeux" qui "ne reverra plus, ne discernera plus, seront sur moi"). Entre ce passé et ce futur, un présent prend beaucoup d'importance : "Rappelle-toi", la mémoire embrassant le temps dans cette sorte de présent qui dit : "ma vie n'est qu'un souffle".
Il y a de franches notations somatiques : "ma chair, ma peau" (5), et une question reste ouverte, celle du rapport entre l'être-temps et l'être-corps. Peut-être cette question est-elle habitée par la distinction à faire entre la mort et le corps : "La mort plutôt que ma carcasse" ("mes os" Chrq, LXX et Vulgate, 15). Habituellement, le corps est le marqueur de la mort, et même de la mortalité. Ici, il y aurait une "mort" à distinguer, une mort qui serait cet "étranglement" (15) qui rappelle ici le "mes paroles s'étranglent" de 6, 3. Cette mort-là aurait quelque chose de la 'kénose', le mot des LXX qui se trouve au verset suivant, en 16b : "écarte-toi de moi, vide (kenos) en effet la vie de moi".
Quant aux trois "yeux" (7-8), ils dénotent sans doute trois points de vue, trois positions à partir desquelles pouvoir interpréter. Le dernier point de vue est celui que Job attribue à "tu" : "tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être" (8). Il y a là comme un paradoxe : comment les yeux de 'toi' pourront-ils être sur "moi" quand je ne serai plus ? Des yeux ne peuvent pas être sur un objet qui n'est pas.
Ce paradoxe, cette impossibilité logique, est sans doute pour dire quelque chose qui ne peut être exposée, quelque chose qui est du domaine des "paroles qui s'étranglent" parce qu'elles sont indicibles. Pour tenter de l'évoquer, il faudrait pouvoir dire quelque chose du genre :
- la mémoire de "toi" ("rappelle-toi")
- introduit un point de vue (une compétence d'interprétation partant de la source qu'est l'énonciation)
- selon lequel sont distingués le fait que Job arrive au bout du fil de ses jours ("cessé d'être") et pourtant les yeux de "toi" sur lui.
Ce point de vue où les yeux de "toi" voient le 'cessé d'être' appartient à la parole dans sa source, à la force énonciative. La conséquence en est que Job lui-même se décide pour laisser venir en lui cette force énonciative : "Donc je ne briderai plus ma bouche ; le souffle haletant, je parlerai" (11). Il s'agit bien d'accéder purement et simplement au régime de la parole.
Le dégagement de l'idée d'énonciation du tissu des énoncés, est soulignée par la proclamation décisive : "je parlerai" qui se distingue du "Je me dis : Quand me lèverai-je ?" (4). Ce qui fait la différence, c'est d'une part le pur accès à la parole sans souci de quoi dire, et d'autre part, et corrélativement, la situation d'interlocution (je-tu) et non pas seulement le 'réfléchi' de "je me dis".
Il y a dans cet accès à l'énonciation, quelque chose qui parle de la parole, comme décision de celui qui devient acteur de la parole dans sa source et sa force énonciatives.
Cet acteur de sa parole n'a plus besoin de demander un avocat (cf. 6, 8 : "Qui fera que ma requête s'accomplisse ?"). C'est lui qui parle en direct, en tant que "plaignant" : "je parlerai … je me plaindrai" (11). Du fait qu'il est acteur de sa parole, le "tu" auquel il adresse sa plainte n'a plus besoin d'être nommé "Dieu" (cf. 6, 9) : personne autre que Dieu ne peut être là.
Les acteurs de l'énonciation instaurée par "tu" ("Rappelle-toi … tes yeux", 7-8) suffisent désormais à une parole qui va avec cette "mort", avec cet "étranglement" (15), une parole qui ne se contente plus de débiter des énoncés, mais qui laisse sourdre à travers la strangulation la source de la vérité fiable (cf. 6, 28 : "Daignez me regarder, vous mentirais-je en face … Pas de perfidie !"). Cette remontée vers la source de la parole, c'est-à-dire vers l'énonciation, traverse l'étranglement d'où ne sortent que des énoncés (étranglement qui est dû à l'absence des causes du manque, de la "carence" (Chrq, 21), du vide de la kénose).
Une lecture chrétienne se laisse là envahir par l'indicible de la résurrection, interprétation croyante d'une certaine mort.
L'aspect fiduciaire (cf. la perfidie de 6, 29-30), c'est ici l'introduction dans la foi que réalise un certain genre de parole : une parole qui qualifie autrement les faits (ce sont productions d'un 'faire') et les constats (ce sont les résultats d'une "inspection", 18), (tout en notant la question du "péché" ou de la "faute"1, en 20 et 21), qui qualifie autrement le 'voir' qui "épie", autrement qu'en espionnant, un 'voir' né du paradoxe que "tes yeux seront sur moi qui aura cessé d'être" (8).
Cet aspect fiduciaire est indiqué par les interrogations insistantes de la fin du chapitre. Qu'est-ce que je suis pour toi ? Qu'est-ce que tu me veux ? "Pourquoi m'avoir pris pour cible ?" (20). L'intensité du temps est devenue tension entre les acteurs "je" et "tu", perceptible dans la dernière expression (21d) qui reprend en la modifiant celle du déclenchement de la compétence d'interprétation (et donc la mise en jeu de l'énonciation) :
21d :"Tu me chercheras à tâtons : j'aurai cessé d'être".
8b : "Tes yeux seront sur moi, et j'aurai cessé d'être".
Job 8
Bildad s'adresse dès le départ à Job en lui disant "tu". Il fait intervenir Dieu, le Puissant (El, Shadaï) en 3, 5, 13, 20, donc tout au long de son discours.
Il semble au premier abord que la manière dont le texte tisse le temps est une donnée importante. En 3, "Dieu fausse-t-il le droit ? Le Puissant fausse-t-il la justice ?" : c'est un présent, qui est celui de la présence du droit et de la justice. Entre Dieu et le droit, rien de faux ne peut se glisser. En 4-6, ce sont des actes ou des attitudes humaines qui sont suivies d'une réaction de Dieu. La construction est : "si … alors". L'action de Dieu ("il les a livrés, il veillera, il restaurera") vient après l'attitude humaine ; elle est une réaction conditionnée par l'action des fils de Job ou par l'attitude religieuse et morale de "toi".
Une fois affirmé que rien de faux ne se glisse entre Dieu et le droit ou la justice, entre Dieu et la loi, une fois affirmé donc que Dieu et la loi sont en présence l'un de l'autre et comme en équivalence, il y a une automaticité de la punition et de la récompense. C'est un système de rétribution qui aboutit à un marchandage : arrête de ressasser des paroles dans le désordre de la tempête, sois pieux et droit, et Dieu te récompensera ! D'ailleurs, à la fin du discours en 21, le meilleur pour Job sera que "sa bouche se remplisse de rire et ses lèvres de hourras", c'est-à-dire qu'il ne puisse plus parler.
Il y a donc dans le discours de Bildad une opposition entre "les paroles qui soufflent la tempête" et une conduite honnête et droite devant la loi qui seule compte. Ce discours contredit le discours précédent où Job découvrait en lui la force énonciative de la parole : en 7, 11, "le souffle haletant, je parlerai".
Il y va de l'opposition entre 'parler en Je', c'est-à-dire devenir sujet parlant, et se ménager par marchandage un "avenir florissant" (7). On perçoit que le discours de Bildad trafique déjà les données, car le début du livre de Job a pris soin de décrire Job comme "le plus grand de tous les fils de l'Orient" (1, 3) et pas du tout comme celui dont "les débuts ont été peu de choses" (7).
Que Job ait essayé de dire Je et d'en appeler à son interlocuteur, cela se heurte au discours de Bildad : tais-toi ! C'est normal, au sens où c'est dans la norme.
Le temps permet encore d'entrer dans la lecture de 8-10. En 8, "Questionne l'âge premier" (Chrq). Il faut donc remonter dans le passé jusque même à l'origine. "Nous qui ne sommes que d'hier, nous ne savons rien". Il s'agit de savoir, de connaître, de détenir un contenu de savoir déposé dans des "sentences". Et ce savoir se marie avec le passé et même avec le passé de l'origine.
Le discours précédent de Job était parvenu à distinguer l'énonciation comme filigrane de la texture des énoncés : c'était le passage de l'expression "Je me dis : Quand me lèverai-je ?" (7, 4, forme réfléchie du dire, suivi du contenu de ce qui est dit) à l'expression "Le souffle haletant, je parlerai" (7, 11, accès à être sujet parlant, accès à l'énonciation sans avoir à donner le contenu de ce dont il va parler).
Les paroles dont il faut recueillir la mémoire sont ici celles des ancêtres : elles sont liées à l'instruction (enseignement) : en 10, "eux t'instruiront et te parleront". Faut-il lire dans cette 'instruction' un écho de la Tora, de la Loi ? En tout cas, ces réalités si importantes, parole, mémoire, Loi, sont ici dramatiquement réduites à n'être qu'une suite d'énoncés, appelés "sentences" : c'est là qu'est, pour Bildad, le contraire de la fausseté (cf. "Dieu fausse-t-il le droit ?", 3). On tombe un peu de haut lorsque le contenu de ces sentences se situe dans le domaine de la botanique, avec le jonc ou le papyrus, le roseau, la fleur et l'herbe, l'eau et le dessèchement.
De 13 à 15, c'est la configuration de la fragilité qui semble dominer. Elle qualifie "ceux qui oublient Dieu", c'est-à-dire ceux qui passent à côté de l'objectivité des sentences, à côté de ce qui est clair et évident comme le sont les lois naturelles des plantes. Oublier Dieu, c'est méconnaître la solidité des instructions reçues des générations d'antan, de l'âge premier. A la solidité des choses clairement définies s'oppose la fragilité. Cette fragilité est celle qui est implicitement attribuée à Job.
Deux systèmes s'affrontent pour prendre en charge et Dieu et la parole. Dans le système de Bildad, tout est soumis aux énoncés de la Loi. Dans le système de Job, tout est en attente de devenir sujet par l'accès à l'énonciation qui se distingue des énoncés ('parler en Je', ce que ne fait jamais Bildad).
De 16 à 19, cela pourrait être une parabole. Il semble que ce qui guide la métaphore, c'est là encore la question du temps, sous la forme des "racines" qui font écho aux "générations d'antan" de 8. Ces racines sont caractérisées par le fait qu'elles "s'entrelacent dans la pierraille, explorant les creux des rocs" : avec cette figure du roc, vient la profonde solidité, cette solidité seule capable de relever le défi de la fragilité de "ceux qui oublient Dieu" (13).
L'arbre est-il "arraché à sa demeure", il perd toute reconnaissance : si tu ne respectes pas la loi des anciens, je ne te connais plus. Il n'y a donc d'identité reconnue que par l'enracinement dans des traditions qui remontent jusqu'à l'origine, traditions de lois énoncées comme sentences objectives et sûres comme le roc.
Au verset 19, les traductions varient de la joie au pourrissement. C'est dire la difficulté du texte. Le malheur du déracinement, conclu par "Vois, ce sont les joies de son destin", peut-on simplement le lire en pensant que c'est 'ironique' ?
Enfin les versets 20-22 sont introduits par la répétition de ce "Vois". C'est une manière d'imposer impérativement une manière de voir, c'est-à-dire la règle de l'interprétation. Dans cet impératif, il y a écrasement du sujet Job. Job à qui Bildad s'adresse en lui disant "tu" d'entrée de jeu, n'est plus en réalité qu'un objet, à qui il est dit ce qu'il doit voir. Ce qu'il doit voir, c'est la simple alternative de "l'homme intègre" et des "malfaiteurs", le bien et le mal (20). En 21, reprenant l'avenir de "l'homme intègre", Bildad sait que Dieu "va remplir ta bouche de rires et tes lèvres de hourras" (comme cela il ne parlera plus). En 22, c'est la reprise des "malfaiteurs", "tes ennemis … les méchants ne seront plus". Ce savoir de Bildad le fait se prendre pour Dieu Le Dieu de Bildad ne fausse pas le droit, mais il en fausse l'énoncé en excluant l'énonciation et donc la question du sujet : telle est la position de l'intégrisme. Ce savoir connaît le sens des choses et même ce que Dieu va faire. Job n'a plus rien à dire. Qu'il abandonne donc cette parole où se recherche l'accès à l'énonciation pour devenir sujet !
Job 9 et 10 (I)
Dès le verset 9, 3, il est question de plaider. La scène est donc celle d'un tribunal, l'isotopie est celle d'un jugement en justice. Au fil du discours, les figures abondent dans ce sens : accusateur ou juge (15), faire appel au droit (19), assigner, juste, condamner, innocent, scélérat ou criminel, des juges (19-24), acquitter, coupable (28-29) et jusqu'en 32, comparaître en justice.
Cependant cette isotopie de jugement en justice est absente de 5 à 13. Dans ce passage, il s'agit de mettre en désordre, puis de fabriquer ou de faire, puis d'une sorte de supériorité absolue d'un Dieu impossible à atteindre. L'isotopie alors est celle de la création.
La question se pose : pourquoi la mise en scène d'un tribunal est-elle interrompue par l'évocation du Dieu créateur qui, en plus, commence par la mise en désordre des créatures ? En 5-7 : montagnes culbutées, terre ébranlée dont les colonnes chancellent, soleil qui ne se lève pas, étoiles scellées ?
Une réponse pourrait être qu'au chapitre précédent Bildad a campé l'isotopie de la justice et de la loi, cette loi qui permet d'opposer l'homme intègre et les malfaiteurs ou méchants. Le passage par la création place cette dichotomie en Dieu lui-même : désordre et ordre, défaire et faire sont deux aspects du Dieu créateur lui-même. Il y a donc dans le système de Bildad quelque chose qui ne va pas : la tempête (8,2) que Bildad reproche à Job de déclencher par ses paroles, n'est-ce pas aussi le cataclysme des créatures dont Dieu est le maître : il ébranle la terre, ordonne au soleil de ne pas se lever, etc. Si la Loi condamne Job pour sa tempête, condamnerait-elle Dieu pour son tremblement de terre ?
La reprise de la scène en forme d'action en justice, de 14 à la fin du chapitre 9 pourrait être interprétée comme une sorte de discours insolent de Job, dénonçant l'arbitraire et l'injustice d'un Dieu qui profite de sa puissance (19) pour écraser le plaignant : Si même je suis juste (15) il m'écrase … sans raison (17). Cette interprétation est insatisfaisante. Ce n'est que peu à peu que l'erreur de cette interprétation se laisse approcher.
A la fin du chapitre, vient cette idée étonnante : en 33, s'il existait entre nous un arbitre (ou juge ou accusateur, en tout cas un tiers entre Job et Dieu). L'hypothèse d'un médiateur, conçue du profond de l'âme de la sagesse en Israël, annonce l'interprétation chrétienne dans sa constance, à savoir que la Loi indique le salut, et c'est sa grandeur, mais elle ne peut le réaliser avant que Jésus ne l'accomplisse. L'hypothèse d'un médiateur ouvrirait la possibilité d'accéder à la parole (je parlerais) ou elle en ouvre le projet immédiat (je parlerai, repris en 10, 1). Il semble que le point d'aboutissement du discours de Job en ce chapitre 9 soit du genre : je suis bien d'accord sur la Loi, sur le Dieu de la justice (9, 1). Mais cela ne suffit pas, il me faudra devenir 'parlant'. Ainsi est repris ce qui a été lu précédemment de l'aptitude à l'énonciation, de l'accès à devenir sujet parlant (cf. 7, 11). Cette aptitude à l'énonciation dépend de soi seul : je suis seul avec moi (Tob 1975). Il est impossible de se contenter d'une situation vis à vis de la Loi (cf. 'tais-toi, c'est normal', leitmotiv de Bildad). Il n'y a qu'une issue à cette situation impossible, c'est de se situer comme acteur de parole.
Juste avant cette finale du chapitre 9, le verset 32 prend de l'importance : C'est qu'il n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réplique et qu'ensemble nous comparaissions en justice. Dieu n'est pas un homme comme moi : tel est l'argument principal. Le système de Bildad, divinisait la Loi. Mais alors la Loi se retournerait contre Dieu, elle le jugerait de malfaisance s'il ne se défendait par un simple coup de force. Et alors il serait un homme comme moi. C'est pour cela que la scène du jugement en justice ne peut pas résoudre l'impossible de la situation de Job face à Dieu.
Vient à jour une interprétation selon laquelle Dieu, qui n'est pas un homme comme moi, ne peut être réduit à être l'équivalent de la Loi, réduit à la simple fonction de séparer l'intègre et le malfaisant. Le désordre sort de lui aussi bien que l'ordre, le défaire tempétueux aussi bien que le faire le plus grandiose. Mais la raison de cette double puissance, c'est qu'il est au-dessus : sous lui sont prostrés les alliés du Typhon (14). Le Dieu que cherche Job est donc 'par-delà le bien et le mal'.
Aussi bien la question n'est plus la condamnation du juste (20) et la face des juges que Dieu voile devant les scélérats (24). Ce que l'on prenait pour un arbitraire répugnant (21) n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Si l'innocent comme le scélérat, Dieu l'anéantit (22), ce n'est pas qu'on ait affaire à Dieu inique. C'est que par rapport à la puissance même qu'est Dieu (19), la distinction entre l'innocent et le scélérat n'a pas de poids : ce n'est pas la distinction entre le juste et le scélérat qui donne accès à Dieu.
La question, c'est l'accès à Dieu. Elle est impossible, la position de justice devant Dieu (2), parce qu'il est à la fois l'adversaire et le maître du jugement. La Loi est juste mais elle ne résoud rien. Ce que Job recherche, c'est la position de parole à la face de Dieu.
C'est cette position de parole qui est postulée. La prendre, c'est passer par un surprenant il faut que je sois coupable ! (29). Quelle est cette nécessité : Il faut. L'interprétation psychologisante consiste à dire que Job en révolte contre un Dieu inique aboutit là à une sorte de démission suicidaire, à un sentiment d'abandon, purement et simplement écrasé (Pourquoi me fatiguer en vain ?, 29). Mais cette interprétation psychologisante ne rend pas compte d'un Dieu qui n'est pas un homme comme moi.
Cette difficile nécessité (Il faut que je sois coupable) contraint à interpréter la "faute", source de cette culpabilité, ailleurs que sous la Loi qui discerne l'intègre et le malfaisant, le juste ou l'innocent et le scélérat. La Loi a l'avantage de dire la faute, mais elle n'a pas la puissance de traiter la culpabilité. En tout cas, le lecteur sait que s'il faut que Job soit coupable, il faut qu'il soit coupable d'une faute qu'il n'a pas commise. Ce n'est donc pas une faute morale. Mais alors de quelle faute s'agit-il ? Est-ce une faute dont la culpabilité se traite par je parlerai face à un Dieu qui n'est pas un homme comme moi ?
Job 9-10 (II)
Au début du chapitre 10, Job, qui a pris la parole en 9, 1, affiche désormais à la 1ère personne (Je) l'écœurement qui l'affecte et qui le pousse à parler : Mon être abhorre la vie, je m'abandonne à mon épanchement et parle dans l'amertume de mon être (Chrq). Sa vie affectée lui donne à parler (ce qui est sans doute un leitmotiv du livre de Job, et qui va au-delà d'une remarque d'ordre psychologique). De plus, la parole de Job s'adresse désormais à Dieu : Je dirai à Dieu : Ne me traite pas … fais-moi … Prends-tu …
Il est question de savoir ou de connaître. Mais peut-être cette dimension cognitive n'est-elle là que pour manifester son insuffisance. En 2 : Fais-moi connaître tes griefs contre moi, cette demande ne sera pas satisfaite. Et pour cause ! En 7 : À ta connaissance, je ne suis pas un criminel.
Se retrouve le tissage des deux parcours figuratifs lus depuis le début de ce discours de Job : le parcours d'un jugement en justice et celui de la création. La question, déjà au chapitre 9, était de l'articulation de ces deux parcours : pourquoi la création intervient-elle dans la question d'un jugement, juste ou injuste, de Dieu sur Job ?
Au verset 9 : Rappelle-toi : tu m'as façonné comme une argile. Voici que la création de l'homme est placée sous le signe d'une mémoire : Rappelle-toi. Cet appel à mémoire oriente la lecture vers la manière dont le texte organise le temps. Les versets 4 et 5, pour redire la différence entre Dieu et l'homme (déjà dite en 9, 32 : c'est qu'il n'est pas homme comme moi), parlent des yeux de chair et de la durée des jours d'un mortel et des années d'un humain, d'un temps qui n'est pas celui de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. La durée de Dieu n'est pas celle de l'homme.
Ces jours de l'homme et cette durée de vie reviennent en 18-22.
La temporalité permet aussi de distinguer le créateur et le juge. Le créateur, comme initiateur, comme principe, est en premier avant la créature, avant l'homme sa créature. Le juge, au contraire, 'poursuit' le criminel : il vient en second, après que le criminel a commis son crime. La création, c'est une action ; le jugement, c'est une réaction. Dieu créateur passe en premier devant l'homme ; Dieu juge passe en second, derrière l'homme.
Si Dieu n'était que dans le poste du juge qui sanctionne la faute, alors il perdrait sa primauté, il ne serait plus guère qu'à égalité avec l'homme, discutant d'égal à égal avec l'homme qui plaiderait sa cause (9, 2). Un Dieu bien calé dans la loi est contradictoire avec le Dieu créateur de l'homme.
Ainsi, avec la temporalité, une différence apparaît entre les parcours figuratifs de la création et du jugement. Il faudrait aussi pouvoir lire l'articulation de ces deux parcours que le texte ne cesse de tisser.
Si Dieu sait que Job n'est pas un criminel (A ta connaissance, je ne suis pas un criminel, 7), pourquoi donc cherche-t-il le tort de Job ? Oui, tu cherches mon tort et demandes ma faute, 6.
Il faudrait pouvoir tenir un tort ou une faute ou un péché, alors que Job est innocent. Il faudrait pouvoir tenir un tort dont l'homme n'est pas coupable. Il semble que ce tort tient purement et simplement aux jours de la vie de l'homme dans leur durée. Si Job était passé du ventre à la tombe (19), sans durée d'existence, il n'aurait pas eu à subir l'enquête de Dieu (6). Il suffit que l'homme existe, pour qu'un tort, une faute ou un péché lui soit imputé. Qu'il soit criminel ou innocent, cela n'y change rien : Suis-je coupable, malheur à moi ! Suis-je juste, je ne lève pas la tête (15)
Ce tort de l'homme est posé avant la distinction entre le crime commis et l'action juste, en deçà des actes bons ou mauvais, tels qu'ils sont jugés au tribunal. Cet 'en deçà' correspond à la remarque faite au chapitre 9 : le Dieu que cherche Job est 'par-delà le bien et le mal'. C'est là encore un leitmotiv du livre de Job : chercher Dieu ailleurs que par la distinction du bien et du mal.
Ce tort est donc radicalement la culpabilité d'être. La culpabilité qui habite Job est inhérente au fait d'être. Ce qu'il dit, c'est son existence accusée d'une faute qu'il n'a pas commise.
La psychanalyse a pu développer ce thème sous le signe de la dette, la dette de vie, dette à laquelle il est impossible de faire autre chose que de consentir. A noter que plus le don est conséquent, plus la dette est lourde à porter. C'est ainsi que l'affect de Job (la vie m'écœure, 1) est à la mesure du soin pris par le créateur : tu m'as fait vie et chérissement (12, Chrq). Mais peut-être le texte de Job réserve-t-il plus de potentialités encore que ce que dit la psychanalyse. Le 'péché originel' pourrait être une autre manière de dire l'humain coupable d'une faute qu'il n'a pas commise.
L'enjeu de la polémique de Job vis-à-vis de Bildad et des autres devient le suivant : si la culpabilité est mise essentiellement sous le signe de la loi qui juge et sanctionne, alors Dieu perd sa primauté. Il perd même ce qui fait qu'il est Dieu différent de l'homme. Mais sous le signe de la création, la culpabilité est un chemin de consentement au don primordial de la vie comme chérissement de Dieu. Refuser de reconnaître le don reçu, relever la tête, se rebiffer, croire que nous faisons notre vie à la mesure de la valeur de nos actions, c'est se faire prendre en chasse par le tigre, c'est se livrer aux assauts des armées (16-17).
S'il n'y avait pas de don, je serais comme n'ayant pas été (19).
Cette lecture prend de l'écart vis-à-vis de la version d'un Dieu sadique que dénoncerait Job, ce qui semble être l'esprit de la traduction de la TOB. Par exemple, la TOB traduit ainsi le verset 13 : Voici ce que tu dissimulais en ton cœur, c'est cela, je le sais, que tu tramais. La traduction de Chouraqui n'en dit pas tant : Cela, tu le recèles dans ton cœur, je le sais, oui, cela est avec toi.
Le don de la vie par le Créateur se glisse dans la figure de l'accoucheur : Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre ? Cet accouchement est une séparation du milieu originel. Sans cette séparation de ce que la création pouvait comporter de représentations fusionnelles (l'étreinte, le lait qui se prend en caillant, 8-12), sans même la position tierce du regard témoin de cette existence individualisée (aucun œil ne m'aurait vu, 18), sans tout cela je serais comme n'ayant pas été.
La loi désormais s'articule avec la création. La loi révèle le péché. Mais le péché le plus vrai, seule la création en rend compte. Sans la création, la loi ne ferait que révéler l'injustice du juge, qui impute à l'homme une faute qu'il n'a pas commise. Seule la référence à la création délivre la loi de son impasse. Il s'agit bien de culpabilité, mais pas de la culpabilité qui vient en conséquence d'une faute morale. Seule la loi articulée à la création atteint ce point où pour l'homme, il s'agit de la culpabilité d'être.
Telle est la valeur à vivre dans la durée des jours de Job. Ensuite, l'individualité de son parcours s'efface dans l'indistinct de la nuit.
Job 11
Ce discours de Sofar a des points de ressemblance avec ceux des autres amis de Job :
- il disqualifie la parole de Job (2-3 : un tel flot de paroles, tes hâbleries),
- il met Dieu en position de juge (6 : Dieu et tescrimes),
- il présuppose la maîtrise d'un savoir sur Dieu sur le ton de 'si Dieu te parlait, voici ce qu'il te dirait' (5-6 : Si Dieu intervenait … s'il t'apprenait les secrets de la sagesse, alors tu saurais que Dieu …).
Ce savoir de sagesse sur Dieu, Sofar en témoigne en décrivant la perfection du Puissant : il la compare aux éléments du cosmos que sont les cieux, les enfers, la terre, la mer, éléments pris dans leur grandeur. La perfection de Dieu a l'avantage dans les trois dimensions : elle est plus haute et profonde, plus longue et plus large.
Cette description de la perfection du Puissant la compare donc à des figures de ce qu'on peut considérer comme étant de l'ordre de la création et elle les lie à la figure du tribunal. Si la perfection du Puissant est d'une grandeur supérieure à ces immenses éléments cosmiques, alors, s'il convoque le tribunal, qui fera opposition ? (10). Se répète donc, comme dans les textes antérieurs, la question du rapport entre Dieu créateur et Dieu juge.
Mais le discours de Sofar se différencie en plusieurs points de celui de Job au chapitre 10.
- Il dit en termes d'espace d'éléments cosmiques ce que Job disait en termes de temps humain : en 10, 9, Rappelle-toi, tu m'as façonné comme une argile.
- En conséquence la perfection du Puissant, par la comparaison avec les éléments de spatialité cosmique, apparaît comme statique. Chez Job, la temporalisation engageait une dynamique (en 10, 18-19 : Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du ventre ? Je serais comme n'ayant pas été).
- L'opposition statique-dynamique se retrouve dans l'opposition entre un savoir sur les choses dans leur état et une mémoire : au lieu du "Rappelle-toi" de 10, 9, c'est, en 11, 6, "S'il t'apprenait les secrets de la sagesse … alors tu saurais que Dieu oublie une part de tes crimes".
- Enfin, là où la création temporalisée de Job était en opposition avec l'accusation d'une faute non commise (10, 6-7 : Tu recherches mon tort … bien que tu saches que je ne suis pas coupable), la création spatialisée de Sofar va avec l'évidence des méfaits
Les versets 13 à 20 sont dominés par des futurs, une fois posées certaines conditions (13-14 : Et toi, si tu apprêtes ton cœur et déploies les paumes vers lui, si tu éloignes de ta main la fraude et n'abrites pas la forfaiture en tes tentes, Chrq). Ces conditions sont morales : si tu agis de telle et telle manière, alors tu seras … Alors tu lèveras un front sans tache. Il en va comme si le but à atteindre n'était pas la Perfection du Puissant : ce but est la prétention disqualifiée par Sofar, la prétention de Job à vouloir sonder cette Perfection (7). Le but à atteindre est simplement la perfection de soi formée par la sagesse (6), un front sans tache.
A lire la série de ces futurs, qui à première vue semblent résonner comme des promesses prophétiques, il apparaît qu'ils n'ont rien de prophétique en ce sens que Dieu en est absent. Le ton est celui-ci : tu auras de bonnes récompenses pour tes efforts de bonne conduite.
A prendre les éléments de la création comme des éléments cosmiques, le seul espoir est de pouvoir vivre en harmonie avec eux (Tu dormiras en paix, 18).
A disqualifier la méditation sur l'accusation d'une faute non commise, il ne reste plus qu'à jeter loin de soi méfaits et perversité jusque là non avoués, et ce serait simple mensonge que de ne pas les reconnaître.
Et surtout, à être maître de sagesse, à savoir ce que Dieu apprend des secrets de la sagesse, la place de Dieu est prise. Le Dieu du sage est possédé par le sage. Le sage parle au nom de Dieu, comme s'il savait le tout de Dieu. Il n'y a plus d'appel à Dieu, à la différence de Job qui ne cesse d'en appeler à lui.
Les trois remarques de lecture faites au début (disqualification de la parole de Job ; Dieu en position de juge ; maîtrise du d'un savoir sur Dieu et même du savoir de Dieu), ces trois remarques se retrouvent ici, et elles se trouvent articulées à une création de type spatial et cosmique.
Sofar aboutit à ce point où la rectitude morale remplace la recherche de Dieu : Dieu est connu avec évidence, le seul problème, c'est la faute non reconnue et non avouée. Chez Job, la souffrance provoque une question au sujet de Dieu, sous l'aiguillon d'une contradiction entre son chérissement par Dieu (10, 12 : Tu m'as fait vie et chérissement, Chrq) et son accusation par ce même Dieu d'une faute dont il n'est pas coupable (10, 7).
Chez Sofar, la place de Dieu prise par la préoccupation morale fait des promesses de la sagesse, un discours auto-référencé, une sorte de boucle entre l'action bonne et le bonheur en récompense. L'absence de tiers, cet inconnu qui tenaille la plainte de Job, anéantit ici toute existence de sujet (Job n'aurait plus à être que l'objet des récompenses de sa bonne conduite) ainsi que toute énonciation (à la rectitude morale correspond, dans une sorte d'équivalence sans écart, le bonheur, si statique qu'il ressemble à la paix des dormeurs). Le sage, qui a pris la place d'un Dieu désormais sans transcendance, connaît tout dans une sorte d'évidence immédiate : le savoir de Dieu, enfermé dans le dire du sage (un dire sans sujet, sans tiers, sans énonciation), se limite d'ailleurs à discerner les méfaits, et cela sans effort d'attention (11).