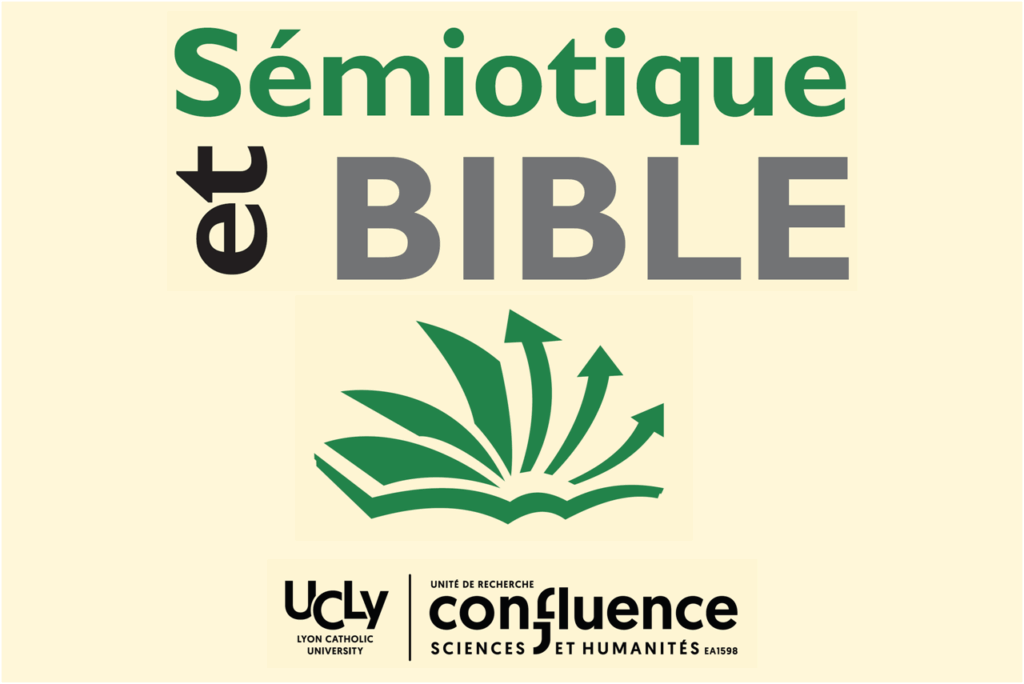Introduction
Comment engager l’analyse ? En d’autres termes : comment passer de l’appréhension directe d’un texte à l’analyse sémiotique ?
Découper un texte : de la première lecture à l'analyse discursive
Le premier geste qui sépare l’analyse de la lecture est le découpage du texte. Dans une approche intuitive, c’est-à-dire tel qu’il se donne à voir à la première lecture, le déroulement linéaire du texte semble pouvoir être organisé comme l’enchaînement de cinq étapes distinctes :
- L’appel au jugement de Salomon (3, 16)
- L’exposé du litige, exposé qui prend la forme d’un récit où sont relatés les événements qui ont conduit les femmes devant le roi (3, 17-22),
- L’épreuve qui fonde le jugement : l’ordre de couper l’enfant en deux et ses suites (3, 23-26)
- Le prononcé du jugement par Salomon (3, 27)
- Le jugement d’Israël à propos du jugement de Salomon (3, 28).
Mais pour opérer ce geste fondateur du découpage l’analyse sémiotique se donne des critères d’observation plus précis, construits sur la base des convergences d’acteurs, de temps et d’espaces. En effet elle appréhende tout texte comme un déploiement d’acteurs dans des temps et des espaces. Voilà qui fonde la notion de « scène discursive » : une scène discursive est un fragment de texte où se déploie une configuration d’acteurs dans un espace et un temps donnés – ce qui correspond à la notion de scène dans le théâtre classique -. L’analyse sémiotique commence ainsi par découper le texte en « scènes discursives ». Pour ce qui est du jugement de Salomon, un tel découpage ramènera ainsi les cinq étapes perçues à la lecture à trois scènes discursives. L’unité d’acteurs, de temps et d’espace permet en effet d’associer respectivement la première et la seconde étape (l’appel au jugement et l’exposé du litige), ainsi que la troisième et la quatrième (l’épreuve ordonnée par le roi et le jugement). D’où la proposition suivante qui distingue trois scènes, nettement différenciées par leurs acteurs, leurs temps et leurs espaces :
- l’exposition des faits (16-22)
- le jugement du roi (23-27),
- le jugement d’Israël sur le jugement du roi (28).
Énoncé et énonciation énoncée
Mais ce premier regard, porté sur le texte à partir des acteurs, des temps et des espaces, ouvre sur une seconde distinction. Elle concerne la position des différents acteurs par rapport à l’énonciation du texte.
Qu’est-ce que l’énonciation ? Le mot provient de la linguistique. Il y désigne la mise en œuvre concrète de la parole. L’énonciation c’est le « dire », dont résulte un « dit » que la linguistique désigne comme un « énoncé ». Tout texte est ainsi par définition un énoncé, en tant qu’il est le résultat d’un acte de parole (d’une énonciation). Les acteurs, les temps et les espaces qui s’y déploient sont donc des acteurs, des temps et des espaces énoncés.
La sémiotique appréhende l’énonciation dans un sens quelque peu différent. Elle ne s’intéresse pas à la situation concrète de l’énonciation mais aux marques que l’on en trouve dans l’énoncé. En partant ainsi de l’énoncé, l’énonciation n’est plus conçue comme un acte concret – d’un tel acte on ne sait rien dire, sinon qu’il a eu lieu – mais comme un présupposé « logique » : comme le « cadre implicite et logiquement présupposé par l’existence de l’énoncé » (Dictionnaire, p 125, « Énonciateur »). Et l’énonciateur réel du texte (l’auteur) cède corrélativement la place à une « instance » d’énonciation qui devient « une instance linguistique, présupposée par l’existence même de l’énoncé (qui en comporte les traces ou marques) » (Dictionnaire, p 126, « Énonciation »). L’énoncé textuel, dans son déroulement, renvoie donc à cette instance dont atteste la présence du texte : elle s’y définit comme un « lieu » inaccessible, mais désigné comme le point focal à partir duquel tiennent ensemble les divers enchaînements de figures.
La tension entre énoncé et énonciation traverse les textes eux-mêmes. Elle s’y répercute dans le clivage intervenu entre « acteurs du récit » et « acteurs du discours ». En effet, les acteurs mis en jeu dans les textes peuvent être traités comme des acteurs énoncés. Désignés comme des « ils » dont le texte raconte l’histoire, ce sont des acteurs du récit. Mais ils peuvent aussi y prendre la parole sur le mode du « je ». Ils deviennent alors des acteurs du discours, accédant à l’énonciation énoncée.
Le texte du jugement de Salomon témoigne de cette tension entre énoncé et énonciation énoncée. Ses différents acteurs - les femmes, le roi, les enfants, l’épée, Israël - sont déployés tantôt dans le récit, et tantôt dans le discours. Il en va ainsi des deux femmes. En s’ouvrant sur la mention de leur intercession auprès du roi (« Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui »), le texte les situe avant tout comme des actrices énoncées, des actrices du récit. Mais il les inscrit également sur la ligne de l’énonciation énoncée en leur faisant prendre aussitôt la parole : « L’une des femmes dit : Pardon ! mon seigneur » (17). Cependant la femme qui parle raconte son histoire, et celle de sa compagne, ce qui leur redonne à toutes deux un statut d’actrices énoncées. Dès la première scène discursive (l’exposition des faits), les femmes se trouvent ainsi inscrites dans un emboîtement complexe de positions énonciatives [1]. Salomon, pour sa part, intervient d’abord dans le texte comme un acteur de l’énoncé : c’est son statut durant l’ensemble de la première scène discursive (« Deux femmes vinrent trouver le roi » - 16). La seconde scène discursive le situe à son tour dans l’énonciation énoncée : « (Le roi) dit : L’une dit… et l’autre dit » (23). Elle prend la forme d’un dialogue, alternant les énonciations énoncées du roi et des deux femmes : « Alors la femme dit au roi »… (26) « Mais l’autre dit » (26)… « Et le roi, prenant la parole, dit »(27). En revanche, la troisième scène discursive est entièrement cantonnée dans l’énoncé. Elle consiste dans un bref récit : « Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l’on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui » (28). Cet énoncé dispose dans le texte un troisième niveau de récit, postérieur par rapport au jugement, qui était lui-même postérieur aux faits racontés par les femmes.
Le jugement de Salomon se présente ainsi comme un mille-feuille, dans lequel l’entrecroisement des énonciations tisse trois couches d’énoncés : l’histoire des deux femmes dans leur maison avec leurs nouveaux nés, l’histoire du jugement prononcé sur leur litige par le roi Salomon, et l’histoire d’Israël, apprenant à reconnaître les mérites de son roi.
Comment lire le jugement de Salomon ?
Les remarques faites pour le jugement de Salomon valent pour n’importe quel autre récit : tous les récits croisent sans cesse ces deux lignes de l’énoncé (ce qui est raconté des acteurs) et de l’énonciation énoncée (leurs prises de parole). Le texte que nous lisons ne fait donc pas exception à la règle. Mais la question de l’énonciation prend ici une importance capitale du fait qu’il s’agit d’un récit de jugement. Lorsqu’elles en appellent à la juste sentence du roi, les femmes le mettent en demeure de prononcer une parole qui tranche entre leurs énoncés sur la base de deux énonciations contradictoires, toutes deux hautement suspectes. Ce dilemme met à l’épreuve la sagesse de Salomon, et la première activité de cette sagesse consistera à discerner, les énonciations derrière les énoncés, et à démêler les multiples brouillages opérés par le texte en écoutant les énonciations plus que les énoncés.
Cette lecture vise à rendre compte des procédures et des voies de cette sagesse. C’est pourquoi elle procèdera à la manière de Salomon lui-même. Tout en s’intéressant aux énoncés enchaînés par le texte elle tentera d’en mettre en évidence les énonciations. Si elle suit, au travers de la succession des scènes discursives, la construction figurative des acteurs, des temps et des espaces, elle le fera de ce double point de vue des énoncés et des énonciations, en veillant toujours à donner le dernier mot à l’énonciation.
Première scène discursive : l'exposition des faits
Cette première scène discursive est définie, comme cela a été dit plus haut, par son unité d’acteurs (les deux femmes et leurs bébés), de lieu (la « maison » habitée par les deux femmes), et de temps (la période de leur accouchement). Mais ce point de vue incite à la décomposer, en rigueur de termes, en deux scènes successives : d’abord le temps des accouchements, puis la mort de l’un des enfants et ses suites.
L'accouchement des deux femmes : le temps de l'indistinction
« Alors deux prostituées vinrent se présenter devant le roi. L’une dit : « Je t’en supplie, mon seigneur ; moi et cette femme, nous habitons la même maison, et j’ai accouché alors qu’elle s’y trouvait. Or, trois jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, sans personne d’autre dans la maison ; il n’y avait que nous deux. » (16-18)
L'énoncé
Le dispositif discursif associe deux femmes qui habitent ensemble dans la même maison, sans personne d’autre. Ces femmes exercent le même métier (ce sont des prostituées) et sont dans le même état, toutes deux en fin de grossesse. Leurs accouchements délimitent une durée de trois jours, incluse dans la durée plus imprécise de cette première scène discursive. Qu’est-ce que le texte donne à voir de ces deux actrices ?
Il les déploie d’abord en elles-mêmes, dans leur mode de vie ordinaire. Il caractérise ce mode de vie comme une solitude « à deux ». Solitude paradoxale, puisque les prostituées sont professionnellement en contact avec quantité d’hommes. Mais ce défilé même fait d’elles des femmes sans hommes : « Nous étions ensemble, sans personne d’autre dans la même maison ». Cette solitude est marquée de plusieurs façons par la confusion. Il y a d’abord confusion des identités : tout ce qui est dit de l’une des femmes l’est aussi de l’autre, et leur « vivre ensemble » se transforme en une similitude absolue. Elles habitent le même lieu, exercent le même métier. La confusion gagne aussi les personnes. Elles constituent une sorte de couple, sans aucun tiers entre elles pour les différencier : « Nous étions ensemble, sans personne d’autre dans la même maison ; il n’y avait que nous deux ».
Le texte évoque aussi leurs accouchements quasiment simultanés. Il s’agit d’accouchements plutôt que de naissances : ils concernent davantage les femmes que les enfants. Ainsi les verbes qui en rendent compte sont construits de façon absolue, c’est-à-dire déliés de tout objet : « j’ai accouché…Or, trois jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour » (17-18). L’absence de mention des bébés est à souligner. Un dictionnaire définirait l’accouchement comme la naissance d’un enfant ? Le texte en fait plutôt un état, dans lequel les deux femmes entrent l’une après l’autre. Le délai de trois jours qui sépare ces entrée est l’unique différence posée par le passage entre les deux femmes. Cette différence n’est d’ailleurs que mentionnée, elle reste en suspens dans le texte comme une différence virtuelle. Est-elle l’amorce d’une distinction à venir ou le support d’une assimilation supplémentaire ? Qu’est-ce en effet qu’une différence de trois jours entre deux bébés ? La confusion risque alors de s’étendre des mères jusqu’aux enfants, deux fils nés presque en même temps et qui ne sauraient donc être réellement distingués.
Quoiqu’il en soit de ces développements ultérieurs, leurs accouchements mettent les deux femmes en possession d’un nouveau-né. La confusion fait retour ici, pour caractériser leurs rapports à leurs enfants. L’une et l’autre vit avec son fils dans le « corps à corps », comme le donnera à voir la suite du texte : « Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu’elle s’était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi… et le coucha contre elle ; et son fils, le mort, elle le coucha contre moi. » (19-20).
Le texte établit ainsi les femmes dans un état initial d’indistinction. Elles ne vivent pas ensemble comme des individus différenciés, mais plutôt comme une « association de femmes-avec-bébés ». Dans cette association, les enfants n’ont pas d’importance en eux-mêmes : dépourvus de toute existence autonome, ils ne sont porteurs d’aucune charge affective.
L'énonciation
Mais les femmes plaident leur cause auprès du roi, et leur prise de parole instaure un décalage vis-à-vis de ce que l’énoncé donnait à entendre. Tandis que celui-ci insistait sur l’indistinction d’une solitude à deux, l’énonciation s’entend comme un appel personnalisé : « Je t’en supplie, mon seigneur… » (17) L’inachèvement même de la supplique déplace l’accent sur les acteurs, mettant en présence le « je » individuel de la plaideuse et son « seigneur ». En l’absence même de tout contenu, la simple formulation de cette demande est, de soi, un acte de différenciation.
Il n’est pas sans intérêt que l’appel de la femme fasse surgir un tiers. Salomon est le premier acteur étranger qui, depuis le début du texte, intervienne dans la vie fusionnelle des femmes. Voilà qui éclaire rétrospectivement la solitude des femmes et leur confusion. L’absence de père, ou du moins le manque d’homme à la maison empêchait toute parole autre, qui aurait pu fonder une quelconque distinction entre les femmes. Les hommes qui se contentent de passer dans leur vie ne sont « personne » (18) au regard d’un possible témoignage. Et de même les enfants, ces « non parlants » impuissants au témoignage.
Mais il est notable que l’appel demeure inachevé : dépourvu d’énoncé, il s’arrête au seuil de la déconfusion. Aucun mot ne vient caractériser la femme qui le prononce par différence avec l’autre. Dans ce mouvement avorté de différenciation, la supplique au roi ne fait en fin de compte que renforcer l’embrouillement caractéristique de ce début de texte.
La mort de l'un des enfants et ses suites : le temps de la distinction
« Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu’elle s’était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi - ta servante dormait - et le coucha contre elle ; et son fils, le mort, elle le coucha contre moi. Je me levai le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Le jour venu, je le regardai attentivement, mais ce n’était pas mon fils, celui dont j’avais accouché. » L’autre femme dit : « Non ! mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort » ; mais la première continuait à dire : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant. » (19-21)
L'énoncé
Conformément à la règle de lecture de cette analyse, les énoncés seront étudiés d’abord, indépendamment de leur énonciation. Nous inscrivant à l’intérieur du récit de la première femme, nous tenterons donc de décrire les logiques qui s’y déploient sans nous interroger sur la mise en discours de ce récit. Ce point crucial sera pris en compte ultérieurement.
La scène discursive construite autour de la mort de l’enfant enchaîne deux temps distincts. Il y a d’abord, pendant la nuit, la mort de l’enfant de « cette femme » et l’échange immédiat du mort avec le vivant. Survient ensuite, au matin, la découverte de la substitution.
La mort de l'enfant
La mort de l’enfant vient briser la fusion. Avant de dresser les femmes l’une contre l’autre, elle interrompt leur corps à corps avec leurs fils. Elle défait pour l’une la fusion du sommeil partagé avec son nouveau-né (« Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi, - ta servante dormait -, et le coucha contre elle ; et son fils, le mort, elle le coucha contre moi » - 20), et pour l’autre le lien de l’allaitement (« Je me levai le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. » - 21).
Il est notable que la mort soit précisément provoquée par le corps à corps : « Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu’elle s’était couchée sur lui » (19). La proximité physique qui caractérise ici la maternité en reçoit une forte potentialité de danger. Si l’on rapproche cette fusion des corps de l’absence d’intérêt accordé aux enfants eux-mêmes, on peut avancer l’hypothèse suivante : une maternité uniquement focalisée sur un accomplissement de la mère, au détriment de l’enfant, pourrait bien inscrire ce dernier dans un processus de mort.
Le réveil et le rejet de l'enfant mort
À son réveil l’autre femme découvre à ses côtés un enfant mort. Le texte déploie cette découverte en deux temps - « le matin », et « le jour venu » - qui semblent accompagner le mouvement d’une prise de conscience progressive. « Le matin », s’étant levée pour l’allaiter, la femme découvre un enfant mort couché à côté d’elle. Un peu plus tard, « le jour venu », elle considère cet enfant de près (« je le regardai attentivement ») et constate qu’il n’est pas son fils (« mais ce n’était pas mon fils, celui dont j’avais accouché »).
Une lecture « réaliste » verrait là une totale absurdité, à moins qu’elle n’y découvre l’indice d’une affligeante absence d’instinct maternel… Car quelle est la mère qui, ayant trouvé son nouveau-né mort, pourrait envisager de se rendormir et de remettre à plus tard un examen soigneux de la situation ? Mais le point de vue sémiotique est différent. Il ne cherche pas à expliquer le texte du côté des « pourquoi » ni de la psychologie humaine mais à accueillir ses effets de sens. Il s’agira donc de se demander ce que produit l’étirement temporel de la prise de conscience de la mort de l’enfant. Il permet la mise en évidence des deux pans constitutifs de tout affrontement à un événement brutal : d’abord survient le choc de la prise de conscience, puis l’acceptation ou le refus de l’événement.
En l’occurrence, la femme réagit par un déni brutal : « je l’examinai attentivement, mais ce n’était pas mon fils, celui dont j’avais accouché » (21). Elle réagit en cela tout comme l’autre femme qui, en constatant le décès avait écarté le mort pour mettre le vivant à sa place. L’une et l’autre persistent dans ce rejet radical de l’enfant mort. Ne sont-elles pas allées trouver le roi parce qu’elles se disputaient l’enfant survivant ? Leurs paroles, engagées sur un même « non », redoublent ce refus tout autant qu’elles l’expriment : « L’autre femme dit : « Non ! mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort » ; mais la première continuait à dire : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant. » (21)
La force du rejet de l’enfant mort incite à en interroger la signification. Elle concerne à la fois l’identité des fils et celle des femmes.
Le texte donne au rejet du mort la forme d’un jugement de réalité concernant l’identité des fils. A l’évidence aucune des deux femmes ne reconnaît son enfant dans le « mort ». Un simple syllogisme permet de rendre compte de cette évidence : la femme a accouché d’un enfant vivant. Or, la vie n’est pas la mort : par conséquent un enfant mort est forcément un autre que l’enfant vivant ! Ce n’est pas lui. Lui, il est forcément le « vivant ».
Mais si le lien au « fils… vivant » est ainsi valorisé c’est qu’au-delà d’une simple question de reconnaissance, il affecte l’identité même des femmes. La lecture des versets 16-18 a montré comment la naissance de leurs enfants les avait transformées en « femmes avec fils »
Pour l’une d’entre elles, la mort supprime cette conjonction, ce qui remet en question sa nouvelle identité. Mais la transformation a été reçue comme irréversible, et son effacement est inconcevable. Elle déplace l’accent depuis les enfants vers le lien lui-même, vers le « avec ». La mort de l’enfant joue ainsi le rôle d’un révélateur : en brisant la conjonction de l’une des femmes avec son fils elle dévoile par la négative le sens de ce lien. Les enfants n’ont pas véritable d’importance en eux-mêmes… Prise en soi, leur existence n’a pas non plus grande valeur. Aucune des deux femmes ne s’est préoccupée de l’enfant mort, sauf pour le rejeter. Cela ne changera d’ailleurs pas par la suite. Jusqu’à l’intervention de Salomon, personne ne se souciera de l’enfant vivant autrement que pour en priver l’autre. L’enfant n’est qu’un indice de statut ontologique : après avoir été ainsi augmentée par un nouveau-né vivant, aucune des deux femmes ne peut se voir amputée par la mort de ce qui est devenu une partie d’elle-même : le mort n’est pas son fils. Voilà pourquoi son fils ne peut être mort.
L'énonciation
Mais le texte ajoute : « ainsi parlaient-elles devant le roi » ( ?). Les énoncés rapportés par le texte sont mis en relation avec l’énonciation énoncée des deux femmes. Il faut donc s’interroger sur leurs prises de parole successives.
Reconstitution ou récit ? L'impossible accès des mots aux choses
La première femme a évoqué « devant le roi » la mort du premier enfant [2], puis la découverte faite au matin de la substitution opérée entre les deux enfants [3]. La cohérence limpide de son récit donne l’illusion du direct. Une lecture naïve, ou rapide, pourrait inciter à penser qu’elle raconte les événements tels qu’ils se sont passés (ou du moins tels qu’ils pourraient s’être passés). Mais le texte rend très vite évidentes les limites de ce discours. « L’autre femme dit : « Non ! mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort » ; mais la première continuait à dire : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant. » (21). En posant l’exact opposé de ce qui vient d’être dit, l’intervention de l’autre femme dévoile trois choses essentielles.
Elle révèle d’abord que le récit de la première femme était… un récit, c’est-à-dire une histoire fictive et non un procès-verbal de la réalité. Elle dénie ainsi toute historicité à ses affirmations, qu’elle fait apparaître pour ce qu’elles sont : le développement d’un point de vue subjectif, c’est-à-dire strictement imaginaire, sur les événements qui se sont produits. Croire qu’il s’agit là de la vérité des faits, c’est se laisser duper par le jeu des mots.
Mais si la vérité est ainsi décrochée de la parole de la première femme, ce n’est pas pour émigrer vers les mots de la seconde. Son discours, en tous points symétrique de celui de sa rivale, se trouve de ce fait frappé du même caractère d’imaginaire. En cela réside la seconde révélation de ce dialogue : aucun des deux discours ne peut se prévaloir d’un ancrage dans la réalité. Voilà Salomon averti. Les énoncés des deux femmes ne constituent pas un accès vers les faits, et toute quête menée dans cette direction aboutirait à une impasse. La parole de la seconde femme doit être entendue comme une indication précieuse, dont Salomon saura d’ailleurs faire bon usage. En barrant la voie d’une « vérité objective », elle l’incite à interroger l ‘énonciation même des femmes : «Ainsi parlaient-elles devant le roi. Le roi dit : « Celle-ci dit :… et celle-là dit… »..
Cependant, la troisième révélation de ce dialogue est peut-être la plus essentielle. Par-delà l’anecdote, elle s’adresse au lecteur pour lui dévoiler le statut de toute parole. Il ne s’agit pas ici d’accuser les femmes de mentir, mais de bien voir ce que construit le langage. Car la situation des femmes est la même que celle de n’importe quel énonciateur. Parler, écrire n’est jamais rendre compte de la réalité : c’est mettre en discours des figures du monde. Recevoir cette parole ou cet écrit revient par conséquent à suivre vers l’aval le cours du texte, à accompagner les parcours des figures, en donnant corps aux effets de sens qu’elles construisent peu à peu dans ceux qui les reçoivent. Les accompagner vers cet autre lieu de « réel », le seul accessible dans l’ordre du langage : les effets de la parole sur ceux qui la reçoivent.
Si l’on n’a pas compris cela, on reçoit les énoncés à rebours, on tente de les orienter vers l’amont d’une impossible réalité. On succombe alors à ce que les linguistes nomment « illusion référentielle », et qui consiste à effacer l’épaisseur propre du langage pour croire qu’il donne accès aux choses elles-mêmes et s’efface devant elles.
L'enjeu du dialogue des femmes : nouement et dénouement de l'illusion référentielle
Les énonciations contraires des deux femmes ont donc rendu visible le piège tendu au roi par l’illusion référentielle. Il reste à tenter de comprendre ce que sont les mécanismes de ce piège, et de quelle façon le texte le dévoile.
La mise en place de l’illusion référentielle tient ici à un débrayage de second niveau (citation de Greimas). En tant qu’actrice de l’énonciation énoncée, la femme est inscrite dans une position de discours personnel, dont la parole est caractérisée par le « je », l’« ici » et le « maintenant ». C’est d’ailleurs un tel type de parole qu’engage sa supplique à Salomon : « S’il te plaît, mon Seigneur »…
Mais à peine a-t-elle ouvert la bouche pour cette demande inachevée que le texte opère un nouveau débrayage. Il développe ce discours personnel en lui donnant la forme d’un récit impersonnel, un récit dont ont été bannies toutes les marques d’énonciation subjective. La femme s’y exprime en historienne. Sa narration objective met en mouvement des acteurs (« cette femme, elle » ≠ « je »), des temps (« une nuit ») et des espaces (« dans la maison » ) du récit, et non plus de la parole : « Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu’elle s’était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi - ta servante dormait - et le coucha contre elle ; et son fils, le mort, elle le coucha contre moi. Je me levai le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Le jour venu, je le regardai attentivement, mais ce n’était pas mon fils, celui dont j’avais accouché. »
Tout, dans ce récit, concourt à faire naître et maintenir l’illusion référentielle : l’importance donnée aux indications spatiales, la mise en place d’un enchaînement temporel précis - mort de l’enfant, substitution des enfants, réveil de la femme et découverte de la supercherie -. Ajoutons encore la plausibilité des faits rapportés et peut-être aussi, derrière tout cela, l’omniscience absolue de la narratrice. Voilà qui parachève l’effacement de la dimension énonciative devant l’illusion d’un accès aux événements tels qu’ils se sont déroulés. En effaçant toutes les marques subjectives de l’énonciation, les énoncés peuvent passer pour le réel lui-même. Voilà comment l’on confond les mots et les choses.
Et pourtant, le récit contient en lui-même sa propre antidote. L’incise « ta servante dormait » vient appelée par la logique du récit : comment en effet la femme aurait-elle laissé opérer la substitution, si elle était éveillée ? Et pourtant elle révèle le caractère totalement imaginaire de ce récit. Si elle dormait, comment peut-elle prétendre savoir ce qui s’est passé ? Dès lors que l’on considère les choses ainsi on découvre comme une évidence que l’enchaînement narratif, si transparent, de la mort et de la substitution, n’est que fiction.
Comment caractériser la stratégie de l’autre femme ? Elle consiste simplement à faire réapparaître les marques personnalisées de l’énonciation, à faire émerger la subjectivité du discours masquée derrière l’objectivité trompeuse du récit : « L’autre femme dit : « Non ! mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort » ; mais la première continuait à dire : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant. » (19-21).
En rendant ainsi évidente l’énonciation que dissimulaient les énoncés, elle en révèle en outre la nature essentiellement mimétique. La figure du miroir est la plus propre à qualifier sa réplique à la première femme. Elle caractérise bien sûr ce qu’elle dit, et qui est l’exact symétrique de la déclaration de l’autre femme. Mais elle s’attache tout autant à son dire lui-même : car elle ne parle pas au roi, mais à l’autre femme. Et ce fait l’énonciation de la première femme se trouve après coup réorientée en sa direction : « mais la première continuait à dire : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant. ». Ce « continuer » est d’autant plus surprenant qu’il n’y avait eu jusqu’alors dans le texte aucune parole adressée par la première femme à la seconde… Sous l’adresse tronquée au roi émerge ainsi le débat des femmes entre elles, ce débat caractérisé par un enfermement mimétique. Au fond et pas plus qu’il n’y est question des enfants, aucune des deux paroles n’est adressée au roi : la première tente de le prendre en otage pour mener à bien son combat, et la seconde cherche juste à déjouer la manœuvre en en faisant émerger les ressorts techniques.
Deuxième scène discursive : le déroulement du jugement
Sa parole marque le début d’une seconde scène discursive, qualifiée au début de cette étude comme « le jugement du roi ». Deux ruptures intervenues au plan actoriel permettent de distinguer cette scène : l’intervention de l’épée, et celle du « on ». Ce jugement enchaîne trois étapes : l’ordre donné par le roi, la réaction des femmes, et le prononcé du verdict. Ces étapes seront examinées l’une après l’autre, du double point de vue des énoncés et de l’énonciation.
L'ordre donné par le roi
«Ainsi parlaient-elles devant le roi. Le roi dit : « Celle-ci dit : « Mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort ; et celle-là dit : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant ». Le roi dit : « Apportez-moi une épée ! » Et l’on apporta l’épée devant le roi. Et le roi dit « Coupez en deux l’enfant vivant et donnez-en une moitié à l’une et une moitié à l’autre. » (23-24)
La réaction du roi enchaîne deux temps : l’ordre s’y trouve précédé d’un commentaire, dont la brève analyse servira d’introduction à la lecture.
« Ainsi parlaient-elles devant le roi… » (22). La situation est bloquée, car aucune des deux femmes ne renonce à sa position. Et les choses durent : « mais la première continuait à dire » (22). Salomon prend alors une décision : « Le roi dit : « Celle-ci dit : « Mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort ; et celle-là dit : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant ». (23)
Ce premier acte énonciatif de Salomon est fort habile : non seulement il pose les énoncés contradictoires des femmes en vis-à-vis l’un de l’autre, mais en outre il les rattache l’un et l’autre à leurs énonciations respectives. « Celle-ci dit… et celle-là dit » (23). Il évite ainsi le piège ouvert : prendre des énonciations pour des énoncés, et confondre le développement d’un point de vue avec l’explication des faits. Cette simple juxtaposition révèle le leurre de tous les discours qui viennent d’être tenus. Voilà qui permet au roi de tourner la page du premier temps du procès et d’entrer dans un second temps qui sera, véritablement celui d’une enquête, c’est-à-dire d’une mise à l’épreuve des faits.
Venons-en maintenant à l’examen de cette mise à l’épreuve, qui repose sur l’ordre donné par le roi dans le cadre de son exercice de la justice : « Coupez en deux l’enfant vivant et donnez-en une moitié à l’une et une moitié à l’autre. » (24)
L'énoncé
Un roi, deux femmes, une épée... et pas d'enfant : l'épée comme révélateur
« Le roi dit : « Apportez-moi une épée ! » Et l’on apporta l’épée devant le roi ». Le dispositif spatial construit par le texte situe Salomon au centre, tandis que les femmes parlent « devant le roi » (22). L’enfant vivant n’y a pas de place, alors qu’il est l’enjeu du débat. Et tandis que les femmes se disputent à propos d’enfants absents, l’ordre du roi fait surgir « une épée », qui vient prendre place « devant » lui, précisément là où l’on parle. L’enfant n’est évoqué qu’à la suite de l’épée. Il apparaît ainsi comme son complément naturel, comme l’objet appelé par sa capacité de trancher… Cette antériorité de l’épée sur l’enfant inverse la norme qui veut que, dans une scène de meurtre, l’épée soit convoquée pour couper un enfant et non l’enfant pour être coupé par une épée… En assortissant l’épée et l’enfant dans cet ordre inhabituel, le récit produit un effet de surprise qui donne un relief et une signification particuliers à l’une et à l’autre de ces figures
L’épée, brandie dans le vide, demeure en suspens. Ce décrochement de tout objet précis fait d’elle une menace qui pèse sur tous les acteurs du texte. Elle devient alors la figure même du danger. Peut-être n’est-ce pas un hasard si sa seule évocation fait taire les femmes. À proprement parler, elle leur coupe la parole. C’est seulement dans un second temps que l’arrivée de l’enfant concentre et focalise ce pouvoir diffus de menace.
Pour l’enfant, sa survenue dans la dépendance de l’épée le place immédiatement en danger de mort. Voilà qui rappelle sa première apparition dans le récit de la femme : intervenu seulement après le décès du premier enfant, il n’y avait été décrété vivant que de n’être pas le mort…Quelle est donc cette vie dont la reconnaissance ne se fait que sur fond de mort ? La suite du texte permet d’avancer sur ce point. En effet, le roi dit : « Coupez en deux l’enfant vivant et donnez-en une moitié à l’une et une moitié à l’autre » (26). Comment mieux faire entendre que ce qui, dans l’un et l’autre cas, met l’enfant en danger c’est qu’il n’est pas considéré comme un sujet vivant, le sujet de sa propre existence, mais comme un objet qui peut être tranché et partagé ? Le commentaire du roi fait écho à la dispute des femmes : « mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort » (22). On débat ainsi lorsqu’on se dispute la possession d’un bien. En aucun cas lorsqu’on est en peine pour un être aimé.
Les ordres donnés par Salomon font apparaître en public le conflit de propriété que les deux femmes avaient mis en place dans l’intimité de leur maison. Ils révèlent que l’enfant est seulement, pour les deux femmes qui se l’arrachent, l’objet qui les fait mères. Ils dévoilent en même temps le fait que suggérait la mort du premier enfant : lorsque l’existence d’un enfant se trouve ainsi mise au service d’une définition « maternelle », elle est en grand péril. La figure de l’épée fait éclater avec une force proprement stupéfiante la puissance mortifère de toute « maternité » dans laquelle l’enfant n’est que le support d’un retour sur soi, l’instrument pour sa mère d’un surcroît d’identité.
« Coupez en deux ! » : l'épée et la mort
Mais l’épée n’est pas seulement dans le texte le support d’une révélation concernant les deux femmes et leur relation à l’enfant : elle a aussi, elle a d’abord le pouvoir concret de trancher. En cela elle fait signe en direction de l’enfant vivant, dont elle annonce la mise à mort bien réelle. L’intrusion de l’épée dans la scène du procès projette en pleine lumière cette mort qui menace l’enfant, si rien vient ne s’y opposer. L’épée est donc ici, au sens propre du terme, le support d’un réel dont l’irruption vient tailler à vif dans les rêves.
Il suffit pour s’en rendre compte d’anticiper la suite possible des événements : que se passerait-il si l’épée rencontrait le corps de l’enfant pour le trancher en deux ? Ce serait la fin de l’histoire, et cette fin marquerait une rupture décisive dans l’espace, dans le temps, entre les acteurs et jusque dans les acteurs eux-mêmes. Une rupture dans l’espace, car la mise à mort de l’enfant amènerait la clôture du jugement et la dispersion spatiale des acteurs. Une rupture chronologique, car cet acte poserait un irrémédiable, sans retour possible. Il instituerait distinctement un avant et un après dans la répétition temporelle où les femmes demeurent enfermées. Au temps où, grâce à la présence d’un enfant vivant, elles pouvaient encore l’une et l’autre prétendre au statut de mère, il ferait succéder un temps où toutes deux devraient y renoncer. Mais la coupure passerait aussi entre les acteurs, séparant l’enfant des femmes et les femmes du roi. Elle s’inscrirait enfin au profond des acteurs eux-mêmes, et avant tout de l’enfant, tranché en deux et séparé de sa propre vie. Mais elle passerait également dans l’intimité des femmes, coupées d’une dimension maternelle qui dépendait exclusivement de leur conjonction avec l’enfant vivant.
L'énonciation : dénouer le lien entre les mots et les choses
En s’intéressant aux énoncés, l’analyse qui précède a contemplé le piège tendu au roi par les soliloques des femmes. Elle a aussi considéré la façon dont la figure de l’épée, surgie dans l’énoncé « Devant le roi », là où « parlaient » (22) les deux femmes, mettait un terme à la répétition et venait dénouer une situation bloquée. Dans le déroulement du procès, la convocation de l’épée a l’impact de la citation d’un témoin décisif : elle marque un tournant sans retour. Mais qu’en est-il de la prise de parole qui convoque l’épée ?
Trancher le piège
Elle s’inscrit dans une rupture analogue à celle qui affecte les énoncés. L’énonciation du roi ne rebondit pas sur la situation illusoirement construite par ces dires en miroir. Au contraire, elle souligne le caractère spéculaire des prises de parole des femmes. Autant dire qu’elle se positionne dans la distance, et que cela suffit à trancher le filet tendu par les mots. Elle s’impose dès lors comme une altérité : ancrée ailleurs que dans le déjà connu, elle se déploiera autrement que dans le prévisible. « Le roi dit : « Apportez-moi une épée ! » Et l’on apporta l’épée devant le roi » (22). Cet ordre a quelque chose d’incongru qui inaugure dans le procès un nouveau mode de parole.
Le premier lieu où se déploie cette nouveauté est l’alternance des énonciateurs. La parole du roi coupe celle des femmes et lui succède. Et cette alternance est le support d’un bouleversement radical : l’ordre du roi ouvre sur le réel un discours jusque-là exclusivement déployé dans un espace imaginaire. L’analyse de la première scène discursive montrait comment les femmes, après avoir dissimulé les événements sous un tissu de mots en miroir, tentaient d’attirer le roi dans le piège où elles s’étaient elles-mêmes égarées. La présence matérielle de l’épée, en projetant l’ombre d’une mort bien réelle sur la scène de l’imaginaire, déchire le tissu et brise le miroir. Dans le nœud des paroles en boucles, elle introduit le concret d’une vie en danger.
L’imminence et la matérialité du danger incitent les femmes à se réveiller. Il y a un monde entre parler d’un enfant mort dans son lit et se faire attribuer la moitié sanglante d’un « enfant vivant » que l’on vient de voir « couper en deux ». De plus, la menace qui pèse sur l’enfant touche aussi les femmes dans leur chair. Elle les met brutalement face à l’éventualité de voir disparaître sur-le-champ l’objet qui les faisait mères. Une fois le second objet de leur pouvoir évanoui tout comme le premier, que restera-t-il de leurs « mon fils c’est le vivant et le tien, c’est le mort ! » et « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant » ?
Voilà qui les ouvre sur une alternative. Si elles restent campées dans leurs positions, si elles continuent à ne voir qu’elles-mêmes dans cet enfant et demeurent mères à la façon dont d’autres sont propriétaires, l’enfant mourra certainement. La seule façon d’éviter que cela ne se produise c’est de voir enfin l’enfant comme un sujet menacé, de s’inquiéter du danger qu’il encoure, d’œuvrer pour sa survie et de se mettre au service de son salut. L’enjeu de ce regard est énorme : c’est alors l’illusion d’une « possession maternelle » qui fondra comme neige au soleil.
L’impossible que représente l’évocation de cet enfant partagé tout vif suffit ainsi à ouvrir la possibilité que soient démêlés l’original et son reflet, l’imaginaire et le concret de l’existence. Le seul fait d’en appeler à l’épée ouvre aux femmes un chemin pour se libérer de la confusion qu’indiquaient tout autant leur mode de vie que leur commune revendication de l’enfant, ou encore le brouillage et l’entremêlement de leurs énonciations… Il rompt pour qui saura l’entendre le nœud savamment noué par les mots.
Parole de roi, parole de juge
Les effets de cette énonciation sont bien évidemment liés au contexte dans lequel elle intervient. Mais ils tiennent aussi à sa nature propre. Car la parole qui convoque l’épée n’est pas n’importe quelle parole : en tant qu’elle est proférée par un roi, elle est un ordre. J-L Austin définit l’ordre comme une parole performative [4], une parole qui fait ce qu’elle dit. Et de fait, lorsque Salomon ordonne de « couper l’enfant en deux », sa parole se matérialise immédiatement. L’épée est là, prête à couper. Cette caractéristique performative de la parole royale lui donne pouvoir de disposer du territoire soumis à sa juridiction. La parole de Salomon instaure un ordre là où les mots des femmes avaient fait régner le chaos de la confusion.
Mais la remise en ordre porte aussi sur le rapport, perverti par les femmes, entre énoncé et énonciation. En présentant une histoire inventée comme le compte rendu du réel, les plaideuses avaient confondu leur énonciation avec l’apparente objectivité d’énoncés hypothétiques. La parole royale met cette confusion en évidence. Ce qui pourrait être traduit, dans un autre code (Lacan), comme l’émergence de la dimension « symbolique » du langage. En effet, pour la psychanalyse lacanienne, le langage remplit une fonction de césure par rapport à l’imaginaire. Il coupe le rapport immédiat entre les mots et les choses, ce qui permet au réel d’inscrire un effet sur le sujet désormais divisé entre l’énonciation de son désir et la parole de l’autre. Dans ce texte, la parole de Salomon fait sortir les énoncés des femmes de leur enfermement spéculaire, imaginaire. Elle énonce que la vie n’est pas possible dans la fusion entre les mots et les choses, là où la vie et la mort sont réduites à des énoncés se donnant comme tout puissants.
En rétablissant l’ordre d’un monde dont l’appel des femmes avait perverti l’organisation symbolique, la parole de Salomon accomplit ici la dimension judiciaire du pouvoir royal. Elle opère en effet très exactement comme doit le faire une parole de juge. L’énonciation du juge ne consiste-t-elle pas à démêler la confusion en tranchant dans le vif et en faisant la part des choses ? Le piège tendu à la sagesse royale consistait à l’inviter à se cantonner dans les énoncés. La clairvoyance de Salomon lui a permis de s’inscrire à la juste place : de faire passer l’épée dans le rapport entre énoncé et énonciation.
Parole de juge, parole de père
Cette analyse de l’énonciation de Salomon permet de faire un pas de plus, et de comprendre un point demeuré obscur jusqu’ici. L’autorité du roi n’aurait-elle pu rétablir l’ordre symbolique de la parole et du monde, n’aurait-t-elle pu briser le miroir de l’imaginaire sans pour autant menacer l’enfant d’une mort imminente ? Pourquoi cette menace entre toutes ? Pourquoi le roi ne s’est-il pas contenté, par exemple, de jeter les femmes en prison et de confier l’enfant à une bonne nourrice ?
Quelle est la portée de cet ordre : « coupez en deux l’enfant vivant » ? En donnant l’ordre de tuer l’enfant vivant, Salomon utilise son pouvoir pour faire rejouer, en l’actualisant sur la scène du procès, la mort du premier enfant. On lui a raconté un scénario imaginaire. Il en fait un film projeté en public, dans l’ici et le maintenant, avec arrêt sur image au moment de la disparition. Exposé à la lumière des projecteurs, l’épisode crucial qu’occultaient les récits des femmes est désormais placé au centre de la perspective. A l’issue de cette étape de reconstitution, le juge tiendra enfin sa preuve.
Cette preuve n’est pas d’ordre événementiel mais ontologique. On ne saura jamais laquelle des deux femmes disait la vérité, car ni le roi ni le texte n’attenteront aux secrets du passé. La répétition de la mort de l’enfant ouvre sur le seul présent, et c’est en quoi elle dépasse largement la péripétie judiciaire. L’enjeu est ici d’instaurer un lien entre la mère et l’enfant : de faire à la fois surgir une mère et naître un bébé. Le choc dramatique d’un nouveau-né en danger de mort était sans doute le seul capable, par sa brutalité, de faire émerger une mère à partir de ces deux femmes empêtrées dans leur « rivalité mimétique [5] ». Une mère ? Qu’est-ce à dire ? La suite du texte permettra de répondre à cette question dans le détail. Il suffira pour l’instant de remarquer que cette émergence sera différentielle et énonciative. Différentielle car seule l’une des deux femmes encaissera le choc. Enonciative car l’accès à la maternité se marquera dans sa prise de parole, ou plutôt dans le changement d’ancrage de cette prise de parole. La scène initiale disposait deux femmes dont les discours n’étaient orientés que vers le roi, qu’elles cherchaient à influencer pour se faire attribuer un objet très désiré. Celle qui, grâce à l’épée, devient la mère, réfèrera désormais sa parole à l’enfant, et au risque imminent qu’il encourt.
Ce qu’accomplit là Salomon va bien au-delà d’une parole de roi et de juge. En permettant qu’existe une mère il se comporte en père.
La réaction des femmes – Celle qui persiste : coupez !
« La femme dont le fils était le vivant dit au roi - car ses entrailles étaient émues au sujet de son fils : « Pardon, mon Seigneur ! donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas ! » Tandis que l’autre disait : « Il ne sera ni à moi ni à toi ! coupez ! » (26)
Cette parole de père rompt le miroir, car seule la mère l’entend et y réagit. La réponse des femmes à l’ordre du roi les différencie ainsi nettement l’une de l’autre. Leur énonciation n’a désormais plus rien de spéculaire. Quant à leurs énoncés, ils s’opposent radicalement. On le voit en particulier aux places respectives qu’ils attribuent à l’épée et à l’enfant.
L’une des deux femmes reste donc sur ses positions. En écho à l’ordre du roi, elle s’écrie : « Il ne sera ni à moi ni à toi : coupez ! ». Elle prend la parole en second dans le récit, mais nous l’évoquerons en premier lieu du fait de la persistance de son point de vue.
L'énoncé
Cette femme souscrit à l’ordre de mort du roi et s’écrie : « Coupez ! » Que construit cette injonction polarisée sur le seul geste meurtrier ? Elle dispose l’épée, l’enfant et la femme dans un réseau de relations qui doit être explicité.
L’épée y reçoit le rôle purement technique d’un instrument de mort. « Coupez ! ». En envoyant le second enfant rejoindre le premier, elle devient l’outil d’une répétition qui rejoue la perte initiale. Quant à l’enfant menacé, il n’intervient même pas dans la phrase. La construction absolue du verbe donne à penser que la femme qui parle ne voit rien au bout de l’épée. L’enfant vivant n’existe pas pour elle, pas plus que n’existait l’enfant mort. Enfant déjà disparu, enfant à disparaître : notons ici une remarquable permanence dans le déni de ces êtres vivants.
C’est que le discours de la femme demeure toujours polarisé sur elle-même. Il ramène à elle seule tous les enjeux de la destruction de l’enfant. « Il ne sera ni à moi ni à toi » : ces quelques mots réduisent l’enfant à n’être que l’objet d’une propriété disputée. Seule sa possession compte. Il n’a en soi aucune valeur. Mais cette propriété elle-même ne prend sens que dans son pouvoir à déterminer, à définir une femme comme mère. En révélant la précarité de ce statut maternel la disparition du premier enfant lui a communiqué une intense valeur mimétique. Il ne s’agit plus d’être mère, mais d’être la mère. Ce que révèle l’énoncé de la femme, c’est que le danger majeur est pour elle de voir l’autre femme décrétée la mère. Plutôt que d’en encourir le risque, elle préfère elle-même renoncer à la maternité. Que disparaisse l’objet du litige !
L’énoncé de la femme se caractérise bien par une immuable continuité. Celle-ci le place tout entier sous le signe de la mort. D’où cette impression de voir se redéployer indéfiniment, en miroir, une même scène de disparition : la menace du roi sur l’enfant survivant faisait écho à la possessivité meurtrière des deux femmes. La parole de la femme, à son tour, rejoue la mise à mort et tente d’en obtenir la réalisation. Mais son ordre « coupez ! » n’est heureusement pas celui d’un roi : il n’a pas la force de déployer le germe de mort qu’il renferme en lui.
Il révèle en revanche que cette femme est bien la mère du mort. En affirmant sa volonté de voir l’autre femme privée du lien maternel, cet énoncé lapidaire révèle qu’elle-même s’en est déjà trouvé amputée. Le texte confirme cette conclusion en définissant l’autre femme comme « celle dont le fils était vivant ».
L'énonciation
Si on l’envisage à présent du point de vue de son énonciation, il apparaît à l’évidence que cette femme ne parle pas comme une mère mais comme une jalouse. Rien de son désir ne s’oriente en direction de l’enfant. Il est tout entier tourné, ou plutôt détourné vers l’autre femme. Si elle attribue à l’épée un rôle salutaire, c’est parce qu’elle lui confère le pouvoir de couper court à leur conflit, un conflit qui n’est pas tant de propriété que d’être. L’enfant est moins l’objet d’un litige qu’un ultime trouble à liquider. Il demeure comme l’unique différence venue troubler sa confusion originelle avec l’autre femme. Seul le retour à cette indifférenciation première pourra lui rendre la paix : « Il ne sera ni à moi ni à toi : coupez ! ».
Ainsi la confusion du miroir règne sur l’énonciation de la femme. Cette énonciation exclut toute altérité : si elle ne voit pas l’enfant, la femme ne voit pas non plus le roi. Elle ne s’adresse même pas à lui. Elle emprunte simplement la force de sa parole performative pour répéter son ordre à l’attention des exécutants : « coupez ! ». En outre, elle enferme les deux femmes dans le piège d’une relation où l’autre n’est qu’un double inversé de soi : la possible attribution à l’autre femme de la maternité n’est reçue par la femme qui parle ici que comme une blessure narcissique…
L’énonciation comme l’énoncé de cette femme apparaît ici comme totalement empêtrés dans l’univers spéculaire dont elle demeure prisonnière. Voilà qui les débraye de toute réalité et les enferme dans une folie meurtrière. On a l’impression que, tant que cette femme - mère de l’enfant mort - reste dans le fantasme « mon fils n’est pas le mort », on pourra tuer devant elle, sans jamais l’atteindre, autant d’enfants vivants qu’on voudra… Ainsi émerge en pleine lumière, à la surface même des mots prononcés par la femme, la folie destructrice qui anime toute maternité entièrement refermée sur elle-même.
La réaction des femmes – Celle qui change : donnez !
L’autre femme, celle, dit le texte, « dont le fils était le vivant », réagit de façon inverse. Sous le choc de la menace très réelle qui pèse sur l’enfant, elle sort brutalement de sa bulle de répétition et se libère du miroir.
L'énoncé
Cette libération est d’emblée perceptible dans l’énoncé, où soudain les choses trouvent une juste place. Pas un mot n’y est dit de l’épée, mais tout converge vers l’enfant qui, pour la première fois, apparaît comme ce qu’il est. C’est-à-dire avant tout comme un « bébé » : ce mot doit être souligné car c’est la première fois qu’il intervient dans le texte. Ce nouveau-né est perçu comme un « vivant » en danger d’être tué. Le voilà enfin devenu le sujet d’une existence menacée. Et le texte ajoute à propos de la femme qui parle : « ses entrailles étaient émues au sujet de son fils ». C’est la première marque d’affectivité qu’il mentionne…
Un bébé au centre de la perspective, des entrailles émues, une femme qui accepte de s’effacer devant la vie de son enfant : il se produit là comme une double naissance. Et d’abord la naissance d’un enfant : la durée de son suspens entre vie et mort témoigne du long temps durant lequel cette naissance, pourtant techniquement réalisée, avait été différée. Mais c’est aussi la naissance d’une mère, dont le regard s’ouvre à un monde renouvelé par l’arrivée de son enfant. Et le texte permet de comprendre que cette seconde naissance est la condition de la première.
L'énonciation
Il n’est pas neutre que la femme entre à ce moment précis dans l’interlocution. Tout comme son énoncé s’est ouvert sur le monde, son énonciation s’ouvre enfin sur l’altérité. Au lieu de demeurer enfermée comme l’autre femme dans une spécularité narcissique, elle s’adresse pour la première fois au roi de façon juste : non plus pour l’utiliser en l’attirant dans un piège mais pour lui demander d’agir en roi, d’agir sur la réalité. Elle ne tente pas comme sa rivale d’usurper la dimension performative de la parole royale. Sa parole n’est pas un ordre mais une acceptation. Elle l’exprime en nom propre : elle renonce à l’enfant pour préserver sa vie.
Il n’est pas neutre non plus que de cet ouverture sur l’altérité surgisse une parole de don : « Donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas ». La figure du don reçoit ici sa force et ses contours de la jalousie avec laquelle elle fait antithèse, et du fond de mort sur lequel toutes deux se déploient. La jalousie propose une solution en « ni… ni » qui passe par la destruction d’un enfant vivant préalablement réduit au statut d’objet : « Il ne sera ni à toi ni à moi. Coupez ! ». Le don qui promeut la vie suppose au contraire un « et… et ». Certes il passe dans un premier temps par la renonciation. L’autre femme sera décrétée mère : qu’on lui donne l’enfant en toute propriété ! Mais ce don s’exerce envers l’enfant autant qu’envers la rivale : car en acceptant de laisser aller son fils, la femme lui donne la vie. Ce faisant elle se donne à lui pour mère. La perte consentie devient ici le support d’un nouveau type de lien, qui ne se définit pas comme une appropriation [6] mais comme une fécondité.
Le prononcé du verdict
« Alors le roi prit la parole et dit : « Donnez à la première le bébé vivant, ne le tuez pas ; c’est elle qui est la mère. » (27)
L'énoncé
Après avoir écouté la réaction des femmes le roi prononce son jugement, qui porte sur deux points :
- Il donne le nom de mère à la femme qui a réagi à la menace de l’épée par le don de l’enfant. C’est la première fois que le mot « mère » intervient dans le texte, et il est prononcé par Salomon.
- En bonne logique, il attribue l’enfant à la femme à qui il vient de donner le nom de mère.
Ce jugement est un don en retour. Pris en otage entre deux femmes qui voulaient à toute force s’emparer de lui pour prolonger leur ego, l’enfant ne pouvait trouver là aucune possibilité de vivre. En poussant cette impossibilité jusqu’aux limites de sa réalisation, la menace de l’épée a fait basculer l’une des deux femmes depuis ce « prendre » jusque dans le « donner ». Le roi s’appuie alors sur ce don, dont il reprend les propres termes, puisqu’il parle à son tour de « bébé vivant », pour prononcer un jugement qui donne en retour le nom de mère, et par surcroît l’enfant, à celle qui a accepté de se dessaisir et de l’un et de l’autre.
L'énonciation
En prononçant un tel jugement, le roi exerce pleinement la dimension judiciaire de son pouvoir royal. Sa sentence, clairement appuyée sur des faits indubitables, ne saurait de ce fait être contestée.
Il poursuit également dans la mise en œuvre de son rôle de père. En suscitant un cri au plus profond des « entrailles » de la femme, il avait fait naître une mère et un enfant. Sa parole présente va plus loin encore en nommant la mère, elle décide de l’avenir de cet enfant. Salomon devient ici le tiers sans l’intervention duquel la naissance reste un simple accouchement et le nouveau-né un mort en sursis.
Ce dialogue met en évidence deux des caractéristiques importantes de la paternité comme de la maternité :
- Tout d’abord leur ambivalence. Dans le texte, les mères sont montrées comme porteuses pour leur enfant aussi bien de mort que de vie. Celle dont l’enfant est mort lui a donné cette mort après lui avoir transmis la vie. La seconde le mène aux portes de la mort avant de lui donner vie par sa parole de renonciation. Mais il en va de même du père : l’épée qu’il brandit peut aussi bien lui donner mort que vie.
- Ensuite, leur interdépendance dans la transmission de la vie. Le texte montre bien que la parole de Salomon, cette parole que nous avons définie comme une parole de père, n’a pas d’autre valeur que celle que lui attribuera la mère. L’ordre qu’il profère donne à cette mère le pouvoir d’attirer sur son enfant la vie ou la mort. Mais à son tour, celle-ci n’est capable de faire advenir son enfant à la vie que si elle s’ouvre à la parole du père et lui donne une place fondatrice. Le début du texte affirmait la toute-puissance des femmes sur leurs enfants. Celle-ci s’avère paradoxalement en dépendance de la faiblesse de ce roi impuissant à dire même ce qu’il en est de la réalité de leur lien à ces nouveau-nés. La parole de Salomon agit ici comme une épée qui portera la mort si elle n’est pas prise en compte. La femme qui ne la reçoit pas demeure dans la confusion et la mort, enfermée dans l’illusion et le déni. Pour l’autre, celle qui est dénommée « la mère », l’ordre du roi intervient comme une coupure, qui brise définitivement fusion et confusion.
Le jugement d'Israël
« Tout Israël entendit parler du jugement qu’avait rendu le roi et l’on craignit le roi, car on avait vu qu’il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. » (28)
La conclusion de l’épisode est en décalage avec les deux premiers temps du texte. Ils rapportaient des faits ? Il n’est plus ici question que de mots. Les femmes et leurs enfants ont disparu. Des acteurs des passages précédents le texte ne conserve que le roi, qu’il campe devant « Tout Israël ». La figure du jugement fait retour dans cette conclusion, mais inversée : c’est à présent le peuple qui juge son roi et évalue sa « sagesse…pour rendre la justice ».
Or, le peuple décrète « divine » cette « sagesse ». Prendre au sérieux ce qualificatif ne peut qu’inciter à revenir sur l’ensemble de la procédure mise en œuvre par Salomon dans ce jugement pour tenter de comprendre ce qu’est une sagesse divine. Le roi ne s’est pas laissé accabler par le déluge de mots des femmes, il a su se garder du piège des phrases et de leurs énoncés. Attentif à l’énonciation de ses interlocutrices il a écouté comment il lui était parlé plutôt que de s’en tenir à ce qui lui était dit. Alors ses mots ont su faire émerger la vérité de cette énonciation, rendant visible son contenu humain : en l’occurrence le poids de mort qu’elle véhiculait. Si l’on voulait résumer la sagesse divine de Salomon, on pourrait le faire dans ces quelques mots : arriver à mettre le geste énonciatif de son interlocuteur en un contenu représentable.
Éléments de lecture narrative
Au terme de l’analyse discursive, il vaut la peine d’étudier le texte d’un point de vue narratif. Cette analyse, assez rapide, ne prétend pas à l’exhaustivité mais simplement à la mise en place de repères. Elle vise à tenter de croiser les résultats de l’une et l’autre approche, et d’appréhender ainsi leurs convergences, et leurs éventuelles complémentarités. Elle suivra le texte dans son déroulement.
Nous commencerons par lire le récit du jugement proprement dit. On y constate une franche correspondance entre les découpages narratif et discursif : chacune des deux scènes discursives de ce récit correspond à un programme narratif distinct.
- La première scène discursive correspond, dans la dimension narrative, à la mise en œuvre par les deux femmes d’un même programme : se faire attribuer l’enfant par le roi. Pour atteindre son objectif d’être reconnue la mère de l’enfant, chacune des rivales tente d’initier ce programme à son profit, c’est-à-dire au détriment de l’autre. D’où la structure polémique des versets 16 à 22. Ces programmes ont tous deux l’enfant pour objet valeur et le roi pour sujet opérateur. Ils ne se distinguent que par l’identité de leur destinatrice, qui est en même temps leur sujet d’état : la première femme pour l’un des programmes, la seconde pour l’autre.
- PN 1 : F (Salomon) ⇒ (femme 1 U enfant) → (femme 1 ∩ enfant)
- PN 2 : F (Salomon) ⇒ (femme 2 U enfant) → (femme 2 ∩ enfant)
PN2 est ici un anti programme de PN1, qui est lui-même l’anti-programme de PN2 : on ne peut les distinguer, puisque le texte ne différencie pas les femmes. L’enfant est un objet qui porte la valeur de la maternité : vivant, il apporte le statut de mère à la femme à laquelle il est en conjonction.
Les paroles adressées au roi en ce premier temps sont donc autant de manipulations exercées sur lui pour l’engager dans une performance attendue de jugement. Mais Salomon se déclare incompétent pour prononcer ce jugement. Faute de preuves, il manque d’un « pouvoir juger » : « Celle-ci dit : « Mon fils, c’est le vivant, et ton fils, c’est le mort » ; et celle-là dit : « Non ! ton fils, c’est le mort, et mon fils, c’est le vivant. » (23). Il se désiste alors, bloquant le programme, et tout autant l’anti-programme, aussitôt après leur lancement.
- Mais le récit ne s’arrête pas là. Car le roi met alors en œuvre son propre programme, qui coïncide avec la seconde scène discursive du texte (versets 24-27). On pourrait le définir en ces termes : faire se révéler la mère. Il s’agit d’un programme cognitif, dont les sujets opérateurs sont les mères, le sujet d’état Salomon, et l’objet le savoir sur l’identité de la mère.
- PN 3 : F (femmes) ⇒ (Salomon U identité de la mère) → (Salomon ∩ identité de la mère)
La convocation de l’épée et la menace de mort qu’elle apporte ont ici statut de manipulation. Car le programme de « mise à mort » de l’enfant qu’elle déclenche a pour effet de décider les femmes à prendre position face au danger qu’il encoure, et à parler en vérité. De compétence il n’est pas question ici, car elle est présupposée : l’enfant est né et sa mère est dans la pièce, face au roi. La performance est accomplie deux fois, car elle est assumée par chacune des femmes en son nom propre. Ces deux performances donnent lieu l’une et l’autre au développement d’un micro-programme : celle qui sera dite la mère par la suite engage un micro-programme de don (PN4), l’autre un micro-programme de destruction (PN 5) :
- PN 4 : F (On) ⇒ (femme U enfant) → (femme ∩ enfant)
- PN 5 : F (femme) ⇒ (enfant ∩ vie) → (enfant U vie)
La femme dont le fils est mort lance donc un programme de destruction de l’enfant (PN5). Elle emprunte, elle usurpe pour cela la parole performative du roi : c’est-à-dire le rôle actantiel du sujet opérateur qui va disjoindre l’enfant de son existence. La vie de l’enfant voit ici sa valeur réduite à celle d’un objet de propriété, dont cette femme pense pouvoir disposer à son gré [7]. Il apparaît alors que ce micro-programme de destruction est en fait un nouvel anti-programme, qui vise à contrecarrer définitivement le programme (PN1 ou 2) que la femme attribue toujours à sa rivale…
En revanche la mère initie (comme destinatrice) un programme de don (PN4). Le sujet opérateur en est le « on », présent pour exécuter les ordres du roi, et à travers lui le roi lui-même, sollicité de suspendre l’ordre de mort et de le remplacer par l’attribution de l’enfant. Le sujet d’état est ici l’autre femme, celle à qui la mère accepte que soit remis l’enfant. Cet enfant est toujours un objet valeur, mais il porte à présent la valeur de la vie. Ce micro-programme de don s’avère alors comme un programme à la structure bien particulière : il s’agit d’une « communication participative », c’est-à-dire d’un don sans perte. Lorsque la mère abandonne son enfant à la femme qui le lui dispute, elle donne à nouveau - et cette fois en vérité - la vie à cet enfant. Ce don de vie est alors ce qui la constitue comme mère. Ainsi le renoncement à la présente physique de l’enfant (le don à l’autre femme) n’entraîne pas la perte de la maternité, bien au contraire.
Sans même qu’aucune de ces performances contraires n’aille à son terme, la sanction du roi confirme ce que les programmes des femmes avaient montré : la mère est celle qui est prête à donner l’enfant. Elle recevra un double objet message : le nom de mère, et par surcroît l’enfant vivant. Pour la femme, aucune sanction n’est formulée : elle est, de fait, renvoyée à son enfant mort.
- Mais achevons notre lecture. La dernière étape du texte, qui correspond à la troisième scène discursive, rapporte le jugement porté par Israël sur le jugement du roi. Il s’agit donc, en termes narratifs, d’une sanction : sa présence permet de récapituler l’ensemble du texte comme un seul et même programme (nous l’appellerons PN6), un programme de jugement dont Salomon est le sujet opérateur et les femmes le sujet d’état.
- PN 6 : F (Salomon) ⇒ (Femmes U jugement) → (Femmes ∩ jugement)
La manipulation est ici exercée par les femmes. Si leurs demandes faussées (PN 1 et PN 2 : « se faire attribuer l’enfant ») ne suscitent pas chez le roi un « devoir faire » conforme à leurs attentes, elles aboutissent cependant, par-delà leur échec, à susciter en lui la volonté de juger à sa manière, et non à la leur. Salomon disposant institutionnellement du « pouvoir juger », la phase de compétence passe ici exclusivement par une recherche de savoir. D’où la mise en œuvre du programme cognitif PN 3 (« déterminer qui est la mère »), programme qui s’accomplit grâce à la différence des programmes PN 4 (faire donner l’enfant) et PN 5 (détruire l’enfant). Ces deux programmes ont donc la fonction de programmes d’usage, qui donnent au roi le savoir nécessaire à la mise en œuvre de sa propre performance de jugement. Cette performance s’accomplit alors, au verset 27, dans la détermination de l’identité de la mère. Le dernier paragraphe constitue tout naturellement la sanction portée sur la performance du roi. On constatera que cette sanction attribue au jugement, objet de ce programme dont le sujet d’état sont les femmes, la valeur de la « sagesse divine »…
Le texte renferme une subtilité narrative. Du fait que la performance du roi Salomon est un jugement, cette performance se définit en même temps comme une « sanction » au sens sémiotique du terme : une sanction, c’est-à-dire un jugement qui statue sur une performance antérieure - en l’occurrence la performance de maternité des femmes -. Comme toute sanction, le jugement prononcé par Salomon sera décrit sémiotiquement comme l’articulation d’un paraître et d’un être [8] : le roi se prononce sur la maternité de l’une et l’autre femme du double point de vue du paraître (que paraît-il de la maternité de chacune des femmes ?) et de l’être (qu’en est-il ?). Salomon est en butte à la concurrence de deux paraître : chacune des femmes veut « paraître la mère ». Sa performance consiste à faire émerger l’être à côté du paraître, ce qui lui permet de distinguer deux positions de mères : l’une est vraie (paraître + être), l’autre mensongère (paraître + non être). Ainsi le jugement de Salomon consiste à établir qui est en vérité la mère, et non à décréter - comme on le lui demandait - qui aura l’enfant.
Conclusion
Au terme de l’analyse, il est fécond d’interroger les procédures et les résultats de la lecture sémiotique, ainsi que la direction dans laquelle elle introduit les lecteurs de la Bible.
D’abord, les procédures. Il est utile de bien situer la place relative, dans la lecture sémiotique, de l’analyse narrative et de l’analyse discursive. On soulignera avant tout leur convergence. Bien souvent - et en particulier dans le cas du jugement de Salomon - elle s’étend même au découpage du texte. Quel est l’effet de cette convergence ? Du narratif au discursif, elle joue à la manière d’une possibilité de vérification. L’approche narrative est une syntaxe, qui laisse de côté bien des éléments de la composante discursive. Elle aborde le texte par ses structures abstraites et permet ainsi de définir une trame sur laquelle viendra s’arrimer la chaîne discursive [9]. En sens inverse - du discursif vers le narratif - la convergence des approches intervient plutôt dans le sens d’un enrichissement. L’analyse discursive appréhende le texte à partir des chaînes figuratives ancrées dans la double dimension de l’énoncé et de l’énonciation. Elle bénéficie de ce fait d’une finesse et d’une acuité de vue qui lui permet de mettre en perspective et d’affiner les hypothèses narratives sur lesquelles elle s’appuie.
Il ne s’agit pas tant ici d’évaluer que de qualifier. La perspective construite est structurale. La description des dispositifs d’acteurs insérés dans des temps et des espaces a permis de définir plusieurs positions, et de rendre compte de la façon dont s’effectuait le passage d’une position à une autre. Le premier état des femmes était celui d’une fusion absolue : fusion entre ces femmes et leurs fils, confusion entre elles - d’abord dans leur similitude de « mères avec bébés », puis dans leur rivalité pour le statut de mère -. La fin du texte déploie une situation toute différente : elle dispose un enfant bien vivant promis à la vie, sa mère aimante, et l’homme qui assume provisoirement pour cet enfant le rôle d’un père. La dé-confusion est achevée, puisque la mère de l’enfant mort a disparu de la scène du discours. Celle du vivant a changé du tout à tout. Comment s’est opérée la transformation ? C’est l’épée, figure de la coupure, qui a tranché radicalement fusions et confusions. En menaçant de sectionner le lien de l’enfant survivant avec sa vie, elle a brisé la conjonction trop étroite entre cet enfant et sa mère, coupant court à la confusion des discours. Pour ce qui concerne l’autre femme elle n’a rien changé, car il n’y avait plus de lien à briser.
Comment définir la direction dans laquelle l’analyse sémiotique introduit ses lecteurs ? Elle les mène généralement sur deux voies, que cette conclusion se contentera d’esquisser sans les explorer dans le détail, car tel n’est pas le propos d’un chapitre consacré à la lecture d’un texte :
- Il y a d’abord, et c’est le plus évident, une direction anthropologique. Le texte biblique parle des humains, de ce qui les constitue et les tient dans la vie, mais aussi de ce qui fait obstacle à leur existence. Il en va ainsi du jugement de Salomon : il esquisse des perspectives capitales et donne des repères précieux pour une définition de la relation mère, père, enfant. Il permet aussi, comme bien d’autres textes de la Bible, de nourrir et d’éclairer une réflexion sur la jalousie.
Dans cette direction, la lecture sémiotique croise fréquemment les chemins de la psychanalyse. Ainsi cette analyse du jugement de Salomon peut être lue en écho avec les pages consacrées à ce texte par le psychanalyste Denis Vasse dans l’ouvrage intitulé « Un parmi d’autres » [10]. Le pari de cette étude était de mener et de rédiger l’analyse sans avoir pris connaissance de ces pages…afin de mettre les approches analytique et sémiotique en regard l’une de l’autre. Au terme du travail, il est intéressant de les comparer : la convergence des analyses est exemplaire pour ce qui est de la lecture du texte. Mais il apparaît bien aussi que les perspectives ne sauraient être confondues. La sémiotique est une contemplation méthodique des textes - une pratique réglée de la lecture - qui fonde et ouvre des repères pour une meilleure compréhension de l’humain. La psychanalyse s’appuie quant à elle sur la parole, le plus souvent vive mais parfois aussi inscrite dans des textes, pour mettre en évidence des traits structurants du psychisme humain. Entre elles donc pas de confusion, mais une possible complémentarité en allers et retours. Pour ce qui concerne la lecture de la Bible, la psychanalyse prolonge et éclaire l’approche sémiotique, qui peut en retour lui servir d’appui et de nourriture.
- Mais la lecture sémiotique de la Bible ouvre également, et c’est capital, sur une perspective théologique. Car si la Bible parle de l’homme elle parle aussi, et peut-être plus encore de Dieu, lorsqu’elle décrit tout du long son intervention dans l’histoire humaine. Lire la Bible permet ainsi une expérience fondamentale pour tout croyant - et sans doute même pour tout humain - : comprendre quelque chose de Dieu. Cette compréhension reçoit de l’analyse sémiotique des caractéristiques bien particulières, induites par la nature même d’une lecture structurale. Elle est elle-même une compréhension structurale, elle discerne et décrit les lignes de force d’un « agir » divin plutôt qu’elle n’en donne de définitions savantes au contenu objectif. Il en va ainsi du jugement de Salomon. Sa conclusion introduit les lecteurs dans la perception de ce qu’est une « sagesse divine »… Voilà qui appelle à relire, à cette lumière, les échanges de Jésus avec ses divers interlocuteurs : on y découvrira une aptitude identique, mais encore supérieure, à faire émerger en quelques mots la vérité enfouie dans les êtres, et à rouvrir devant eux la voie de leur salut.
[1] On retrouve là la distinction proposée, intuitivement, entre ce qui avait été nommé « l’appel au jugement de Salomon » (énonciation) et « l’exposé du litige » (énoncé).
[2] « Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu’elle s’était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi… et le coucha contre elle ; et son fils, le mort, elle le coucha contre moi » (19-20).
[3] « Je me levai le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Le jour venu, je le regardai attentivement, mais ce n’était pas mon fils, celui dont j’avais accouché » (21).
[4] J-L Austin, « Quand dire c’est faire ».
[5] Ce terme, emprunté à René Girard, paraît particulièrement bien adapté au jugement de Salomon, dont cet auteur a d’ailleurs proposé une lecture (référence à compléter).
[6] En effet, la sémiotique narrative dirait qu’ici l’objet demeure à distance du sujet auquel il est conjoint.
[7] En langage psychanalytique, on pourrait dire que cette femme, prisonnière de son imaginaire, croit que sa parole a pouvoir sur le réel.
[8] Cette articulation du paraître et de l’être fait référence à l’outil sémiotique nommé « carré de la véridiction », qui définit quatre positions : le vrai (être + paraître), le secret (être + non paraître), le mensonger (non être + paraître), et le faux (non être + non paraître).
[9] « Le réseau figuratif forme la chaîne du discours : il est le plus étendu, ses constituants sont les plus nombreux et il livre avec ses signifiants la promesse d’une riche signification. La composante thématique forme la trame. Par elle et autour d’elle se nouent les fils discursifs, s’opèrent les connexions sémantiques ; et sans elle aucune signification intermittente n’émergerait jamais, la tapisserie du texte où se dessinent les figures se déferait, se morcellerait, tomberait en lambeaux. Mais pourtant la trame du thématique ne peut se substituer à la chaîne figurative pour en représenter le dessein. Paradoxalement entre les deux une partie des fils est rompue et c’est cette cassure qui fait tenir l’ensemble. » (François Martin, Pour une théologie de la Lettre, p 147)
[10] Denis Vasse, « Un parmi d’autres », Le champ freudien, Seuil, 1978. Voir en particulier le chapitre II, « Le tranchant de la parole », pp 31-69.